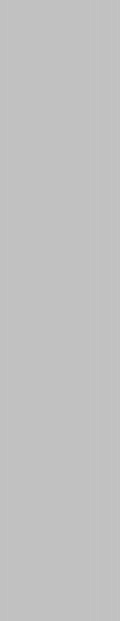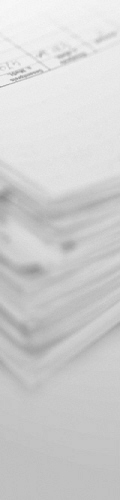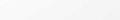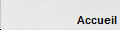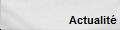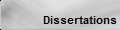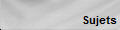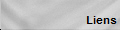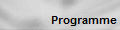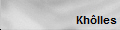Population et travail
1. Taux de fécondité
- taux de natalité : nombre de naissances / population totale
- taux global de fécondité générale : nombre de naissances vivantes / nombre de femmes en âge de procréer (15 à 49 ans)
Ce taux est sensible à la structure par âge de la population féminine. Or à l’intérieur de la tranche 15-49 ans, il existe une grande variabilité de la fécondité. C’est pourquoi on calcule le taux de fécondité pour chaque âge, opération qui sert au calcul de l’indicateur synthétique de fécondité
- indicateur conjoncturel (ou synthétique) de fécondité : somme des taux de fécondité pour chaque âge (de 15 à 49 ans) établis pour une période donnée. Accordant une pondération identique aux différentes classes d’âge, quel que soit leur effectif, il élimine l’effet de structure que constitue la répartition par âge des femmes en âge de procréer. Il permet de calculer le nombre moyen d’enfants auxquels les mères donneraient le jour si les générations futures avaient le même taux de fécondité par âge que les générations actuelles. Il mesure la fécondité du moment.
- descendance finale : nombre moyen d’enfants effectivement mis au monde par les femmes d’une génération donnée. Cet indicateur ne peut se calculer qu’une fois achevée la vie féconde de la génération étudiée ; il mesure la fécondité passée. Il évolue plus lentement que l’ICF puisqu’il ne prend pas en compte les modifications du calendrier des naissances (par ex les naissances différées pour cause de guerre).
2. Espérance de vie à la naissance
Moyenne des durées de vie d’une génération imaginaire qui serait soumise toute se vie aux taux de mortalité par âge de l’année d’observation.
La génération est dite « imaginaire » car on lui fait parcourir tous les âges de la vie en lui faisant subir, à chaque âge, les conditions de mortalité observées sur les différentes générations réelles de l’année étudiée.
En 2006 en France, elle s’établissait à 77.2 ans pour les hommes et 84.2 ans pour les femmes.
Source : INSEE, bilan démographique.
3. Taux d’activité et taux d’emploi
- taux d’activité : population active / population totale correspondante
Le taux d'activité d'une population est la proportion d'actifs (individus actifs en emploi plus les chômeurs) dans cette population totale. En général, la population considérée est la population en âge de travailler (en général, personnes de 15 à 64 ans)
- taux d’emploi : nombre de personnes actives occupées / nombre total de personnes en âge de travailler (15 à 64 ans). Le taux d'emploi reflète la capacité d'une économie à utiliser ses ressources en main-d'œuvre.
4. Les cycles d'Easterlin :
R. A. Easterlin observe que la fécondité américaine suit des cycles d'expansion et de dépression. Les variations de la fécondité seraient liées aux conditions d'insertion des jeunes entrants sur le marché du travail. Une cohorte à faible effectif permet une meilleure insertion sur le marché du travail, un meilleur niveau de vie, et donc une plus grande fécondité. Il en résulte vingt ans plus tard une cohorte plus nombreuse, une insertion plus difficile et donc une moindre fécondité. Cette théorie prédisait ainsi une reprise de la fécondité dans les années quatre-vingt et un nouveau baby boom. L'absence actuelle de baby boom serait due, selon Easterlin, aux effets de l'immigration. Celle-ci abaisserait le niveau de salaires des jeunes entrants sur le marché du travail et par conséquent le niveau de fécondité. Toutefois, l'effet de l'immigration sur les salaires des nationaux est plus que controversé.
Vous trouverez grace à ce lien un cours sur la fonction de consommation keynésienne, la théorie du revenu permanent de Friedman, la théorie du cycle de vie de Modigliani.
.
Les grandes fonctions économiques
5. Elasticité prix et élasticité revenu de la consommation :
- % de variation de la consommation / % de variation des prix.
- % de variation de la consommation / % de variation du revenu.
6. Propension moyenne et propension marginale à consommer :
- C / R
- ∆ C / ∆ R
7. Fonds propres :
Les capitaux propres représentent un passif comptable correspondant aux ressources stables de l'entreprise. Ils ont deux provenances principales :
- les apports en capital réalisés par les propriétaires (les actionnaires dans le cas des SA)
- les bénéfices laissés à la disposition de la société en tant que bénéfices non distribués Les actionnaires prennent un risque élevé : si celle-ci va mal, ils ne seront pas rémunérés (aucun dividende ne sera versé) ; si elle dépose son bilan, les porteurs de capitaux propres ne seront remboursés qu'après que les créanciers l'aient été intégralement, ce qui est très rarement le cas. Si elle va très bien au contraire, tous les profits leur reviennent. "
Les capitaux propres et les dettes correspondent aux ressources de l'entreprise alors que l'actif correspond à l'utilisation de ces ressources.
Ce sont les capitaux propres et les dettes d'une entreprise (autrement dit les ressources de l'entreprise, réunies au bilan comptable dans la catégorie "passif") qui financent son actif, tant immobilisé (terrains, usines, titres de participation..) que circulant (créances, stocks, valeurs mobilières ou banque).
L'utilité des capitaux propres est de participer au financement tout en offrant un certain matelas de sécurité aux prêteurs (banquiers, fournisseurs...).
Le montant des capitaux propres donne une indication de la valeur de l'entreprise qui revient aux apporteurs de capitaux.
| Actif | Passif |
| * Actif immobilisé : terrains, constructions, machines, droits * Actif circulant : créances, stocks, caisse | * Capitaux propres : - fonds apportés par les propriétaires de l’entreprise = capital social - ressources provenant de l’activité de l’entreprise = réserves, bénéfices * Dettes |
8. Rentabilité économique et financière :
Rentabilité économique : rapport entre le profit et la valeur du capital physique mis en œuvre pour l’obtenir. Elle est mesurée par le rapport entre l’excédent net d’exploitation et le capital fixe brut. ENE = profit après amortissement mais avant distribution des dividendes, paiement des frais financiers et impôts.
C’est la rentabilité du point de vue de l’entrepreneur.
Rentabilité financière : rapport entre le profit après paiement des intérêts et des impôts et les capitaux propres de l’entreprise.
C’est la rentabilité du point de vue de l’actionnaire.
Si la rentabilité économique est supérieure au taux d’intérêt des capitaux empruntés, l’endettement augmente la rentabilité financière ; c’est l’effet de levier.
Les différentes formes d’organisation économique et sociale
9. Revenus primaires et revenus de transfert :
Revenus primaires : rémunération des salariés (salaires + cotisations sociales) + revenus du patrimoine (dividendes + intérêts + loyers) + revenus de l’entreprise individuelle.
Revenus de transfert : prestations sociales au titre de la famille, la vieillesse, la santé, l’emploi.
10. Equilibre de marché et équilibre de circuit :
L’équilibre de marché s’opère à travers les prix ce qui suppose leur flexibilité ; logique néo-classique. L’équilibre de circuit s’opère à travers les quantités ; logique keynésienne.
11. Cosmos et taxis chez Hayek :
Les Grecs avaient établi une distinction entre l'ordre naturel (Cosmos) et l'ordre artificiel (Taxis).
Cosmos : désigne un ordre formé indépendamment de la volonté humaine, sans qu’on l’ait planifié ou construit, soit qu’il était déjà là ou qu’il s’est formé sans qu’on en ait conscience. C’est un ordre qui n’a pas de but, qui ne répond pas à un besoin ; c’est un ordre endogène, qui trouve en lui-même son moteur. Les Grecs appliquaient principalement cette expression aux phénomènes naturels (ex : un organisme en biologie).
Taxis : désigne un ordre délibérément construit par l’homme selon un dessein préétabli, le plus souvent au moyen d’un plan. C’est un ordre qui a une finalité, qui répond à un but.
Plusieurs institutions et phénomènes issus de l’action humaine ne répondent pas à la définition de la taxis, de l’ordre artificiel. Il existerait donc, entre les deux ordres, un 3ème type d’ordre, l’ordre spontané. C’est le résultat de l’action humaine sans être pour autant le fruit d’un dessein humain, sans avoir été conçu et planifié par un individu ou un groupe d’individus en vue de servir des fins particulières. Il attribue à Mandeville (1705) la paternité du concept d’ordre spontané avec la fable des abeilles : cet auteur affirme qu’un ordre social peut naître de l’interaction de pulsions égoïstes, non coordonnées (vices privés, vertus publiques). La même idée sera analysée par Smith avec la parabole de la main invisible : la société est un ordre spontané.
Telles sont les grandes institutions sociales : le langage, la morale, le droit, la monnaie, le marché. Aucun esprit humain n'a consciemment planifié ces institutions, qui sont le résultat d'une longue évolution historique et qu'on ne peut supprimer par un acte volontaire sans risquer le retour à la barbarie. Cette évolution se fait selon un mécanisme de sélection, d'essais et d'erreurs, de disparition des structures inefficaces, qui n'est pas sans ressemblance avec la théorie darwinienne de l'évolution.
La société est un ordre spontané qui contient en son sein des ordres spontanés plus spécifiques et des groupes spécifiques relevant de la notion de taxis (famille, entreprises, institutions politiques).
Le marché est, de l'avis de Hayek, une institution fondamentale non seulement de la société moderne, mais de la civilisation. C'est un ordre spontané, résultat non planifié de l'action humaine, fruit d'une évolution plusieurs fois millénaire. À l'origine de cette évolution: le membre d'une tribu primitive qui a déposé à la frontière de son territoire un produit dont avait besoin un membre d'une autre communauté et qui trouve, le lendemain, son produit disparu mais remplacé par un autre dont il manquait lui-même. Cette parabole illustre le mécanisme de développement des ordres spontanés. C'est par expérience, par essais et erreurs, que s'impose graduellement le mécanisme le plus efficace pour l'organisation de la production matérielle, et donc pour la genèse de la croissance et du progrès économiques.
Hayek s’oppose ici au rationalisme constructiviste, théorie selon laquelle le marché, la monnaie, etc. sont des créations de la raison humaine. Cela implique que ce qui a été construit peut être détruit ou remplacé (cf. Marx).
12. La subsidiarité :
Le principe de subsidiarité est une maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même. Il va de pair avec le principe de suppléance, qui veut que quand les problèmes excèdent les capacités d'une petite entité, l'échelon supérieur a alors le devoir de la soutenir, dans les limites du principe de subsidiarité.
C'est donc le souci de veiller à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l'être avec autant d'efficacité à une échelle plus faible, c'est-à-dire la recherche du niveau pertinent d'action publique.
La signification du mot latin d'origine (subsidiarii= troupe de réserve, subsidium= réserve / recours / appuis) reflète bien ce double mouvement, à la fois de non-intervention (subsidiarité) et de capacité d'intervention (suppléance).
La subsidiarité peut être :
- descendante : délégation ou attribution de pouvoirs vers un échelon plus petit, on parle alors de dévolution ou décentralisation.
- ascendante : attribution de pouvoirs vers une entité plus vaste, on parle alors de fédération ou, entre pays, de supranationalité.
Trouvant son origine dans la doctrine sociale de l'Eglise catholique, cette notion est devenue l'un des mots d'ordre de l'Union européenne.
Vous trouverez grace à cet article de François Lefebvre des informations sur l'origine du terme et son application dans l'Union européenne.
Capitalisme rhénan versus capitalisme anglo-saxon (Michel Albert)
Né en 1930, énarque, Michel Albert a été commissaire général au Plan de 1978 à 1981, président des Assurances Générales de France (AGF) de 1982 à 1994, membre du Conseil pour la Politique Monétaire de la Banque de France de 1994 à 2003.
Il publie « Capitalisme contre capitalisme » en 1991. La victoire du capitalisme est totale : le mur de Berlin est tombé en 1989 et aux USA et au Royaume-Uni le poids de l’Etat a reculé avec Reagan et Thatcher.
Cependant le capitalisme est multiforme. Michel Albert pense qu’il existe une tendance à la bipolarisation entre deux grands types de capitalisme : un capitalisme anglo-saxon présent aux USA et au Royaume-Uni principalement, fondé sur la réussite individuelle et le profit financier à court terme ; un capitalisme rhénan centré sur l’Allemagne et comportant beaucoup de ressemblances avec celui du Japon, valorisant la réussite collective, le consensus, le souci du long terme.
Pour lui, le combat entre les deux types de capitalisme a remplacé le combat entre capitalisme et communisme.
| | Capitalisme anglo-saxon | Capitalisme rhénan |
| Place du marché | Forte | Moyenne ; importance des biens mixtes ou publics |
| Entreprise | Bien comme un autre | Communauté : Dialogue social (cogestion, syndicats) Participations croisées (banques/industrie) |
| Fixation des salaires | Marché | Conventions collectives, ancienneté |
| Inégalités | Fortes, dualisme social | Faible, présence de biens collectifs et de prestations sociales |
| Financement et gestion | Rôle majeur des marchés financiers et des actionnaires Dépenses moins urgentes réduites (formation, R&D) Faible prise de risques, ce qui bride l’esprit d’entreprise et la croissance | Importance des banques Souci du développement des entreprises avec lesquelles elles sont liées Limite les risques d’OPA Les dirigeants peuvent se consacrer à leur activité productive en toute sérénité |
| Recherche du profit | Court terme (exigence des actionnaires) | Long terme |
| Evolution de l’industrie | Perte d’emplois Main d’œuvre moins qualifiée | Bonne compétitivité structurelle (innovation, R&D, qualité) ; la monnaie forte impose des gains d productivité |
Michel Albert marque sa préférence pour le modèle rhénan : « L’histoire de la dernière décennie montre que le modèle « rhénan », deuxième modèle, qui n’avait pas jusqu’ici eu le droit de recevoir sa carte d’identité, est cependant à la fois le plus juste et le plus efficace ». (page 25).
Cette efficacité est due à une monnaie forte, des taux d’intérêt bas, une industrie puissante, des méthodes de management rompant avec le taylorisme, un niveau de R&D élevé soutenu par l’Etat, une épargne élevé (souci de l’avenir).
Symétriquement, pour l’auteur, le capitalisme anglo-saxon est plus cruel, plus violent et moins efficace. Le modèle anglo-saxon sacrifie délibérément l’avenir au présent.
Pourtant le modèle rhénan perd du terrain face au modèle anglo-saxon. D’une part, le modèle rhénan connaît de nombreuses difficultés : Etat providence contesté et recul de l’esprit de solidarité, hausse de la globalisation (FMN) et de la financiarisation (de la part des banques allemandes). D’autre part, le modèle anglo-saxon connaît un grand succès médiatique, il est en osmose avec l’individualisme et l’hédonisme ambiant, le souci de l’immédiateté.
La solution pour les Européens selon Michel Albert est de faire le saut vers l’Europe politique afin de construire un modèle européen.
Vous trouverez un résumé du livre de Michel Albert sur internet à l’adresse suivante :
Sur le thème du capitalisme en général, vous pouvez consulter :
* Problèmes économiques, n°2704-2705, "2001 la nouvelle odyssée du capitalisme". Vous y trouverez des informations très utiles sur les thèmes suivants : Un nouveau capitalisme ? L'entrepreneur, l'actionnaire et le dirigeant ; Les transformations de la société salariale ; Unité et diversité du capitalisme ; Capitalisme d'hier et d'aujourd'hui ; Un système légitime ?
* Alternatives Economiques, hors-série n°65 – 3ème trimestre 2005, intitulé « Le capitalisme ». Sont abordés : son histoire, ses théories, sa diversité, ses crises, sa régulation, son avenir, sa contestation, etc.
La grande transformation (Polanyi)
Cet ouvrage est également résumé en 4 pages dans les 100 fiches de lecture de M. Montoussé, Bréal.
La thèse de Polanyi peut être très utile si vous devez traiter un sujet sur l'évolution du capitalisme à long terme... ce qui est souvent le cas.