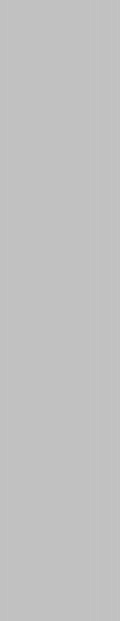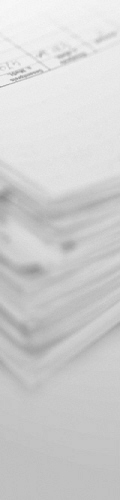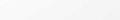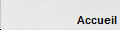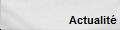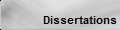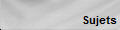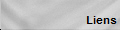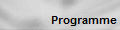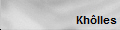COURS DE MICROECONOMIE
PREPA HEC PREMIERE ANNEE
OBJECTIFS - MODALITES D’EVALUATION - BIBLIOGRAPHIE
Ainsi que le rappelle D. Mc Closkey (1985) dans le chapitre introductif de son manuel, Théorie des prix, si tous les domaines de l'économie ne sont pas fondés sur la théorie des prix ou la microéconomie, ils devraient l'être. Selon ses termes :
"La théorie des prix est l'une des plus grandes réussites intellectuelles de l'humanité au XIX e siècle, à l'égal de la théorie des machines à vapeur, du déchiffrement des hiéroglyphes, de la professionnalisation de l'histoire, de l'invention de l'algèbre abstraite, de la théorie de l'évolution. La théorie des prix est le don fait par l'économie à l'étude des sociétés. Elle s'applique à tous les marchés ordinaires de la vie : ceux du blé, de l'assurance, des armes, des livres, des secrétaires, des coiffeurs, de la drogue, de la bible, etc. Mais elle s'applique aussi à des marchés moins ordinaires comme ceux de l'éducation, des droits de propriété, des faveurs politiques, de la pollution, du mariage, de la discrimination, des aptitudes à entreprendre, de la charité, des logements sociaux et du crime."
Une bonne compétence en théorie des prix ou en microéconomie revient à maîtriser l'art et la manière de pratiquer le raisonnement économique. Or c'est ce raisonnement économique qui définit un économiste de la même manière que l'art du diagnostic définit un médecin ou comme celui d'entraîner des hommes et de gagner une bataille définit un officier militaire. C'est cette maîtrise du raisonnement économique que vous allez "vendre" sur le marché. On vous embauchera pour cette compétence, pas pour une autre. Quand on soutient qu'un "expert en économie" n'est pas un économiste on ne veut pas dire qu'il est ignorant des institutions de la vie économique ou de son histoire, voire des statistiques qui décrivent l'économie ou encore de ses représentations mathématiques. On entend, par là, qu'il ignore le raisonnement économique.
Hélas, la plupart des manuels font l'impasse, presque totale, sur le raisonnement économique. Ils confondent la microéconomie avec l'économie mathématique ou les bases microéconomiques de l'équilibre général. Les applications de la microéconomie, lorsqu'elles existent, sont elles-mêmes confondues avec des tests empiriques ou avec la quantification et non pas, là encore, avec l'application du raisonnement économique à la compréhension de phénomènes concrets de la vie en société. Formules mathématiques ou figures abstraites abondent sans la contrepartie propre au raisonnement économique. A l'expérience, on s'aperçoit que les étudiants retiennent des formules ou des expressions économiques sans les comprendre. L'aridité de ces ouvrages les rebute. Ceux qui ne possèdent pas un bagage mathématique suffisant se détournent de la discipline. On observe même de plus en plus d'élèves de section scientifique qui préfèrent le droit à l'économie ! Les examens de microéconomie ne font que renforcer cette impression. Ils filtrent exclusivement l'aptitude mathématique des étudiants. Pour preuve la compilation des examens du premier cycle des plus grandes universités de France des années 1992-1993-1994-2000 (I.Maleyre, Annales corrigées de sciences économiques, Deug 1er 2ème année, éditions Organisation) dans cette matière ou encore le livre d'exercices et corrigés accompagant le livre et le cours de microéconomie de P.Picard : "Eléments de microéconomie 2 Exercices et corrigés" B.Jullien et P.Picard Montchrestien Domat Economie 1994.. La totalité de ces épreuves consiste en la résolution d'un problème de micro économie présenté sous forme mathématique et exigeant une certaine habileté dans le maniement de l'optimisation et du calcul algébrique. Il ne s'agit pas ici de critiquer l'usage des mathématiques dans l'enseignement, ni leur utilité, mais cet outil est secondaire par rapport à l'objectif fondamental qui est d'apprendre l'art et la manière de raisonner comme un économiste.
Ceux qui ont lu la préface du manuel de microéconomie du professeur H.Varian auront remarqué la similitude des motivations mais l'opposition totale quant au fond. Le professeur H.Varian se plaint des manuels américains remplis de graphiques, d'anecdotes, d'illustrations et de cas concrets, mais d'où est absente la capacité à résoudre quantitativement un problème économique.
"Le pouvoir réel de l'analyse économique vient en calculant des réponses quantitatives à des problèmes économiques", écrit-il.
C'est justement ce qu'il faut éviter parce que le pouvoir de l'analyse économique ne vient pas du calcul ou du quantitatif mais du raisonnement. Quand les manuels anglo-saxons recourent à des graphiques, des anecdotes, c'est que leurs auteurs ont compris depuis longtemps que l'économie n'est pas une science quantitative ni une science fondée sur le calcul. Faire croire à des étudiants qu'il en est ainsi, c'est non seulement les tromper mais c'est aussi les handicaper intellectuellement en les privant de la seule aptitude à quoi on reconnaît un économiste : sa façon de penser.
Pour former l’étudiant à l’art et à la manière de penser comme un économiste, le cours a été conçu pour présenter :
1) des outils de raisonnement indispensables à la bonne compréhension de l’économie
2) des applications du raisonnement économique (et non du calcul économique) à des problèmes d’actualité, ou à des questions de théorie économique,
3) des discussions pour inciter les étudiants à argumenter et à développer leur esprit critique.
4) des questions d’évaluation avec leurs réponses pour montrer ce que l’on attend de l’étudiant quand il affronte les tests vérifiant son aptitude et ses progrès dans le raisonnement et l’argumentation.
En effet, la maîtrise de ces outils du raisonnement économique se fait non seulement en suivant le cours mais aussi grâce aux travaux dirigés. Chaque séance de travaux dirigés est un entraînement à l’examen de fin de semestre.
On ne saurait insister suffisamment sur les lectures complémentaires. A l’expérience, on s’aperçoit que l’étudiant est devenu de plus en plus scolaire. Il lit le polycopié de son enseignant et ne va pas au-delà. Or, on ne peut lire et se cultiver à la place de l’étudiant. L’esprit critique se développe principalement par ces lectures. Il est prudent de choisir des économistes célèbres, des prix Nobel ; on s’assure ainsi de leur qualité. Ce principe, comme tout principe, peut être violé si cela permet d’être plus efficace.
La culture économique est une chose importante, elle ne doit pas être négligée. L’étudiant devrait donc avant la fin de l’année avoir consulté l’œuvre principale de ses divers auteurs et lu les textes accompagnant ce cours. Des questions à l’examen final vérifient si l’étudiant a fait cet effort.
Les travaux dirigés et les annales des examens ont une importance capitale dans la compréhension de ce cours car c'est en partie grâce à eux que le raisonnement économique, pour ne pas dire le raisonnement tout court, va s'acquérir.
L'ESPRIT DES TRAVAUX DIRIGES ET DES EXAMENS
Tests de vocabulaire
Tests de culture économique
Tests analytiques
Tests créatifs et déductifs
Tests rhétoriques
TACTIQUE A SUIVRE POUR REUSSIR LES EXAMENS ET LES TRAVAUX DIRIGES
1-“Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire lui viennent aisément”. La clarté est essentielle. Qui dit clarté, dit aussi être lisible, soignez votre écriture.
2-Lisez les bons auteurs, les Prix Nobel de littérature, en plus de ceux d'Economie.
3-Ayez des outils sous la main: blocs de papier pour noter les idées et écrire des phrases.
4-Réécrivez autant de fois qu'il le faut les paragraphes et les phrases.
5-Eviter de répéter ce qui est largement connu.
6-Contrôler le ton (ironique ou autre).
7-Faîtes des paragraphes courts, des phrases courtes et longues pour varier le rythme.
8-N'hésitez pas à mettre des notes de bas de pages pour expliciter un argument.
9-Citez de manière appropriée l'auteur qui est à l'origine de l'argument, si ce dernier n'est pas de vous.
10-Rendez les phrases cohérentes, ne pas hésiter à les lier de manière répétitive. Elles doivent être transitives: AB / BC / CD.
11-Un mot a un sens et un seul. Il faut être précis et retourner à la racine latine. Utilisez un dictionnaire. Sachez ce que ce mot veut dire. Soyez prêt à défendre l'utilisation de ce mot plutôt qu'un autre lors d'une discussion sur votre texte.
12-Utilisez la forme active.
13-Evitez les mots vagues, les verbes prétentieux, les adjectifs sans signification ou inutiles.
14-Soyez naturel et concret, évitez d'être abstrait.
15-Tableaux et graphiques doivent être complets. Ils doivent être compris sans se référer au corps du texte.
16-Enfin, vous êtes jugé sur la qualité de votre raisonnement, non sur la qualité de vos opinions politiques ou religieuses. Evitez de faire interférer vos opinions politiques, religieuses ou artistiques avec votre argumentation.
- Un devoir surveillé de deux heures organisé à la fin du semestre (30% de la note)
- Deux ou trois tests d’une heure environ (30% de la note)
- Des fiches de travaux dirigés (20% de la note)
- la note que vous aurez obtenue aux réponses sur le livre de Bastiat composera votre note à 20 %
- la note obtenue aux fiches de TD la composera à 20%
- la note aux tests la composera à 30%
- et la note obtenue au devoir surveillé composera le reste de votre note, soit 30%, à quelques ajustements près, si votre participation le mérite. Le devoir surveillé reprendra des questions sur l’ouvrage de Bastiat.