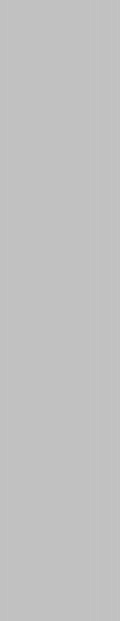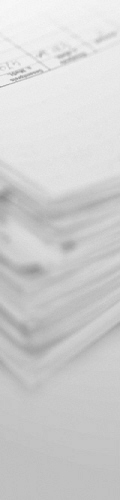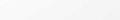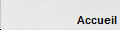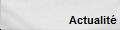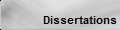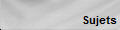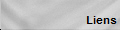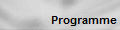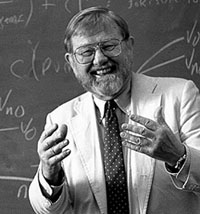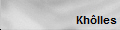Buchanan et Tullock ont commencé leurs travaux à la fin des années 1950 à l’Université de Virginie, d’où le nom d’Ecole de Virginie (Faifax) donné également à l’école des choix publics ou ‘Public Choice’. Leur ouvrage fondateur, Le Calcul du Consentement, 1962, marque la naissance véritable cette école. Buchanan a reçu le prix Nobel en 1986.
Cette école de pensée applique les outils de l’analyse économique aux phénomènes politiques, ce qui constitue une véritable révolution conceptuelle dans la vision de l’Etat. En effet, chez les premiers néoclassiques, l’Etat est pratiquement absent, il constitue une activité improductive mais inévitable dont il faut limiter l’impact. L’analyse se limite aux effets de la pression fiscale et à la recherche du meilleur impôt, c’est à dire le plus neutre économiquement.
Dans la première moitié du 20ème siècle, les économistes du bien être comme Pigou analysent les imperfections du marché, les externalités et les coûts sociaux deviennent les bases de l’économie publique. L’extension du rôle de l’Etat est légitimée par la correction des défauts du marché. Cette vision recèle une incohérence : d’un côté, les agents privés sont menés par leurs intérêts égoïstes dont il convient de corriger parfois les motivations ; de l’autre, les hommes de l’Etat sont supposés rechercher l’intérêt général. L’Etat est considéré comme un despote bienveillant.
En opposition avec l’école du bien-être, les économistes du Public Choice soutiennent que l’Etat n’est pas un despote bienveillant, les dirigeants politiques agissent non pas en fonction d’un quelconque “ intérêt général ”, notion floue et indéfinissable, mais des intérêts particuliers, légitimes ou non. Dans leur vie courante, les individus poursuivent leur intérêt personnel et réagissent en fonction des contraintes qui pèsent sur eux. C’est la même chose pour les hommes de l’Etat. Ces économistes vont ainsi appliquer les outils de l’analyse économique à l’Etat et ses représentants.
Gordon Tullock a donné la définition suivante du Public Choice en 1976 :
L’objectif est de comprendre comment fonctionnent les processus de décision qui gouvernent la production et l’allocation de biens publics (au sens de tout ce qui est produit par l’Etat et les Administrations) : défense, justice, solidarité, redistribution, réglementation…, en tenant compte des motivations et des intérêts particuliers des différents acteurs (citoyens, fonctionnaires, représentants politiques, hommes de gouvernement), de leurs systèmes de contrainte, de sanction ou de récompense qui influencent leur action individuelle et de voir comment leurs actions influent sur le “ bien être ” de la société.
Le Public Choice étend donc le paradigme de l’homo oeconomicus aux comportements des individus face à des choix non marchands. Quand l’électeur fait son choix, il intègre les “ bénéfices ” qu’il attend de l’Etat mais aussi les “ coûts ” fiscaux. Quand le bureaucrate agit, il a plutôt tendance à vouloir maximiser la taille de son budget que servir l’intérêt général. Cette Ecole s’intègre dans le vaste mouvement de vérification empirique du paradigme de l’homo oeconomicus entrepris depuis les années 1960 par l’Ecole de Chicago en testant son applicabilité aux diverses décisions humaines : famille, mariage, capital humain, éducation, religion, délinquance, etc. Ses principaux thèmes de recherche sont le marché politique, la bureaucratie et les groupes de pression.
Nous analyserons successivement trois thèmes : les systèmes de vote, la bureaucratie et les groupes de pression...