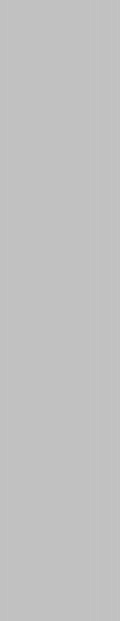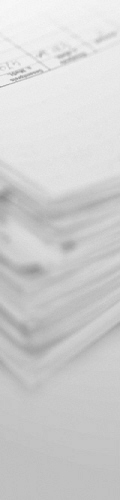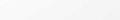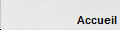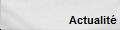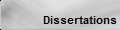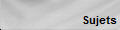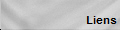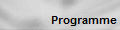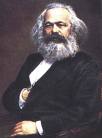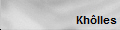Karl Marx est né à Trèves en 1818 et mort à Londres en 1883).
Il publie en 1848 Le Manifeste du Parti Communiste et en 1867 Le Capital.
Il subit l’influence de 3 courants :
- la philosophie allemande, en particulier la dialectique de Hegel
- le socialisme français : Saint-Simon, Sismondi, Fourier, Proudhon. Mais Marx veut remplacer le socialisme utopique par le socialisme scientifique.
- l’économie politique anglaise avec laquelle il partage le concept de valeur travail, la vision de la société composée de classes sociales, l’idée de répartition du produit social entre les classes. Il s'en distingue nettement par sa critique de la propriété privée, du capitalisme et de l’individualisme.
A) L’analyse du mode de production capitaliste :
1) Une nouvelle méthode : le matérialisme dialectique et historique :
- Matérialisme : Marx propose de renverser la dialectique de Hegel : elle marche sur la tête, il faut la « remettre sur ses pieds », c’est à dire lui donner une base matérielle car les contradictions ont leur source dans le réel. Base matérielle => histoire.
- Dialectique : relation d’opposition entre divers éléments qui engendre une nouvelle situation (conception hégélienne). thèse, antithèse, synthèse. La méthode dialectique permet d’étudier l’évolution des modes de production à partir de la dynamique interne de leurs contradictions.
- Historique : son objectif est de d’analyser le processus historique du développement des sociétés occidentales, à leur stade capitaliste en particulier. L’histoire ne se manifeste pas par une évolution continue mais par des transformations violentes qui résultent de luttes de classes. « L’Histoire, c’est l’histoire de la lutte des classes ».
Les lois économiques n’ont rien de naturel, contrairement à ce que prétendent les Classiques, elles sont historiquement déterminées. Les lois que l’on peut mettre ne évidence à propos du capitalisme n’ont de sens que dans cette société.
L’expression Critique de l’économie politique revient sans arrêt dans le titre de ses ouvrages :
1859 : Contribution à la critique de l’économie politique
1967 : Le Capital (tome I) porte comme sous-titre Critique de l’économie politique
Cela ne signifie pas que Marx rejette toute efficacité à l’analyse classique. Au contraire, Il leur rendra souvent hommage, notamment à Ricardo, dont il est à bien des égards le disciple. C’est avec raison que de nombreux auteurs classent Marx parmi les classiques.
2) Le concept de mode de production :
* définition du mode de production : forces productives + rapports de production
- forces productives : machines, terre, matières premières, force de travail.
- rapports de production : ensemble des relations que les hommes entretiennent entre eux dans le processus de production = rapports de classe + régime de propriété.
Marx en a une définition économique des classes sociales : ensemble des individus situés à la même place dans le processus de production.
Marx n’invente pas le concept de classes, ni la théorie de leur lutte. Les économistes (Quesnay, Smith, Ricardo) raisonnaient déjà en termes de classes. Selon Marx, la lutte des classes existe dans toutes les sociétés. Selon la portée qu’il souhaite donner au concept, il distinguera 2,3 voire 7 classes (dans Les luttes de classes en France où il évoque les boutiquiers et le sous-prolétariat). Importance de la conscience de classe : la classe n’existe pour elle-même qu’à partir du moment où elle se saisit des conditions qui font son unité. L’Etat n’est pas le représentant de la volonté générale, mais est au service de la classe dominante. Marx va s’attacher à saisir les fondements de cet antagonisme.
MPC : la bourgeoisie possède les moyens de production ; le prolétariat possède la force de travail.
- mode de production : type pur d’organisation sociale qui n’est pas nécessairement réalisé au sein d’une société donné, mais qui peut être cependant dominant dans certains pays. Marx considère l’Angleterre, la France et l’Allemagne au 19ème siècle représentatifs du MPC.
- formation sociale : combinaison de différents modes de production au sein d’une société considérée. Russie vers 1900 : poches de développement de type capitaliste au milieu d’un système retardataire, quasi féodal parfois.
* Marx définit 5 modes de production :
- antique : FP artisanales et RP basé sur la relation maître/esclave
- féodal : FP agricole et RP seigneur/serf à la campagne, maître/compagnon à la ville
- capitaliste : FP industrielle et RP bourgeoisie/prolétariat
- socialiste : FP nouvelle ère industrielle et RP extinction progressive du rapport de classe
- asiatique : Marx développe peu ce point, il correspond au système des castes en Inde
* Importance du mode de production chez Marx :
- l’infrastructure détermine la superstructure :
« Le mode de production de la vie matérielle (appelé infrastructure plus tard) conditionne la vie sociale, politique, intellectuelle (les superstructures) ».
« Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c’est leur existence qui détermine leur conscience ».
L’économie est la facteur déterminant en dernière instance.
- L’état des forces productives détermine celui des rapports de production. : dialectique FP/RP
Le développement des forces productives (progrès scientifique et technique, socialisation de la production : hausse de la taille des firmes, prolétarisation des anciens artisans) entre en contradiction avec les rapports de production (propriété privée) et avec les superstructures qui tendant à maintenir le régime en place è révolution.
Pour Marx, propriété privée = petits producteurs indépendants et éparpillement des moyens de production. Cela exclut la concentration. Mais se produit un mouvement d’élimination transformant les moyens de production individuels et épars en moyens de production socialement concentrés, « faisant de la propriété naine du grand nombre la propriété colossale de quelques-uns ». C’est la genèse du capital, l’accumulation primitive du capital. Progressivement les petits producteurs sont changés en prolétaires. Mais ensuite ce sera le tour des capitalistes d’être expropriés à cause de la concentration des capitaux. Hausse de la misère et de l’oppression. hausse de la résistance ouvrière, de plus en plus unie et organisée par le mécanisme de la production capitaliste (socialisation du travail et centralisation de ses rapports matériels).
3) La spécificité du mode de production capitaliste :
* l’accumulation : le capitalisme est une machine à accumuler des capitaux, c’est à dire transformer de l’argent en capital : schéma A-M-A’. Capitaliser : transformer de l’argent en capital pour en tirer un profit ensuite. Cela entraîne un accroissement du capital investi par travailleur employé.
* C’est l’opacité des rapports de production découlant de la généralisation de l’échange marchand.
. Dans le MPC l’exploitation est moins visible (liberté du prolétaire ; pas de corvée). La généralisation des rapports marchands à la force de travail masque l’exploitation.
. Dans le MPC, on produit pour le marché, sans être assuré de pouvoir écouler sa production. Le marché n’organise une régulation qu’à posteriori. Il y donc des possibilités de rupture, de crises graves. Alors que dans les mode de production précapitalistes, on produit dans le cadre de rapports de dépendance interpersonnels (on livre à quelqu’un).
* Aliénation
Concept philosophique emprunté à Fueurbach qui l’avait cantonné au domaine religieux, Marx va l’appliquer au champ social. Du latin alienus qui signifie étranger, autre.
Pour Marx, l’ouvrier est aliéné de plusieurs manières :
- par rapport au travail : à cause de la division du travail, il ne contrôle pas le processus de production, il ne produit qu’une petite partie de la marchandise ; le travail apparaît comme étranger à l’ouvrier, il est imposé du dehors
- par rapport au produit de son travail : il en est dépossédé après l’avoir fabriqué et il ne se reconnaît plus dans l’objet qu’il produit
- par rapport au genre humain : il ne produit pas pour se réaliser mais uniquement pour satisfaire ses besoins ; il est mis en concurrence avec les autres ouvriers sur le marché du travail.
NB : le capitaliste est lui aussi aliéné car il est poussé par la compétition et la rationalisation du travail et car il n’a qu’un rapport théorique au travail.
Aliénation : concept philosophique ; Exploitation : concept économique.
L’aliénation est une conséquence de l’exploitation.
Concept disparaît progressivement des écrits de Marx après 1845 et se trouve remplacé par celui de fétichisme de la marchandise dans Le Capital.
* Fétichisme de la marchandise :
Sens courant : vénération outrancière, superstition pour quelque chose.
Fétichisme (en général) : Inversion des rapports entre les hommes et les choses. Les catégories économiques apparaissent comme des choses alors qu’elles représentent en réalité des rapports sociaux. Valeur d’échange è marchandise ; monnaie è or ; capital è machines. C’est la transformation des relations sociales en choses : réification = les relations entre producteurs se cristallisent dans la marchandise, les rapports entre travailleur et capitaliste se manifestent dans le capital en tant que chose.
Le fétichisme de la marchandise : on confond l’objet physique avec sa fonction sociale. Le rapport entre les choses voile le rapport des hommes entre eux. Les rapports sociaux disparaissent de la conscience des hommes qui ne reçoivent plus que des rapports entre les choses ; le prix qui sanctionne l’échange n’est plus une expression du rapport social entre 2 individus mais une caractéristique de la chose aussi naturelle que ses propriétés physiques.
Exemple : échange 1 charrue contre 500 kg de maïs.
A travers cet échange semble s’installer un rapport entre des marchandises réglé par le marché, alors que derrière cette apparence il y a un rapport social entre un forgeron et un cultivateur.
Cela est aggravé par le recours à la monnaie : 1 charrue = 100 euros : imaginer le travail humain derrière la marchandise est encore moins évident.
Le recours à la monnaie masque l’origine humaine de la production. La marchandise se voit ainsi conférer une valeur en soi (qu’elle ne détient pas en réalité) d’ou le recours à l’image du fétichisme pour décrire cette perversion.
La critique du fétichisme s’inspire de la critique de la religion : de même que la religion semble s’autonomiser et devenir créatrice de l’humanité, de même les choses produites par les hommes s’autonomisent, acquièrent leur vie propre et finissent par mener le monde.
B) La théorie de la valeur et des prix :
1) La théorie de la valeur :
Marx reprend la distinction valeur d’usage et valeur d’échange.
La valeur d’usage est incomparable d’une marchandises à l’autre, car elle renvoie à l’hétérogénéité des marchandises, à leurs caractéristiques propres. Comme l’échange implique comparaison, il ne peut être basé sur la valeur d’usage.
Qu’y a-t-il de commun entre 2 marchandises ? le fait d’être des produits du travail. La valeur d’échange des marchandises (hors terre et œuvres d’art) se fonde sur la quantité de travail.
2 précisions :
- Il s’agit du temps de travail nécessaire en moyenne, appelé temps de travail socialement nécessaire. Ce ne sont pas les conditions individuelles de production qui déterminent la valeur d’échange, sinon plus un homme est paresseux, plus sa marchandise a de valeur.
- Il faut prendre aussi en compte le travail indirect ou travail mort, c’est à dire la quantité de travail incorporée au cours des cycles de production antérieurs pour produire les machines et les matières premières. C’est dans la suite des idées de Ricardo.
- Le travail est à la fois origine et mesure de la valeur.
2- Force de travail, plus value et exploitation :
Formule générale du capital : A-M-A’ avec A’>A, comment s’explique l’accroissement de valeur ?
Marx veut démontrer que sous l’apparence de l’échange de valeurs égales, se déroule un échange inégal, l’exploitation d’une classe par une autre, occulté par le marché. L’exploitation se réalise par l’échange d’une marchandise particulière : la force de travail.
La distinction travail/force de travail :
Le travail est la mesure de la valeur mais il n’a lui-même aucune valeur, pas plus que la chaleur n’a de température. Ce qui est échangé n’est ni le travail ni le produit du travail mais la force de travail : l’ensemble des facultés physiques et intellectuelles qu’un individu met en mouvement pour produire, sa capacité de production.
Les caractéristiques de la force de travail :
- La force de travail est une marchandise vendue par les travailleurs et achetée par les capitalistes.
- La force de travail a une valeur d’échange : comme toute marchandise, déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production. = Temps de travail nécessaire à la production des biens de subsistance nécessaire à sa reconstitution (nourriture, vêtements, habitat, etc.) sachant qu’ils dépendent des conditions historiques.
- Particularité : c’est la seule marchandise apte à produire une valeur supérieure à sa propre valeur : comme le surgénérateur Super–Phénix !
Sur-travail et plus value :
è Surtravail = temps pendant lequel l’ouvrier travaille alors qu’il a déjà engendré pour son patron la valeur (d’échange) de sa force de travail.
Plus value = valeur créée par la force de travail - valeur de la force de travail
Valeur d’usage de la force de travail – valeur d’échange de la force de travail
Exemple : un ouvrier travaille 12 heures par jour ce qui engendre une valeur de 200 euros, son salaire quotidien est de 100 euros correspondant à 6 heures de travail
=> Surtravail = 6 heures. Plus value = 100 euros.
- La plus value, ou sur-valeur est appropriée par le capitaliste.
- Cette plus value est partagée au niveau global entre les différents revenus capitalistes : rente, intérêt, profit.
- La force de travail est appelée chez Marx capital variable (V): c’est la partie du capital destinée à payer les salaires ; variable car à l’origine d’une création de valeur (la plus value).
- Le reste du capital (machines, bâtiments, matières premières, énergie, fonds de roulement) est appelé capital constant (C) : constant car il n’est pas à l’origine d’une création de valeur supérieure à son acquisition.
- Valeur d’un bien = travail indirect + travail direct
capital constant + [capital variable + plus value]
- Le taux de plus value ou taux d’exploitation est : plus value/capital variable => e = pl/V
Remarque : travail productif et improductif
Le travail productif est celui qui produit de la plus value et donc qui valorise le capital.
Travail effectué par l’ouvrier pour le compte d’un capitaliste => travail productif (crée de la valeur)
Travail effectué par un artisan => travail improductif (fait circuler la valeur).
Cela ne recoupe pas la distinction biens/services, ni manuel/intellectuel.
Principaux travaux improductifs : commerce, opérations financières, publicité, études de prix, analyse de gestion, assurance + fonctionnaires + domestiques.
Le capitaliste a pour fonction de diriger et exploiter le travail productif, il a donc une fonction productive.
Importance de cette distinction : seul le travail productif permet l’accumulation du capital. Or au fur et à mesure que le capitalisme se développe, le travail improductif tend à s’accroître , signe que le capitalisme remplit de moins en moins bien sa mission historique.
3- Le passage de la valeur au prix de production :
Marx affirme que les rapports d’exploitation son occultés : l’observateur peut voir les prix mais non les valeurs, le taux de profit mais non le taux de plus value.
a) Le taux de profit :
Ce qui intéresse le capitaliste, c’est la rémunération perçue par rapport à la masse des capitaux avancés, c’est donc le capital total qu’il faut prendre en compte.
Taux de profit = pl / [C + V]
b) Les prix de production :
Il y a un écart entre la valeur et ce que Marx appelle le prix de production.
Les marchandises ne sont pas vendues à leur valeur car il en résulterait des taux de profit très différents suivant les secteurs. Un taux de profit uniforme va s’appliquer à l’ensemble des secteurs. Cela signifie que chaque capitaliste, quelle que soit la branche, reçoit une part de profit proportionnelle à son capital => chaque capital individuel est une fraction du capital total qui, à ce titre, réclame une partie de la plus value.
Exemple : l’économie est divisée en 3 secteurs.
| Secteur | Capital constant | Capital variable | Plus value | Valeur | Taux de profit | Prix de production |
| 1 | 3000 | 1000 | 1000 | 5000 | 20% | 4800 |
| 2 | 4000 | 1000 | 1000 | 6000 | 20% | 6000 |
| 3 | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 | 20% | 7200 |
| Ensemble | 12000 | 3000 | 3000 | 18000 | 20% | 18000 |
Taux de plus value : 3000/3000 = 100%
Taux de profit : 3000/(12000+3000) = 20%
Ce taux de profit moyen va s’imposer à tous les capitalistes en vertu de la concurrence (selon des modalités complexes et confuses d’après Abraham-Frois) et va déterminer les prix de vente des marchandises. Pourquoi le terme prix de production ? le capitaliste ajoute à la valeur des moyens de production utilisés, un montant de profits correspondant au taux de profit global.
Prix de production : Pi = Ci + Vi + r(Ci + Vi) = (1 + r) (Ci + Vi) où i représente un secteur
P1 = (1 + 20%) (3000 + 1000) = 4800
P2 = (1 + 20%) (4000 + 1000) = 6000
P3 = (1 + 20%) (5000 + 1000) = 7200
Pour l’ensemble de l’économie, la somme des prix est égale à la somme des valeurs.
Ces prix de production sont le centre de gravité autour duquel oscilleront les prix de marché suivant l’offre et la demande.
Si les marchandises s’échangeaient en proportion de leur valeur, le taux de profit serait différent selon les secteurs :
- : 1000/4000 = 25%
(2) : 1000/5000 = 20%
(3) : 1000/6000 = 16.66%
Les prix de production assurent la péréquation des taux de profit.
La loi de la valeur se manifeste indirectement : transformation des valeurs en prix de production.
c) L’erreur de Marx :
Expression du prix de production : Pi = (1 + r) (Ci + Vi) :
Le même bien est donc évalué de 2 façons différentes. A droite on a le bien évalué en valeur quand il rentre dans le processus de production, à gauche le même bien évalué en prix quand il en sort. Mais il est impossible qu’un même bien soit vendu à un prix différent de celui auquel il a été acheté. Marx en était conscient mais pensait qu’il s’agissait d’une approximation sans conséquence. En fait, il n’en est rien.
On peut certes modifier l’expression précédente des prix de production de façon à évaluer le capital constant et le capital variable en prix de production Pi = (1 + r) (Cpi + Vpi) ; mais ce système n’a pas de solution si on prend le taux de profit r tel que Marx l’a défini. Pour rendre le système cohérent, il faut introduire un taux de profit différent de r : Pi = (1 + R) (Cpi + Vpi) ; il y a alors détermination simultanée du taux de profit et de l’ensemble des prix de production.
=> la formule donnée par Marx lui-même du taux de profit r, à savoir (pl/C + V), est fausse.
C) Accumulation et crises dans le MPC :
Le capitalisme est une machine à capitaliser la plus value. Il s’agit de transformer l’argent en capital nouveau. Le capitalisme se résume au cycle : A-M-A’ (où A est l’argent et M la marchandise et A’=A + pl), c’est à dire à la formule « vendre pour acheter ».
On accumule en capitalisant la plus value.
1) L’accumulation du capital :
On observe un accroissement continu du capital investi par travailleur employé : hausse de la composition organique du capital C/V.
Causes : progrès des forces productives, hausse de la productivité du travail, progrès technique, concurrence entre les firmes.
Effets :
1- chômage. Baisse des besoins en travail due au progrès technique, que ne peut compenser la hausse de la demande de travail due à la hausse des débouchés.
- apparition de surnuméraires => constitution d’une armée de réserve industrielle dans laquelle, en cas d’expansion, les capitalistes pourront puiser sans augmenter les salaires.
- loi de surpopulation relative : le chômage et la misère ouvrière ne sont pas des phénomènes naturels (contrairement à ce qu’affirme Malthus) mais sont la conséquence du fonctionnement du MPC. Illustration : révoltes des canuts lyonnais, luddisme en GB.
2- polarisation de la société entre une minorité de plus en plus riche et une majorité de plus en plus pauvre
3- contradiction entre la socialisation des forces productives (la production est réalisée non par des individus isolés mais par des collectifs) et le caractère privé des moyens de production (une petite minorité monopolise le pouvoir économique car elle concentre les moyens de production).
2) Les crises de surproduction :
La formule générale du capital A-M-A’ (« acheter pour vendre ») est révélatrice de la possibilité de crises.
Causes :
1- le produit doit être vendu pour que la réalisation de la plus value ait lieu effectivement (faute de quoi le travailleur aurait été exploité sans que le capitaliste touche quoi que ce soit)
2- il faut ensuite que l’argent récupéré soit relancé dans le circuit pour qu’un nouveau cycle de production puisse repartir
3- compte tenu du grand nombre d’échangistes et du nombre de cycles se déroulant de façon plus ou moins simultanée, il y a de façon permanente la possibilité d’un arrêt partiel de l’échange (si les ventes se font mal, si les profits attendus sont faibles).
Marx a la conception suivante du MPC : les capitalistes prennent des initiatives anarchiques et désordonnées, le marché effectue à posteriori une régulation, absorbant ou rejetant les productions déversées par les capitalistes.
Déroulement :
offre > demande => mévente => baisse des prix et du profit => contraction des échanges => baisse de l’investissement => faillites, licenciements.
La crise peut être durable en raison des difficultés techniques de reconversion de certains capitaux.
De la crise surgissent des éléments de solution :
- destruction des capacités de production excédentaires, maintien des firmes les plus productives
- baisse des prix => hausse de la demande
- chômage => pression à la baisse sur les salaires => hausse de la rentabilité
- innovations mises en œuvre par les firmes les plus performantes (la plus value extra est celle obtenue à la suite d’une innovation)
- concentration et hausse de la taille des firmes (absorption de firmes en difficulté)
3) La loi de la baisse tendancielle du taux de profit :
Là où Ricardo voyait une baisse du taux de profit due aux contraintes objectives imposées par la nature, Marx découvre une baisse du taux de profit imputable uniquement à la forme spécifique de l'économie qu'est le capitalisme. Là où chez Ricardo, la baisse du taux de profit était causée par l'absence de progrès technique (en matière agricole), chez Marx la baisse du taux de profit est au contraire causée par ce progrès technique - et par la forme qu'il prend en économie capitaliste.
Pour comprendre, dans ses grandes lignes, le raisonnement de Marx, le plus simple est d'en revenir à la définition du taux de profit. Celui-ci est évidemment égal aux profits rapportés aux capitaux investis. Or, à l'échelle de l'ensemble de l'économie, on sait que les profits sont égaux à la plus-value, ce travail non payé arraché aux salariés. Quant aux capitaux investis, ils se divisent en deux catégories : d'une part, le capital constant, celui qui dans la production, se contente de transmettre sa valeur aux marchandises (bâtiments, machines, matières premières, etc.) ; d'autre part, le capital variable, celui qui dans la production, crée une valeur supplémentaire, ajoute de la valeur aux marchandises qu'il sert à fabriquer (les salaires). En utilisant les notations traditionnelles (pl représentant la plus-value, C le capital constant et V le capital variable), on écrit que le taux de profit r est égal à :
Divisons chacun des termes de notre fraction par V (ce qui ne change strictement rien à r). Nous obtenons la formule :
Dans cette nouvelle formulation, nous trouvons deux nouvelles variables :
-
ε, qui est égal à pl / V. Il s'agit, dans les concepts de Marx, du taux de plus-value, également appelé taux d'exploitation. C'est le rapport entre le travail qui est extorqué aux salariés et celui qui leur est effectivement payé par les capitalistes.
-
Ω, qui est égal à C / V. Cette grandeur représente le rapport entre le capital constant et le capital variable, ce que Marx appelle la composition organique du capital.
D'un strict point de vue mathématique, on voit d'un seul coup d'oeil que le taux d'exploitation et la composition organique ont des effets inverses sur le taux de profit : un accroissement du taux d'exploitation fait augmenter le taux de profit, alors qu'un accroissement de la composition organique le fait diminuer.
L'essentiel de l'argumentation de Marx porte sur ce deuxième aspect. Marx affirme que dans le capitalisme, le progrès technique est synonyme de mécanisation, donc de remplacement du travail vivant (celui des salariés) par le travail mort (les machines). Ainsi, la partie du capital consacrée à l'achat de machines tend à prendre de plus en plus d'importance par rapport à celle consacrée au paiement des salaires. La composition organique du capital augmente avec le temps, entraînant le taux de profit vers le bas. Quant au taux d'exploitation, Marx suggère avec plus ou moins de netteté qu'il n'augmentera pas suffisamment pour compenser les effets de l'augmentation de la composition organique, voire qu'il restera stable.
La hausse de k est bénéfique pour le capitaliste individuel car il va pouvoir renforcer sa position concurrentielle, absorber des concurrents. Mais au niveau macroéconomique les débouchés vont baisser, entrainant une baisse de la consommation et des crises de plus en plus graves.
En outre, le taux de profit faible entraine une baisse de l’investissement (appelé accumulation par Marx) qui oblige les entreprises à licencier et à aggraver la sous consommation ouvrière.
Marx souligne lui-même l'existence de contre-tendances, qui peuvent retarder, ou annuler provisoirement, les effets de ce mécanisme :
* la hausse de la durée du travail, l’intensification du travail ou la réduction du salaire en dessous de la valeur de la force de travail peut permettre l’augmentation du taux d'exploitation, cependant il y a des limites physiologiques et des résistances ouvrières
* l’impérialisme permet d’accroitre les débouchés, d’importer des produits moins chers et de déplacer le capital dans des contrées où le taux de profit est plus élevé
* l’extension de nouvelles branches à faible composition organique
* la hausse de la productivité du travail dans le secteur des biens de consommation permet de produire à moindre coût les marchandises qui entrent dans la reproduction de la force de travail, ce qui permet de diminuer la valeur de la force de travail (capital variable) et d’augmenter le taux de plus-value.
* la hausse de la productivité du travail dans le secteur des biens de production permet de baisser le prix des équipements, cela permet de diminuer la valeur du capital constant et donc d’abaisser la composition organique du capital
* l’intervention de l’Etat qui peut contribuer à dévaloriser le capital en favorisant la disparition de certains capitaux
Pour ces raisons, Marx pense que le taux de profit ne diminue pas de manière régulière, mais seulement de manière tendancielle. Mais il est convaincu que ces contre tendances ne peuvent empêcher, à terme, le taux de profit de diminuer.
A la différence de Ricardo, Marx ne croit pas en la possibilité d'un capitalisme se stabilisant paisiblement sur une croissance zéro. Cette baisse du taux de profit entraînera la multiplication des convulsions, des crises, des guerres, et surtout, des luttes sociales qui abattront l'organisation capitaliste pour la remplacer par un autre type d'économie et de société.
La loi de la baisse tendancielle du taux de profit a suscité, depuis plus d'un siècle, une immense littérature qu'il m'est impossible résumer ici en quelques mots. Je signalerai simplement que son principal point faible réside certainement dans l'identification faite entre progrès technique et augmentation de la composition organique du capital. On peut en effet montrer que le progrès technique, dans la mesure où il fait lui-même baisser la valeur des machines, ne conduit pas obligatoirement à l'augmentation de la part de celles-ci dans l'investissement.
La situation devient de plus en plus instable, les crises sont de plus en plus graves, ce qui doit aboutir selon Marx à la chute finale du capitalisme.