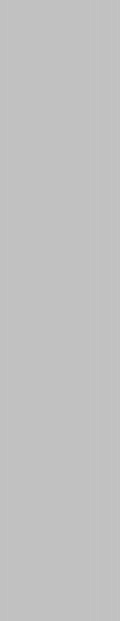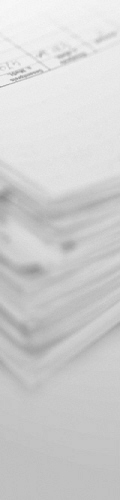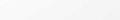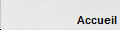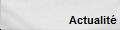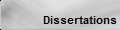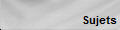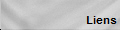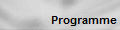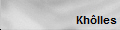Une nouvelle théorie économique émerge vers 1870, elle sera appelée « marginaliste ». Elle génère de nouvelles habitudes de pensée => apparition d’un nouveau paradigme au sens de Kuhn : modèle théorique de pensée qui oriente la recherche et la réflexion scientifique.
Sans avoir eu de contact entre eux, 3 auteurs, Jevons, Menger et Walras développent dans les années 1870 la théorie de l’utilité marginale : la valeur d’un bien dépend de l’utilité marginale, c’est à dire l’utilité de la dernière unité consommée.
La révolution marginaliste doit son nom à l’importance que revêtent les grandeurs marginales : utilité marginale, productivité marginale, coût marginal, recette marginale. Le qualificatif marginal signifie variation « à la marge » ou « petite variation ».
Cet événement marque le passage de l’économie classique à l’économie néoclassique, qui s’impose au 20ème comme vision dominante.
A) Les précurseurs de la révolution marginaliste :
Avant 1870 plusieurs auteurs ont utilisé le principe marginal, sans que leurs théories aient connu alors un grand retentissement.
1) Augustin Cournot (1801-1877) :
Professeur de mathématique, il publie en 1838 les Principes mathématiques de la théorie des richesses, considéré comme le point de départ de la théorie mathématique de l’économie.
Quel prix doit appliquer le monopole ? Dans le cas le plus simple où le coût de production est nul (eau minérale), ce prix est celui qui rend maximum le chiffre d’affaires. Pour trouver ce maximum, il faut connaître la fonction de demande. Il est le premier à formaliser la fonction de la demande, c’est à dire la relation entre la demande D et le prix p: D = f(p). Connaissant la fonction de demande, on peut en tirer le chiffre d’affaires = p.f(p).
Chiffre d’affaire maximum => [ p.f(p) ]’ = 0 => f(p) + p.f’(p) = 0
=> Profit maximal quand recette marginale nulle.
Il passe ensuite au cas où il y a 2 vendeurs => théorie du duopole. Hypothèse : les acheteurs annoncent les prix et les vendeurs ajustent simplement leur production à ces prix. La concurrence entre les 2 vendeurs se fait par la variation de la quantité produite. Chaque vendeur fixe la quantité qu’il vend en faisant l’hypothèse que la production de son rival reste constante. Cournot montre graphiquement qu’il existe un équilibre stable, à l’aide de courbes de réaction. Chaque courbe de réaction indique la production optimale d’un vendeur en fonction de la production de son rival.
Son modèle de duopole fut amendé et perfectionné : introduction de la concurrence par les prix (années 1880), nouvelles hypothèses relatives aux coûts, à la qualité du produit (années 1920).
Cournot compare les 3 structures de marché : monopole, duopole, concurrence.
Prix : concurrence < duopole < monopole. Quantités : monopole < duopole < concurrence
Se trouve esquissée l’idée selon laquelle la concurrence est l’étalon auquel sont mesurées les performances des marchés non concurrentiels.
2) Johann Heinrich Von Thunen (1783-1850) :
Il construit dès 1826, dans L’Etat isolé, une théorie de la localisation des cultures dans une région : les cultures intensives sont toujours effectuées près de la ville (marché), le prix élevé du sol à proximité des villes obligeant à une exploitation intensive => intensité décroissante des cultures à mesure que l’on s’éloigne des villes.
La rente foncière : les exploitations agricoles les plus proches de la ville bénéficient de coûts de transport réduits => la rente foncière est maximum dans le 1er anneau concentrique et décline à mesure que la distance à la ville s’accroît. Elle tombe à 0 dans l’anneau extérieur, l’anneau marginal, aux frontières de la région. Hypothèse : fertilité identique.
En 1850, il formule avec 40 ans d’avance sur les néoclassiques une théorie de la répartition du revenu fondée sur la productivité marginale.
Le profit est maximal lorsque chaque facteur est utilisé jusqu’au point où sa productivité marginale en valeur est égale au coût marginal de ce facteur.
- l’utilisation de travail sur une terre doit continuer jusqu’à ce que le rendement supplémentaire obtenu grâce au dernier travailleur employé soit égal en valeur au salaire qu’il reçoit.
Autres apports :
- la productivité marginale d’un facteur est la dérivée partielle d’une fonction à plusieurs variables
- il distingue facteurs fixes et variables, rendement moyen et marginal
- il définit les quantités de facteurs (K, L, terre) en unités strictement homogènes
3) Hermann Heinrich Gossen
Son ouvrage publié en Allemagne en 1854 passa inaperçu.
- il a formulé le principe de l’utilité marginale décroissante et l’avait représenté graphiquement. Y compris une théorie de la désutilité marginale du travail.
- il a formulé une loi concernant la répartition optimale du budget du consommateur : un individu maximise son utilité quand il affecte son budget aux différents biens de façon à obtenir la même satisfaction du dernier euro dépensé à l’achat de chaque bien.
B – Les caractéristiques de la révolution marginalise :
les différences entre classiques et néoclassiques :
Terme néoclassique : La théorie marginaliste a des points communs avec les classiques : large adhésion au libéralisme, à la loi des débouchés, à la théorie quantitative de la monnaie.
Pourtant les fondateurs insistent sur leur opposition aux thèses classiques.
1- le centre d’intérêt :
Classiques : étude de l’évolution à long terme de l’économie, les causes de la croissance et de l’accumulation du capital, les facteurs susceptibles de l’affaiblir, cadre dynamique.
Néoclassiques : raisonnement à court terme, hypothèse d’une offre donnée de facteurs, cadre statique, analyse de la formation des prix, de l’affectation de ressources rares à usages alternatifs .
2 concepts deviennent centraux :
è Rareté : se dit de choses qui n’existent qu’en quantité limitée (« Elles n’existent pas en quantité telle que chacun de nous en trouve à sa portée à discrétion pour satisfaire entièrement le besoin qu’il en a » selon Walras). Elle signifie que les désirs de l’homme sont de loin supérieurs aux ressources existantes pour les satisfaire
è Equilibre : situation telle qu’aucune force n’est plus en œuvre pour modifier la situation dans un sens ou dans l’autre. Equilibre comptable (ventes = achats). Equilibre économique (les opérations effectivement réalisées sur le marché correspondent aux plans des agents, à ce qu’ils souhaitaient faire avant que les échanges n’aient lieu). « C’est un état de mobilité parfaite sans mouvement (…). La mobilité parfaite, qui a existé dans le passé, exclut le mouvement dans le présent ». (J.B. Clark).
Avec le marginalisme, le comportement économique est un comportement de maximisation ou de recherche d’un optimum. Le producteur veut maximiser son profit, le consommateur son utilité. è recours intensif aux mathématiques.
L’utilisation des mathématiques :
Classiques : Jusqu’alors les économistes avaient refusé l’usage des maths : par ex., pour Say, les valeurs matérielles dont traite l’économie « sont en même temps soumises à l’action des facultés, des besoins et de la volonté des hommes », et échappent dès lors « à toute espèce de fixation ».
Néoclassiques : entrée en force des maths dans la théorie économique. Utilisation des dérivées liée au calcul marginal. Ce recours aux maths résulte pour une large part de 2 causes :
- étude de comportements individuels de maximisation sous contrainte
- la fascination exercée par la mécanique et la physique et la volonté de copier leurs méthodes.
2- la théorie de la valeur :
Classiques : la valeur d’un bien est liée à la quantité de travail nécessaire à sa fabrication : c’est la théorie de la valeur travail. ou théorie objective de la valeur.
Néoclassiques : la valeur d’un bien est fonction de l’utilité attachée à ce bien : théorie de la valeur utilité ou théorie subjective de la valeur. La valeur d’un bien dépend de l’utilité marginale, c’est à dire l’utilité de la dernière unité consommée. L’utilité marginale est décroissante : un 1er verre d’eau est plus utile qu’un second, qui est plus utile qu’un 3ème, etc.
L’utilité marginale résume l’influence conjointe de l’utilité et de la rareté sur la valeur des biens. La valeur d’un verre d’eau est plus élevée dans le désert qu’à côté d’une fontaine.
Les auteurs précurseurs de la théorie subjective de la valeur :
L’abbé italien Galiani (1751) rejette l’idée de valeur intrinsèque, défendue par Cantillon et Petty. La valeur est subjective : elle se forme dans l’esprit des hommes, elle est relative, changeante, dépend des individus, du lieu, du temps.
Turgot : 1766
Il a lu Galiani. La valeur d’un bien dépend de l’aptitude du bien à satisfaire nos désirs, c’est à dire de son utilité et de sa rareté. Il parle de « valeur estimative » car elle représente « le degré d’estime que l’homme attache aux différents objets de ses désirs ».
L’échange augmente la richesse de chacun des coéchangistes car la chose acquise a une valeur estimative supérieure à la chose cédée (contrairement à ce que pensaient les Physiocrates).
Condillac : 1766
L’abbé de Condillac expose, plus nettement que Turgot, une théorie subjective de la valeur. La valeur d’une chose dépend de son utilité pour satisfaire un besoin ; elle dépend aussi de la rareté : le besoin que nous éprouvons d’une chose rare est plus intense car la crainte d’en être privé est plus vive. L’échange crée de la valeur car il permet de mieux satisfaire les besoins de chacun, donc il permet à chaque coéchangiste de faire un gain en utilité.
Say : 1803 :
La valeur d’une chose dépend de l’usage que l’on peut en faire, c’est à dire de son utilité. L’utilité est à la fois la condition de la création de la valeur et aussi sa mesure. Il rompt avec la conception « matérielle » de la richesse : la production de richesses n’est pas une création de choses matérielles mais une création d’utilité qui donne de la valeur aux choses matérielles.
Bentham : 1789.
Fondateur de l’utilitarisme. Utilité = niveau de bonheur qu’un individu obtient dans des circonstances données = mesure du bien être. Sa maximisation doit être l’objectif de toutes les actions, publiques ou privées ; il s’agit d’obtenir le maximum de plaisir et le minimum de peine. L’utilité doit être le principe guidant les hommes, remplaçant la respect de la tradition ou le bien. L’utilité peut être mesurée selon Bentham : la somme d’argent qu’un individu est disposé à payer pour se procurer un plaisir ou éviter une peine mesure ce plaisir et cette peine.
L’Etat doit intervenir afin d’assurer « le plus grand bonheur du plus grand nombre », par le biais d’une redistribution des richesses (revenu minimum, d’une taxe progressive que les héritages). Cette action augmenterait la somme de bonheur car les plaisirs procurés par des doses successives d’un même bien sont décroissantes ; en attribuant à un pauvre la dernière unité consommée par un riche, on augmente la satisfaction obtenue par l’ensemble des individus. Il comparait donc, sans employer le terme lui même, « l’utilité marginale » du bien pour le riche et pour le pauvre.
3- la vision de la société et la répartition du revenu national :
Classiques : société structurée en classes sociales (capitalistes, travailleurs, propriétaires fonciers) dont les intérêts ne sont pas identiques.
=> Il y a affrontement des classes pour se répartir le revenu national : image du gâteau à sa partager.
Néoclassiques : société composée d’individus souverains et rationnels effectuant des choix : travailler ou se reposer, consommer ou épargner, manger du pain ou de la brioche, etc. L’individu essaye de tirer le meilleur parti des ressources dont il dispose compte tenu de ses objectifs. Le marché est le lieu de rencontre de ces comportements individuels. Optique plus « pacifique », l’affrontement entre classes disparaît.
=> approche en termes de facteurs de production, chaque facteur de production (terre, travail, capital) reçoit une rémunération égale à sa productivité marginale. Cela amène les Néoclassiques à distinguer entrepreneurs et capitalistes alors que pour les Classiques l’entrepreneur et le capitaliste sont une seule et même personne. è schéma Boncoeur page 16.
- l’entrepreneur organise la production : il achète des facteurs (et vend des biens)
- le capitaliste apporte les capitaux : il loue des facteurs (et achète des biens)
Say utilise pour la 1ère fois le terme facteurs de production, il le range en 3 catégories : terre, travail, capital. Ces facteurs sont combinés en proportions variables pour donner la production. Chacun a un prix, respectivement la rente, le salaire et l’intérêt. Ces prix se fixent en fonction de l’offre et de la demande de chaque facteur.
Autre différence : la nature du capital :
Classiques : avance d’argent opérée par les capitalistes, avance qu’ils cherchent à faire fructifier
Néoclassiques : ensemble d’instruments de production définis de manière physique
C) Les causes de la révolution marginaliste :
1) Le produit de la révolution industrielle :
Le développement économique autorise de nouvelles préoccupations : la croissance est désormais assurée et les problèmes de stagnation à long terme ou de chômage technique disparaissent des préoccupations. Le développement économique autorise le choix du consommateur alors qu’auparavant le salaire de subsistance ne le permettait pas. Or c’est le consommateur, et non le capitaliste, qui est le personnage principal de l’économie néoclassique.
2) La réaction vis à vis du marxisme :
Au départ cette cause n’a pas joué. Le 1er livre du Capital parait en 1867. Les premiers travaux de Jevons datent de 1862. Il semble que les 3 auteurs ignoraient tout de l’œuvre de Marx. La réfutation du marxisme se manifestera plus tard, à partir des années 1890 : la théorie de la productivité marginale des facteurs permet de réfuter la théorie de la plus-value et donc le concept même d’exploitation de la force de travail.
3) La déclin de l’économie politique classique :
a- La perte d’influence de la théorie de la valeur travail :
Ricardo reconnaît lui-même que cette théorie est confrontée à des difficultés :
- pour produire il faut du travail mais aussi du capital sur lequel le capitaliste prélève un profit => la valeur d’échange ne dépend pas seulement du travail mais aussi du taux de profit
- vers la fin de sa vie, il reconnaissait que la valeur d’une bouteille de vin déposée dans une cave augmente sans que la quantité de travail ne soit modifiée
Symétriquement, entre 1850 et 1860, regain d’intérêt en Angleterre pour l’utilitarisme de Bentham.
b- Les faiblesses de la théorie classique du prix des facteurs :
Chez les Classiques, le prix des facteurs est expliqué par des théories différentes selon les facteurs : la rente de la terre est expliquée comme la différence par rapport aux coûts marginaux de culture, le salaire est expliqué par le coût des moyens de subsistance, le profit est considéré comme un résidu. Ainsi, dans le domaine de la répartition du revenu, la théorie de la valeur travail n’est utilisée que dans le cas du salaire. La rémunération de la terre et du capital est expliquée par des principes tout à fait différents de ceux utilisés pour rendre compte des prix des produits. Le courant marginaliste explique les prix des facteurs et les prix des produits à partir du même principe : les facteurs sont d’autant mieux rémunérés qu’ils sont rares et que les besoins des consommateurs en produits qu’ils permettent de produire sont grands.
Autre facteur : la professionnalisation de la discipline :
La révolution marginaliste intervient à un moment où l’activité d’économiste se professionnalise et s’organise. Création de chaires d’économie dans les universités (1870 à Lausanne, 1871 à Harvard), création d’associations de spécialistes (American Economic Association en 1885), multiplication des revues (Journal of Political Economy, AER). Ce mouvement accélère la diffusion des recherches à l’échelle internationale. Rapidement l’économie universitaire s’identifie un peu partout à la nouvelle théorie (à l’exception de la France).
Conclusion : la révolution marginaliste est un mouvement intérieur à la pensée, largement indépendant de l’environnement matériel. C’est une mutation qu’il faut se résoudre à qualifier de philosophique ou intellectuelle.
D) Les 3 grands courants du marginalisme :
On distingue 3 grands courants pendant la phase d’élaboration de son noyau central. Les divergences sont peut-être aussi importantes que les convergences.
1) L’école de Cambridge :
a) William Stanley Jevons (1835-1882) :
- Professeur à l’université de Manchester à partir de 1864.
- Publie en 1871 sa Théorie de l’économie politique
- Propose dès 1860 une théorie subjective de la valeur faisant appel au principe marginal :
- la valeur d’un bien est liée à son utilité (influence de Bentham)
- cette utilité est mesurable : le consommateur peut affecter à chaque quantité de bien achetée un nombre qui en mesure l’utilité
- l’utilité de la dernière unité consommée, ou « degré final d’utilité », décroît avec l’augmentation de la quantité consommée
- Partisan du recours aux mathématiques : « L’économie, si elle veut être une vraie science, doit être une science mathématique ».
- L’économie traite de quantités susceptibles de variations continues => calcul différentiel.
- Les économistes doivent formuler des relations mathématiques entre les grandeurs et les vérifier par les statistiques ; il développe la théorie des tâches solaires (1879), essayant de prouver l’existence d’une corrélation positive entre les éruptions solaires et les crises commerciales.
- La théorie de l’échange : soit deux échangistes, l’échange se poursuit tant que chacun considère la perte d’utilité résultant de la vente d’une unité comme inférieure au gain d’utilité résultant de l’acquisition d’une unité. C’est à dire tant que chacun peut accroître son utilité totale. En continuant l’échange, on abaisse l’utilité marginale du bien qu’on acquiert et on élève celle du bien qu’on vend. Au final, « le rapport d’échange de deux biens sera l’inverse de leurs utilités marginales » => un poulet a une utilité 5 fois > à 1 œuf è il faut 5 œufs pour obtenir 1 poulet.
- L’irlandais Francis Edgeworth (1845-1926) a complété en 1881 la théorie de l’échange de Jevons en proposant un instrument d’analyse graphique connu sous le nom de boite d’Edgeworth et a inventé la technique des courbes d’indifférence.
b) Alfred Marshall (1842-1924)
C’est le principal représentant de l’école de Cambridge. Il devient professeur à Cambridge en 1884 et publie en 1890 ses Principes d’Economie. Principaux apports :
- systématise la présentation graphique : courbes de demande et d’offre (rendements décroissants)
- distingue la courte période (offre donnée) et la longue période (offre peut s’adapter)
- développe la notion d’élasticité de la demande (introduite par Cournot)
- utilise la notion de surplus et la généralise (surplus du consommateur et du producteur)
- approche de l’équilibre partiel, qui consiste à étudier un marché particulier sous l’hypothèse « toutes choses étant égales par ailleurs ». On néglige les effets du marché étudié sur les autres marchés. Avantage : plus maniable et plus commode.
Keynes dira de lui : « Nous sommes tous les élèves de Marshall ». Il voyait dans son ouvrage, Principes d’économie, le début de « l’âge moderne de la science économique britannique ».
c) Arthur Pigou (1877-1959)
Il fut le maître de Cambridge entre 1920 et 1930. Publie L’économie du bien être (1920).
- Aspect hérétique : introduit la notion d’utilité sociale ; pour maximiser le bien être de la société, l’Etat doit redistribuer les revenus des riches vers les pauvres (même raison que Bentham) et instaurer des taxes et des subventions pour prendre en compte les externalités.
- Aspect conservateur : il est fidèle à la théorie néoclassique de l’emploi, la hausse des salaires va augmenter le chômage => vives critiques de Keynes.
2) L’école de Lausanne :
a) Léon Walras (1834-1910) :
- Professeur à Lausanne en 1870 (mal accepté en France car socialiste et utilise les maths)
- Publie ses Eléments d’économie politique pure en 1874 (traduit en anglais en 1950 par Hicks)
- Valeur : la valeur d’un bien dépend de la quantité du bien consommée précédemment, et aussi de la difficulté que l’on a à l’obtenir ; l’utilité marginale est appelée rareté par Walras.
- Partisan de l’utilisation des mathématiques, il veut faire de l’économie une science exacte au même titre que la physique ou la mécanique. Il considère Cournot comme un modèle.
Même conception de l’équilibre, vu comme un état de repos résultant de la neutralisation de forces opposées ; même conception du temps, dans laquelle les trajectoires des objets étudiés sont parfaitement déterminées à partir de la connaissance de leur loi de mouvement et de conditions initiales.
- Principal apport : théorie de l’équilibre général (1883).
- modèle mathématique fondé sur la confrontation O/D sur des marchés de CPP
- la variation des prix permet l’équilibre entre les quantités demandées et les quantités offertes sur tous les marchés. Il existe un système de prix qui engendre l’équilibre général.
- il y a détermination simultanée de l’ensemble des prix et des quantités
- l’allocation optimale des ressources est assurée : les facteurs de production sont rémunérés en fonction de leur productivité marginale et les consommateurs ont le maximum de satisfaction
- Walras précise que c’est un état idéal et non réel ; c’est ce vers quoi on tend s’il y a CPP.
- Il étudie la question de la justice sociale : il souhaite la concurrence pour développer la richesse et une certaine dose de socialisme pour rendre juste sa répartition. Walras était un socialiste convaincu. Il estime que les services publics doivent être assurés par l’Etat en raison de leur effet bénéfique sur la société (meilleure égalité des chances notamment), il est favorable à la nationalisation des monopoles privés (chemin de fer) pour éviter que les usagers ne paient un prix trop élevé, il est pour la nationalisation de la terre (avec indemnisation) de sorte que le paiement des fermages remplace l’impôt.
b) Vilfredo Pareto (1848-1923)
Il succède à WALRAS à la chaire d’économie politique de Lausanne
- il approfondit le modèle d’équilibre en introduisant la notion d’optimum qu’il définit comme la « situation dans laquelle on ne peut augmenter l’utilité d’un individu sans réduire celle d’un autre individu ». L’optimum est assuré par un système de CPP ; dans ce système, le prix de chaque bien exprime à la fois son utilité marginale et son coût marginal.
- Il est le 1er à développer une conception ordinale de l’utilité : l’individu n’est pas forcément capable de mesurer l’utilité mais il est capable de classer les objets par ordre de préférence
- Il crée le terme d’ophélimité pour désigner l’utilité subjective et éviter les confusions avec les divers sens du mot utilité. Ex : l’utilité du blé dépend de ses propriétés nutritives et ne varie pas. L’ophélimité du blé est plus élevée en période de famine que d’abondance. Les ophélimités individuelles ne sont pas comparables, chacun reste le meilleur connaisseur de sa situation personnelle.
c) Les continuateurs :
Ils n’appartiennent pas géographiquement à cette école, mais il s’en inspirent fortement. Ils ont tous les 3 obtenu le prix Nobel.
- Maurice Allais (1911) : l’équilibre général <=> optimum ; étude des comportements des individus en matière de risque (attitude la plus fréquente : l’aversion au risque).
- Kenneth Arrow (1921) et Gérard Debreu (1921-2004) vont montrer dans les années 1950 l’ensemble des conditions nécessaires à l’existence d’un équilibre général walrassien : outre la CPP, la valeur des offres et des demandes varie de façon continue, les individus disposent d’une dotation de survie, les rendements d’échelle sont décroissants
- Kenneth Arrow énonce le théorème d’impossibilité : il est impossible de construire de manière démocratique une fonction d’utilité collective à partir des préférences individuelles.
- 3) L’école de Vienne :
1ère génération : Carl Menger (1840-1921)
- Fondateur ; professeur d’économie à Vienne de 1873 à 1903, sénateur
- publie en 1871 Les fondements de l’économie politique
- Libéral : Notion d’ordre spontané, « l’ordre collectif est le résultat de l’action des hommes mais non de leurs desseins » (Ferguson). C’est sans le savoir ni le vouloir que les hommes contribuent à l’ordre collectif. Idée déjà présente dans la main invisible de Smith.
- Conception purement subjective de la valeur : la valeur ne réside pas dans les qualités intrinsèques du bien mais dans le degré de satisfaction que l’individu leur attribue. C’est une grandeur non mesurable. Elle varie d’un individu à l’autre à un instant donné, et varie pour un même individu selon le moment et les circonstances : un verre d’eau dans le désert a une utilité supérieure à un verre d’eau près d’une source => on ne peut comparer ni a fortiori ajouter les valeurs pour des individus différents. L’utilité marginale décroissante : Menger parle d’ « utilité limite ». On consomme les divers biens jusqu’à ce que les besoins soient satisfaits au même degré d’importance. Elaborée indépendamment de celle de Jevons, elle est identique sur le fond, mais l’accent est mis sur la dimension psychologique.
- Illusion mathématique :
- L’économie est une discipline radicalement différente de la physique. Chaque acte économique a un grand nombre d’effets et chaque phénomène économique concret résulte de la conjonction d’un grand nombre de causes indépendantes. Les lois économiques sont purement qualitatives et décrivent les effets d’une cause prise isolément. Les phénomènes concrets sont essentiellement imprévisibles. Le raisonnement mathématique leur est inapplicable.
- Les maths peuvent mesurer des grandeurs, mais ne peuvent pas saisir l’essence des phénomènes économiques ; les maths prennent mal en compte le temps, l’incertitude et les anticipations qui échappent à la formalisation.
- Adepte de l’individualisme méthodologique (il crée l’expression) :
- Le point de départ de l’analyse est l’individu, à la fois sujet et fin de l’activité économique, il existe préalablement à l’échange social. C’est un être doté de libre arbitre, de volonté et de raison, qui calcule comment arbitrer entre différents usages les ressources dont il dispose. C’est un homo oeconomicus.
- Subjectivisme : étant donné le caractère créateur de l’esprit humain et la liberté de décision des individus, on ne peut pas prévoir les conséquences futures des choix humains (‡ Walras : courant objectiviste : la société est une machine qu’un ingénieur pourrait piloter).:
- Il combat l’école historique allemande (Schmoller, Wagner, Brentano, Knapp) lors de la querelle des méthodes fin 19ème, dont le sujet principal était : l’économie est-elle une science ?
Schmoller critique les économistes britanniques « en chambre » :
- ils pratiquent des généralisations abusives et tirent des conclusions prématurées à partir d’un matériel quantitativement insuffisant => pas de lois économiques à validité universelle ; les lois économiques sont relatives à un contexte historique ou institutionnel.
- ils proposent de mettre plus de statistiques et d’histoire dans l’économie, l’économiste doit devenir un collecteur de données empiriques => annexion de l’économie par l’histoire
- on peut développer de nouvelles idées par l’analyse inductive mais pas déductive (le raisonnement logique ne peut être un instrument valable pour étudier les actions humaines).
- rejet du libéralisme, réformisme social
Menger lui reproche son empirisme : l’accumulation de faits historiques ne permet pas une meilleure compréhension des questions économiques.
- Il existe des lois économiques valables pour toute action humaine, indépendamment du lieu et de l’époque, des caractéristiques nationales. Rejet du concept d’économie nationale
- La démarche en sciences sociales doit être déductive et non inductive.
2ème génération : Von Wieser et Böhm-Bawerk.
- Friedrich Von Wieser (1851-1926)
Il succède à Menger comme professeur à Vienne. Il perfectionne la théorie de la valeur :
- il crée explicitement le concept d’utilité marginale (en 1904), elle est décroissante avec les quantités. L’utilité totale est la somme des utilités marginales successives, elle croît avec les quantités jusqu’à saturation. C’est l’utilité marginale qui détermine la valeur => les premières unités ne sont pas évaluées à leur valeur initiale mais à celle de la dernière unité.
- il applique la théorie subjective de la valeur aux facteurs de production : logique de productivité marginale des facteurs. La valeur des facteurs dépend de la valeur des biens qu’ils contribuent à produire. Mais ces facteurs ayant plusieurs usages possibles….
- il élabore la notion de coût d’opportunité = ce à quoi il faut renoncer pour obtenir quelque chose. Si j’achète un billet de train, je ne peux utiliser l’argent pour acheter un pantalon.
- Eugen Bohm-Bawerk (1851-1914)
Professeur et Ministre des Finances.
Anti-marxiste convaincu : il tente de montre la fausseté de la notion de plus value liée à l’exploitation ; il cherche à montre les contradictions de Marx sur la question de la transformation des valeurs en prix.
En 1888, il élabore une théorie du capital et de l’intérêt. Son apport : le capital doit être considéré comme un détour de production.
Hypothèses : il y a 2 moyens originels de production : la terre et le travail.
et 2 catégories de biens : les biens de consommation et les biens de production.
Exemple : un campagnard a besoin d’eau potable. La source jaillit à un certaine distance de sa maison. Il a plusieurs possibilités pour se procurer de l’eau :
- aller lui-même à la source et boire dans sa main : moyen le plus direct mais incommode car il doit aller à la source autant de fois qu’il a soif.
- Il creuse dans le bois un seau dans lequel il porte en une fois l’eau pour la journée. Pour cela, l’homme a du passer du temps à tailler le seau ; et pour pouvoir le tailler il a du auparavant abattre un arbre ; et pour pouvoir faire cela il a du d’abord fabriquer une scie ; et ainsi de suite.
- Il creuse un canal pour amener l’eau à sa maison. Ici le détour est encore plus considérable.
Produire de manière capitaliste, c’est choisir de produire d’abord des biens de production. Il y a allongement du processus de production. Cet allongement entraîne :
- un avantage, en termes d’accroissement de l’efficacité
- un coût, car la consommation est différée ; il est mesuré par le taux d’intérêt. Fondement de l’intérêt : les hommes accordent aux biens actuels une valeur plus grande qu’aux biens futurs. Pour 2 raisons :
- impatience à consommer : la consommation est plus agréable que pratiquer l’abstinence
- épargne => investissement => efficacité du capital futur => les biens seront moins rares dans le futur
La longueur des méthodes de production se traduit par la répartition des ressources entre la consommation et l’investissement. Ces ressources sont données => l’augmentation de la consommation se fait au détriment de l’investissement et vice versa.
Capital = ajournement de la consommation.
Capital = ensemble de biens immobilisés pendant un certain temps dans un détour de production.
Le taux d’intérêt est déterminé par le rendement marginal du détour de production le plus long qui fournit encore un profit.
Le capital est une perte initiale de temps (= détour de production) dont l’utilité est un gain futur en temps et en valeur. Il y a allongement du processus productif, multiplication des biens intermédiaires et hausse de la productivité des facteurs.
3ème génération : Von Mises et Von Hayek
Cf. L’école autrichienne.