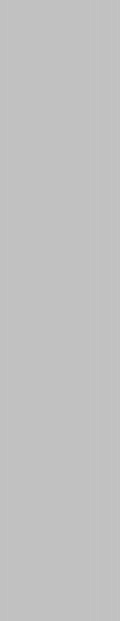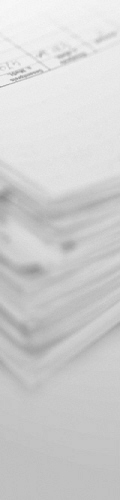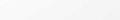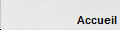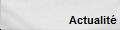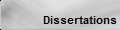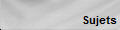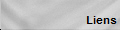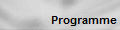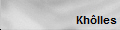Le modèle de l’accélérateur :
Appliqué parfois au seul investissement en stocks, il peut expliquer certaines variations de l’investissement global.
Albert Aftalion (1908) constate que les fluctuations de l’activité sont beaucoup plus fortes dans le secteur des biens de production que dans le secteur des biens de consommation.
J.M. Clark (1917) produit une étude sur les chemins de fer US. Les commandes de wagons dépendent de la variation du trafic ferroviaire (et non de son niveau) et elles la précèdent.
Ex récent : en France en 1988, hausse de 3.2% en volume de la consommation des ménages et de 9.6% de l’I.
Ce modèle dit que la variation de l’I résulte d’une variation de la demande de biens de consommation, elle-même corrélée à une variation du revenu national : DY è DD è DI.
Supposons qu’en période 1 la production (Y) soit de 100, et le stock de capital (K) de 200.
Coefficient de capital : k = K/Y = 200/100 = 2 => K = 2.Y
Supposons qu’en période 2 le demande augmente à 105, le capital nécessaire pour répondre à une production de 105 est : K = 2.105 = 210.
I = K2 – K1 = 210 – 200 = 10.
I = k. (D2 – D1). Ici, I = 2.(105 – 100) = 2.5 = 100
Soit It = k.(Dt – Dt-1)
Conditions :
- Le plein emploi des équipements : si une partie du capital est sous utilisée, une hausse de la demande ne suscite qu’une réactivation de cette partie du capital.
- La stabilité du coefficient de capital K/Y : toute hausse de la production doit entraîner une hausse proportionnelle du capital. => absence de progrès technique.
- Amortissement du capital constant : si une machine a une durée de vie de 10 ans, chaque année 1/10ème de sa valeur est amorti. Le mécanisme de l’accélérateur ne s’applique pas aux dépenses de remplacement mais uniquement à l’I net.
- Les branches de biens d’équipement peuvent produire de manière illimitée. Pas de rationnement de la demande de biens d’I.
- Les entreprises n’ont aucune contrainte financière pour financer leur I.
Mécanisme de l’accélération :
D : demande de biens de consommation (= production)
K : stock de capital, proportionnel à la production : K = 5.Y ; ici production = demande.
Ir : I de remplacement, égal à 1/10ème de la valeur du capital initial
Ii : I induit par la relation d’accélération, Ii = 5. DD.
Le principe d’accélération – John Maurice CLARK (1917)
| Période | Demande | Stock de capital | Ir | Ii | I total | Taux de variation de la demande | Taux de variation de l’I |
| 1 | 100 | 500 | 50 | - | 50 | - | - |
| 2 | 120 | 600 | 50 | 100 | 150 | +20% | +200% |
| 3 | 130 | 650 | 50 | 50 | 100 | +8.3% | -33% |
| 4 | 130 | 650 | 50 | 0 | 50 | 0 | -50% |
| 5 | 120 | 600 | 50 | -50 | 0 | -7.6% | -100% |
De la période 1 à la période 2 : D è I plus que proportionnelle.
De la période 2 à la période 3 : ralentissement de la D è ¯ I.
De la période 3 à la période 4 : stagnation de la D è ¯ I (qui tombe au niveau de l’Ir)
De la période 4 à la période 5 : baisse de la D è ¯ I qui peut aller au désinvestissement. Ce dernier n'a pas lieu en pratique, les firmes se contentent de ne pas remplacer le capital usagé.
Intérêts :
Les variations de I manifestent une grande plus grande instabilité que les variations de la demande qui les ont induites.
Les faits qui corroborent l’accélérateur : en France :
- de 1953 à 1973, forte croissance de la demande et la FBCF augmente de 8% par an
- de 1973 à 1979, la croissance ralentit, la FBCF augmente de 4,6% par an
- de 1979 à 1983, la croissance ralentit encore, la FBCF augmente de 3,6% par an
- après 1974, la demande augmente de manière plus faible et plus irrégulière => I aussi.
Limites :
- le coefficient de capital n’est pas stable : substitution K/L, économies d’échelle.
- l’existence de capacités de production inemployées : en période de reprise, les firmes peuvent accroître leur production sans investir. Par exemple, le taux d’utilisation des capacités de production évolue entre 80% et 88% de 1987 à 1995.
- Les variations à la hausse ou à la baisse de la demande n’ont pas des effets symétriques : toute baisse de la demande devrait conduire à un désinvestissement. Ce dernier est en fait limité au non remplacement du capital usagé. Quand la baisse de la demande est très forte, il n’y a pas apparition d’un capital oisif.
- Il n’existe pas un coefficient d’accélérateur global mais des coefficients sectoriels.
- Présence de goulets d’étranglement dans les secteurs produisant les équipements : ex du Front populaire avec la loi des 40 heures.
- La présence d’irréversibilité en matière d’I soulignée par Arrow (1968) : il existe une asymétrie entre le coût de l’I et les recettes du désinvestissement : décote sur le marché de l’occasion, coût de la formation du personnel et de l’installation d’un nouveau processus industriel, coût du démantèlement. => coût de l’I >> recettes du désinvestissement. L’entrepreneur cherche à s’assurer du caractère durable des débouchés avant de prendre sa décision => l’I se fait tardivement et par paliers.
Accélérateur flexible de Koyck :
Il fait intervenir des effets de retardements.
I est une fonction croissante de la production, et une fonction décroissante du stock de capital. It = a.k.Yt – a.Kt-1.
Cas où la demande finale croît à un taux décroissant :
- accélérateur simple : I net décroît
- accélérateur flexible : I net s’accroît pendant plusieurs périodes jusqu’à ce que l’effet de freinage exercé par le stock de K compense l’effet d’impulsion des accroissements de D.
La surcapitalisation chez F. Von Hayek Prix et production, 1931.
Résumé :
La marche normale de l'économie est l'équilibre, le cycle traduit une perturbation. Le crédit est l'élément perturbateur.
Il arrive que le taux d'intérêt baisse en dessous de son taux naturel, c'est-à-dire celui qui égalise la demande et l'offre issue de l'épargne volontaire,
Cette baisse des taux peut avoir 2 causes : une hausse de la préférence pour le futur (hausse de l'épargne) et une hausse de la création monétaire.
Dans les 2 cas, les entreprises augmentent leurs investissements. Le cycle est engendré si c'est la 2ème cause qui joue. Quand cette production arrive sur le marché elle ne correspond pas à une consommation supplémentaire. La crise commence.
Explication :
L'économie est divisée en 2 secteurs : les biens de consommation et les biens de production, ces derniers constituant un détour de production. La répartition entre les 2 secteurs représente la structure de production. Cette structure peut se déformer selon 2 scénarios, la variation de l'épargne ou la variation de la quantité de monnaie. Mais ces 2 scénarios ne sont pas équivalents, le premier type de déformation de structure de production est durable car il résulte d'un nouveau comportement des épargnants alors que le second est provisoire.
1- Hausse de l'épargne
Elle entraîne une baisse de la consommation et une hausse de l'investissement.
La production est plus capitalistique, le détour de production s'allonge (Böhm-Bawerk).
Le prix relatif des biens de production / biens de consommation augmente
- baisse de la marge bénéficiaire des producteurs de biens de consommation
- ces producteurs déplacent une partie de leurs facteurs de production vers la production de biens de production
- l'offre accrue de biens de production correspond à une hausse de la demande ; de la même manière il y a baisse de l'offre et la demande de biens de consommation
- après une première modification, les prix relatifs se stabilisent
- la déformation de la structure de production est durable, l'économie n'est pas en crise
2- Hausse de la masse monétaire
L'abondance monétaire pousse les entreprises à investir. La production devient plus capitalistique, le détour de production s'allonge. L'offre de biens de consommation a diminué alors que la demande de biens de consommation est restée la même.
- pénurie des biens de consommation
- hausse du prix relatif des biens de consommation
- incitation à utiliser des méthodes moins capitalistiques
- ceux qui avaient accru leurs équipements sont en surcapacité, la surcapitalisation survient. Il s'agit d'un surinvestissement = investissements qui s'avèrent non rentables
- l'économie produit trop de biens de production et pas assez de biens de consommation
- quand la production arrive sur le marché elle ne correspond pas à une consommation équivalente ; la crise commence
Conclusion :
Pour Hayek, une baisse du taux d'intérêt sans origine réelle - c'est-à-dire sans hausse de l'épargne - signifie qu'un signal erroné est envoyé aux entrepreneurs. Or les mauvais signaux entraînent de mauvaises décisions.
Cf. la politique de bas taux d'intérêt de la FED après le e-krach au début des années 2000 qui a inondé le monde en liquidités et favorisé la bulle immobilière qui a commencé à éclater aux USA en 2007.
Portée et limites de l'analyse marxiste de la crise du dernier quart du 20ème siècle.
Quelques repères :
* Baran et Sweezy : le capitalisme monopoliste (1966)
Au concept de plus-value de Marx, ils proposent de lui substituer celui de surplus, défini comme la différence entre ce que produit une économie et ce que coûte cette production. Le développement du capitalisme, dans lequel une poignée d'entreprises géantes dominent l'économie et fixent leurs prix, entraîne non pas la baisse du profit mais la hausse du surplus que l'économie ne parvient pas à absorber. Telle est la racine de la stagnation. Moyens d'absorber ce surplus : les efforts de publicité, les dépenses gouvernementales en particulier militaires liées à l'extension de l'impérialisme.
* Boccara : Théorie du capitalisme monopoliste d'Etat (1974)
Le capitalisme se heurte à une crise de suraccumulation c'est-à-dire d'excédent de capital par rapport à la masse des profits, freinant la croissance et développant le chômage. Cette crise se manifeste dès la fin des années 1960. L'action de l'Etat consiste à dévaloriser certains capitaux afin de rétablir le taux de profit. Cette intervention prend diverses formes : financement public privilégié, nationalisation, transfert au privé d'entreprises ou de secteurs redevenus rentables.
* Le Pors : Les béquilles du capital (1977)
Si les marxistes s'opposent à la privatisation des profits, ils s'opposent aussi à la socialisation des pertes. Les subventions sont un moyen utilisé par les grandes entreprises pour lutter contre la baisse tendancielle du taux de profit. Ex : aides à la sidérurgie, au textile, aux chantiers navals en France dans les années 1970. Un remake de l'Etat au service de la grande bourgeoisie.
* Mandel (1982) : La crise doit s'analyser dans le cadre des ondes longues : le déclin et la restauration des taux de profit sont le moteur des cycles longs.
Portée :
- la vision de long terme de la crise : c'est une crise structurelle et non pas une récession banale un peu plus accentuée que les autres, elle représente un tournant historique dans l'évolution du capitalisme. Or aussi bien les monétaristes que les keynésiens ont tendance à considérer que l'économie est une machine dont le régime s'accélère ou se ralentit périodiquement, selon un cycle déterminé. Pour les marxistes les crises sont inévitables pour purger l'économie et restaurer les profits.
- l'explication de la crise : la crise ne résident provient pas de facteurs exogènes (cartel de l'OPEP, erreurs de politique économique) mais de la baisse tendancielle du taux de profit (BTTP). Le boom économique entraîne une hausse des salaires (tensions sur le marché du travail) supérieure aux gains de productivité (pénurie de matières premières), donc une baisse des profits. De plus, l'intensification dans l'utilisation du capital en raison de la concurrence (les NPIA) favorise la baisse du taux de profit.
- l'analyse des politiques menées : pour lutter contre le BTTP, les gouvernements versent des subventions aux grandes entreprises (cf. l'aide de l'Etat français à Alstom en 2003) et pratiquent des politiques de rigueur afin de restaurer la part des profits dans la valeur ajoutée : Cf. la désindexation des salaires sur les prix (France, 1982). Ils vont même jusqu'à nationaliser des banques, ce qui revient à socialiser les pertes. En outre, le chômage (l'armée de réserve industrielle) pèse sur les salaires.
- la vision internationale du fonctionnement du capitalisme : le capital est apatride (poids accru des FMN, DIPP), internationalisation du capital (flux de devises, de capitaux à court et long terme en expansion).
Limites :
- pas de paupérisation absolue, ni même relative
- déclin numérique de la classe ouvrière alors que Marx avait prédit son ascension par l'intégration des commerçants, artisans, petits agriculteurs
- pas de BTTP : les profits des entreprises ont été restaurés dans la décennie 1980
- pas de tendance inéluctable à la concentration des entreprises : cf. l'essor des PME depuis le début des années 1980, elles sont à l'origine de la majorité des emplois créés
- mouvement massif de privatisation et d'arrêt des subventions dans le monde entier à partir des années 1980 : cela infirme l'idée de l'Etat-béquille
- effondrement des pays à économie centralisée et retour à la croissance dans les pays les plus libéraux (USA, GB, Australie, Nouvelle Zélande, Irlande)
- développement accéléré des pays pauvres qui se sont insérés dans les échanges internationaux, ce qui infirme la thèse de l'échange inégal
La crise des années 1930
Première partie : les causes et la période HOOVER
Seconde partie : la période ROOSEVELT