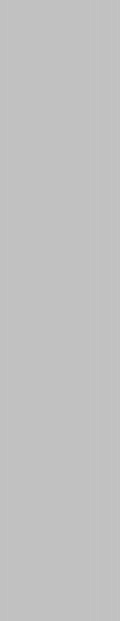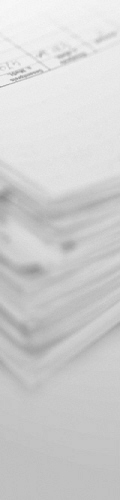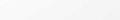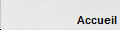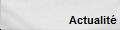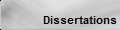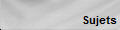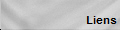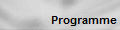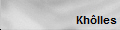La réflexion économique est déjà présente chez les philosophes grecs (Platon, Aristote), les philosophes du Moyen Age (Saint Thomas d’Aquin). La pensée économique se développe au fur et à mesure que de nouveaux problèmes économiques se posent : gestion des exploitations agricoles, financement des dépenses de l’Etat, réglementation du commerce et des échanges.
Renaissance : formation et développement des Etats, la richesse est nécessaire à l’accroissement du pouvoir du prince. Les mercantilistes cherchent à accroître la quantité de métal précieux du souverain.
A) Le mercantilisme : l’économie au service du pouvoir
Antoine de Montchrestien, Traité de l’Economie politique, 1616.
Idées principales :
- on ne peut séparer l’économie du politique
- importance du commerce (supérieur à l’industrie car le commerce est le but et le débouché de toutes les activités)
- l’Etat doit stimuler la production et les échanges pour accroître les richesses
La richesse d’une nation est liée à la possession de métaux précieux => importance d’une balance commerciale excédentaire. => recherche de débouchés accrus pour les entreprises
Tout le monde trouve avantage à augmenter le stock de métaux précieux : l’Etat développe son armée, l’abondance monétaire rend plus facile le financement des opérations industrielles et commerciales des marchands.
Politique économique mercantiliste :
- interdiction de sortie des matières premières nécessaires à l’industrie nationale
- protectionnisme (sauf pour les produits nécessaires à l’industrie nationale)
- réserver le commerce aux nationaux pour empêcher que les étrangers ne fassent sortir l’or
- promotion des exportations (conquête de marchés grâce à l’appui de l’Etat comme les marchés coloniaux).
- création de manufactures d’Etat (Colbert)
Apparaît l’idée nouvelle selon laquelle un ordre naturel gouverne l’ensemble de la vie économique. Cette rupture ne s’opère pas d’un coup. Une importante contribution fut celle de Boiguilbert (1707). Il montre que les mercantilistes confondent richesse et trésor. Or la richesse est fonction de la production. Il convient donc de favoriser l’augmentation de la production, et notamment agricole. Il propose d’abolir les entraves au commerce. Il s’ensuit un équilibre naturel qui permet à chaque producteur de vendre sa production et de produire un maximum. Les diverses professions d’un pays de servent de débouchés mutuels.
B) Les physiocrates : le circuit économique et la primauté de l’agriculture
Au 18ème, l’économie française est à 75% agricole. Les problèmes économiques d’alors sont liés à l’agriculture : disettes, jacqueries, problème du prix du blé, libre circulation des grains.
François Quesnay (1694-1774) connaît l’agriculture : il est le fils d’un petit propriétaire foncier. Il étudie la médecine et s'installe comme médecin à Mantes la Jolie. Remarqué dans la profession, il est nommé médecin du Roi en 1748.En 1757, il participe aux travaux de l’Encyclopédie, écrivant les articles sur les grains et les fermiers. Il réunit autour de lui des hommes qui s’intéressent à l’économie : Turgot, Dupont de Nemours, Mercier de la Rivière, Mirabeau ; c’est le groupe des physiocrates dont Quesnay est le chef de file.
Physiocratie = « gouvernement de la nature ». Cette doctrine vient des mots phusis, qui signifie nature, et kratos, qui signifie force, « l’ordre naturel ». 2 propositions :
1ère proposition : il existe un ordre naturel à partir duquel les hommes et les choses s’organisent, comme « les abeilles se soumettent d’un commun accord et dans leur propre intérêt à l’organisation de la ruche » (Dupont de Nemours). Cet ordre naturel est gouverné par des lois ; il existe des lois en économie comme il en existe en physique. Cet ordre naturel repose sur le principe fondamental de la propriété privée (foncière), source majeure de la prospérité.
2ème proposition : le devoir des hommes est de se soumettre à ces lois => le moins possible d’interventions du gouvernement => libéralisme.
Contexte de l’époque : forte réglementation
- monopoles royaux
- interdiction ou limitation de certaines cultures (vigne dans certaines régions)
- barrières douanières intérieures (droits de péage, droits de marché)
- défense de vendre avant la récolte, de conserver, sauf pour la consommation personnelle, des blés de plus de 2 ans, de hausser les prix dès que ceux-ci étaient déclarés
- autorisation pour vendre les grains, interdiction de toute association tendant à l’accaparement
Or cette réglementation ne permet pas, bien au contraire, de supprimer les famines.
Proposition principale ( mercantilistes) : libre circulation des grains.
Bases de l’analyse des Physiocrates :
- le pays est divisé en 3 classes : les propriétaires fonciers, la classe productive (fermiers) et la classe stérile (artisans, commerçants, professions libérales, fonctionnaires, soldats).
- Seule l’agriculture est productive parce qu’elle est la seule capable de créer un produit net qui revient aux propriétaires fonciers. Les activités stériles produisent certes des marchandises mais elles n’ajoutent rien à ce qu’elles ont coûté.
L’agriculture a pour vertu naturelle de multiplier : on récolte plus que ce qu’on sème. Ce n’est le cas des autres secteurs : « Un champ produit chaque année des fruits ; il n’en est pas de même d’une mine ; elle ne produit point de fruits ; elle est elle-même le fruit à recueillir » (Turgot). Les artisans ne font que modifier, mélanger, additionner des matières premières.
Sur la question de la création de valeur, ils ont dons une conception très limitée. Ils sous-estiment l’importance des activités non agricoles.
- Importance du capital : appelé ici « avances ». L’agriculteur dispose d’avances, c’est à dire de sommes d’argent avancées à chaque période pour se procurer les moyens de production (semences, engrais, animaux de trait, frais de main d’oeuvre) nécessaires à la création du produit net.
- Plaidoyer en faveur du libre échange : rupture aussi bien avec les mercantilistes et qu’avec toute la tradition médiévale qui préconisait le stockage des grains, la restriction à l’exportation, l’objectif étant de disposer de réserves de grains en permanence au prix le plus faible possible.
liberté du commerce permet l’obtention d’un « bon prix » ce qui augmente les recettes des fermiers ainsi que les profits et la rente, d’où une hausse des dépenses, une augmentation du capital investi dans l’agriculture, et in fine la prospérité. On est dans une logique de circuit.
- 1ère tentative pour donner une représentation chiffrée de l’économie. Le tableau économique de la France, publié par Quesnay en 1758 est la première représentation quantifiée d’une économie nationale dont on retrace les flux. Des biens et services circulent entre ces 3 classes et, à ces courants, correspondent des courants monétaires de sens contraire. Il repose sur une vision d’interdépendance, de circuit : pour que le système fonctionne, il faut que la vente des produits permette de reconstituer les capitaux ; il faut donc que les revenus tirés de la production soient dépensés. Cela annonce la comptabilité nationale contemporaine.
Le circuit économique (tableau de 1766) : (cf. photocopie, Bénard)
Flux réels : schéma A
Avance de la classe productive 3 = 2 de produits agricoles (semences, engrais, biens de subsistance pour les agriculteurs) et 1 de matériel. Il faut donc qu’il existe au départ un stock de richesse qui a été accumulé et qui peut être avancé par les propriétaires fonciers.
Production de 5. 1 est vendue aux propriétaires fonciers et 2 à la classe stérile (1 correspondant aux matières premières, 1 aux produits agricoles nécessaires à l’alimentation de cette classe).. Reste à la classe productive 2 + 1 de matériel acheté à la classe stérile pour remplacer le capital fixe utilisé. Les avances ont été reconstituées.
Flux monétaires : schéma B
- La classe productive : elle a 2 unités monétaires au départ. Le produit net = 5 – 3 = 2. Il est versé en monnaie aux propriétaires fonciers sous forme de rente.
- Les propriétaires fonciers : ils perçoivent 2 de rente. Dépense : 1 achats de produits agricoles + 1 achats de produits manufacturés.
- La classe stérile : elle dispose d’1 unité monétaire. Elle vend des produits manufacturés pour une valeur de 2 (1 à chacune des classes) et achète pour 2 à la classe productive. Elle récupère son unité monétaire de départ tandis que la classe productive en récupère 2.
Le circuit se répète à un niveau identique : il n’y a pas de croissance du produit. Nous avons une circulation fermée : l’argent et les biens circulent dans l’économie comme le sang dans le corps humain.
| Agriculteurs | Propriétaires fonciers | Classe stérile |
| Production = 5 | Rente = 2 | Production = 2 |
| Reconstitution capital circulant = 2 Reconstitution capital fixe = 1 | Achat produits agricoles = 1 Achat à la classe stérile = 1 | Achat produits alimentaires = 1 Achat matières premières = 1 |
| Produit net = 2 | Il ne reste rien | Il ne reste rien |
Influence :
Mouvement d’aspiration à la liberté : les réglementations d’Ancien Régime sont ressenties de plus en plus comme des entraves par la bourgeoisie naissante. Vincent de Gournay (1712-1759), négociant et intendant prononça la célèbre phrase : « Laissez faire, laissez passer les hommes et les marchandises ». L’auteur de la phrase n’est pas connu avec certitude ; Le Gendre avait écrit à Colbert : « Laissez nous faire » et le Comte d’Albon « Laissez les faire ».
Leurs idées ont exercé une grande influence à la fin du 18ème :
- liberté du commerce : suppression des douanes intérieures, édit royal de 1764 autorisant l’exportation des grains, rétablissement de la liberté du commerce des grains par Turgot en 1774-1776.
- suppression des corporations de métier
- système fiscal de la Révolution française fondé sur l’impôt foncier.