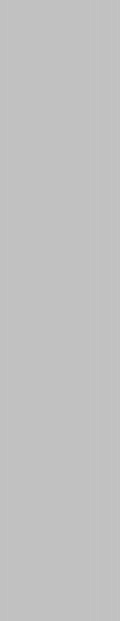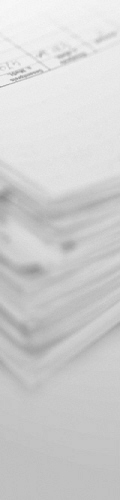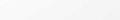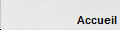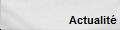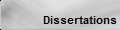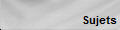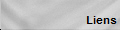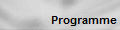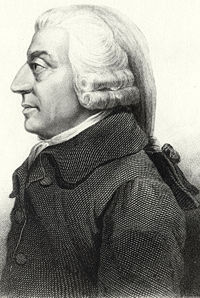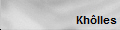1. « L'économie est l'allocation des ressources entre des fins et des moyens qui ont des usages mutuellement exclusifs » L. Robbins (1932)
2. « L'économie est l'étude de l'être humain dans les affaires ordinaires de la vie examinant cette partie de la vie individuelle et sociale qui a trait à l'acquisition et à l'utilisation des choses matérielles nécessaires au bien être » A. Marshall (1890)
3. « L'économie politique, considérée comme une branche des connaissances du législateur et de l'homme d'Etat, se propose deux objets distincts: le premier, de procurer au peuple un revenu ou une subsistance abondante; le second objet est de fournir à l'Etat ou à la communauté un revenu suffisant pour le service public: elle se propose d'enrichir à la fois le peuple et le souverain ». A. Smith (1776)
4. « L'économie politique est l'étude des lois qui président à la formation, à la distribution et à la consommation des richesses" J.B.Say (1803) ou encore "L'économie politique n'est pas autre chose que l'économie de la société. Les sociétés politiques, que nous nommons des nations, sont des corps vivants, de même que le corps humain. Elles ne subsistent, elles ne vivent que par le jeu des parties dont elle se composent, comme le corps de l'individu ne subsiste que par l'action de ses organes. L'étude que l'on a faite de la nature et des fonctions du corps humain; a créé un ensemble de notions, une science à laquelle on a donné le nom de physiologie. L'étude que l'on a faite de la nature et des fonctions des différentes parties du corps social, a créé un ensemble de notions, une science à laquelle on a donné le nom d'Economie politique, et que l'on aurait peut-être mieux fait de nommer Economie sociale » J.B. Say (1852)
5. « L’économie est plus proche de la science des contrats que de la science des choix. Le principe de maximisation doit être remplacé par celui de l’arbitre qui s’efforce de résoudre des conflits entre individus (...) avec pour principe unificateur les gains de l’échange » J. Buchanan (1975)
6. " L'économie est l'étude de la manière dont les sociétés utilisent des ressources rares pour produire des marchandises ayant une valeur et pour les répartir entre une multitude d'individus". P. A. Samuelson (1995)
7. « L'approche économique est un outil d'analyse d'une grande portée applicable à tous les comportements humains, que ces comportements impliquent des prix monétaires ou non, des décisions fréquentes et répétées ou, au contraire, rarissimes, des décisions importantes ou mineures, des fins mécaniques, ou émotionnelles, des personnes riches ou pauvres, des adultes ou des enfants, des personnes stupides ou intelligentes, des médecins ou des malades, des hommes politiques ou d'affaires, des enseignants ou des étudiants. » G. Becker (1976)
1) L'individualisme méthodologique
Les économistes s'intéressent au comportement des groupes et à leurs valeurs, aux institutions et règles de conduite, à partir des comportements individuels. Seuls les individus agissent. C'est ce que l'on appelle dans le jargon des épistémologues l’individualisme méthodologique.
L'individualisme méthodologique consiste à expliquer les phénomènes économiques et sociaux seulement à partir des actions, réactions et interactions entre les individus qui composent la société.
On entend trop souvent des expressions comme : « La France envoie ses porte-avions au large du détroit d'Ormuz pour protéger ses intérêts dans la région du Golfe persique. »
C'est une métaphore organiciste.
Si cette expression constituent un moyen économique de dire que certains individus prennent les décisions, il est inutile de faire de fausses querelles à ce propos. En revanche, si cela signifie que la société, le marché, le gouvernement ou la France ont un comportement propre et indépendant des individus qui les composent, alors là les choses sont différentes. Comment un groupe en tant que groupe peut-il agir ? Quel peut être le comportement propre d'un groupe, si ce n'est le comportement des membres qui composent ce groupe ? Comment une société peut-elle avoir des valeurs ou des préférences indépendamment des membres qui la constituent? Les concepts holistes imprègnent le discours ambiant et sont une source permanente d'erreur de raisonnement.
ATTENTION
Le mot organisation diffère du mot organiciste. Il diffère aussi du mot institution. Une organisation est une manière de combiner les parties d'un tout pour remplir certaines fonctions. Les organisations sont souvent le produit intentionnel de comportements humains. Une institution est un ensemble de règles de coopération qui permet aux individus de survivre mieux ensemble que pris séparément. Les institutions sont souvent le produit non intentionnel de comportements humains.
L'individualisme méthodologique est un principe fondamental qui s'oppose au holisme. Les sociologues ont pris très exactement le contre-pied des économistes. Or il est parfaitement concevable que des gens, professeurs d'économie, adoptent la façon de penser des sociologues, comme on observe des sociologues adopter la façon de penser des économistes !
Il n'y a aucune raison de s'alarmer d'une telle opposition. Les biologistes étudient bien les sociétés animales et humaines du seul point de vue du gène égoïste qui utiliserait le corps humain comme un moyen pour se survivre. Ils n'hésitent pas à expliquer le vivant à partir des gènes et du principe de sélection naturelle où gènes "égoïste" et/ ou "altruiste" se propagent pour maintenir une certaine organisation de la vie, y compris dans les sociétés animales ou humaines. Ils pratiquent ainsi une forme d'individualisme méthodologique! Par opposition d'autres biologistes prônent un organicisme dur. Ils vont jusqu'à considérer, tel James Lovelock, la Terre, "Gaia" ou la biosphère comme un organisme vivant, où l'homme est un "parasite" vivant en symbiose avec elle. D'autres, moins organicistes, insistent sur le caractère "holiste" de la vie où le "tout " ne peut se réduire aux parties. Ce type de débat n'est pas propre aux économistes ni aux sociologues. Une chose, au moins, est certaine : le dialogue entre les tenants du holisme et de l'individualisme méthodologique en économie comme en sociologie ou dans les autres disciplines n'est pas facile.
2) Logique de l'action humaine et comportement rationnel
L'individualisme méthodologique est une méthode d’approche partagée par différents chercheurs dans différentes disciplines (sociologie, biologie, psychologie.); cependant, les économistes vont plus loin. L'individu ne se borne pas à s'agiter comme un atome ou des molécules dépourvus d'intention. Il agit. Il a des projets et choisit les moyens nécessaires pour atteindre ses fins. On peut reprendre l’argument de Von Mises (1966) :
« L'homme qui agit désire fermement substituer un état de choses plus satisfaisant à un moins satisfaisant. Son esprit imagine des conditions qui lui conviendront mieux, et son action a pour but de produire l'état souhaité. Le mobile qui pousse l'homme est toujours quelque sensation de gêne. Un homme parfaitement satisfait de son état n'aurait rien qui le pousse à changer. Mais pour faire agir un homme, une gêne et l'image d'un état plus satisfaisant ne sont pas à elles seules suffisantes. Une troisième condition est requise : l'idée d'une conduite adéquate sera capable d'écarter, ou au moins de réduire la gêne ressentie. »
3) La coordination des plans individuels
Les individus poursuivent leurs propres fins de façon rationnelle et établissent des plans pour les réaliser. Si les résultats des actions qu'ils entreprennent sont cohérents avec leurs attentes ou leurs anticipations, cela signifie que les anticipations des individus se sont réalisées. D'une certaine manière, leurs plans sont coordonnés et compatibles entre eux. Mais par quel miracle les plans des individus peuvent-ils être compatibles s'ils poursuivent des fins différentes et entrent en rivalité pour utiliser des moyens seulement disponibles en quantités limitées? C'est le problème fondamental de la coordination des plans individuels ou de l'équilibre économique ou encore de l'ordre social.
Une variété d'institutions ou d’organisations a émergé spontanément de l'interaction individuelle pour résoudre ce problème de coordination. L'une de ces institutions est le marché. La coutume, le droit, la morale, la famille traditionnelle, la firme, voire l'État en sont d'autres.
Le marché est fondé sur les droits de propriété privée, l'échange volontaire, la monnaie et sur une variété de pratiques contractuelles. Cette institution a émergé comme le produit non attendu de l'interaction sociale et rend compatibles les plans des individus sans qu'aucune autorité n'intervienne. C'est le théorème de la main invisible de A. Smith (1776), père fondateur de l'analyse économique, qui, le premier, a exposé de façon systématique le fonctionnement du marché comme un ordre social spontané. Cet ordre spontané est engendré par :
« la propension qu’ont les individus à troquer ou échanger entre eux une chose contre une autre »
et par le fait que :
« Ce n'est pas de l'altruisme du boucher, du brasseur ou du boulanger, que nous attendons notre repas, mais de l'attention qu'ils accordent à leur propre intérêt. Nous nous adressons, non pas à leur sentiment d'humanité, mais à leur égoïsme, et on ne leur parle jamais de nos besoins mais des avantages qu'on va leurs procurer ».
On remarquera que cette approche ne repose pas sur la rationalité individuelle mais sur la propension qu’ont les individus à échanger et sur leur égoïsme.
Cette tradition de l'ordre spontané dans les sciences sociales remonte à des écrits antérieurs tels ceux de Molina ou de Mandeville. Ces écrits ont permis l'émergence de ce que l'on appelle la philosophie des «lumières écossaises» avec des auteurs comme A. Ferguson, le juriste et économiste A. Smith ou des philosophes comme D. Hume, ou J. Locke . L'intuition d'un ordre spontané résultat de l'action humaine mais non des desseins humains est révolutionnaire. Les développements ultérieurs de cette tradition se retrouvent chez des auteurs comme C. Menger, K. Popper, M. Polanyi ou le prix Nobel F. Hayek.
4) L'amoralisme
Du fait même de l'existence séparée de chaque individu, il est difficile à l'économiste de porter un jugement de valeur sur ces fins multiples et subjectives. Il les considère donc souvent comme données et il les traite de manière égale. En cela, l'économiste est méthodologiquement amoral.
Ainsi, l'activité d'un criminel ou d'un homme politique est analysée comme celle d'un offreur de travail ordinaire qui maximise sa satisfaction en arbitrant entre loisirs et consommation. Le drogué, le paysan spécialisé dans la production de drogue et le dealer sont considérés de la même manière que de simples consommateurs, producteurs ou intermédiaires.
Quand un économiste affirme que le contrôle des loyers et le revenu minimum entraînent des effets pervers et accroissent le nombre de mal-logés et de pauvres, il ne dit pas que c'est bien ou mal. L'intention de ceux qui veulent contrôler les loyers et instaurer le revenu minimum est peut-être tout simplement de protéger certains électeurs ou présupposés tels sachant très bien qu’une telle réglementation se fera au détriment d’autres électeurs : les pauvres et ceux qui cherchent à se loger et qui ne trouveront pas de logements par suite de ces prix planchers ou plafonds.
Il ne faut cependant pas confondre cet amoralisme avec l'idée erronée que le raisonnement économique est éthiquement neutre.
En effet, postuler que les individus poursuivent leur intérêt personnel et qu’ils sont poussés par leur nature à échanger une chose contre une autre ou qu’ils sont rationnels dans leurs actions implique des jugements de valeur sur la façon dont se conduisent les individus en société. L'économiste évite de faire interférer ses propres jugements de valeur, en tant qu'individu, avec ceux des autres individus dont il observe et analyse le comportement.
5) L'abstraction
L'économiste pratique l'abstraction. En effet, compte tenu de la formidable complexité des phénomènes il émet des hypothèses qui, souvent, n'ont aucun lien apparent avec la réalité. L'abstraction est l'instrument traditionnel de l'analyse scientifique. Ce n'est pas la philosophie de la diminution ou du réductionnisme ni des mathématiques ou de la logique, qui sont des instruments de cohérence de la pensée. Le cerveau humain ne peut appréhender dans sa totalité la complexité des phénomènes sociaux et en déduire des éléments significatifs. C'est donc en séparant, dans la masse d'informations qui nous parvient, ce qui constitue l'essentiel de l'accessoire que l'on améliore sa connaissance du monde. La théorie économique est abstraite, mais c'est parce qu'elle l'est que sa puissance d'explication et de conviction en est multipliée.
6) Le souci de tester les théories contre des faits
Enfin, l'économiste teste ses théories ou plus exactement, il s'efforce d'apporter à l'appui de son argumentation des preuves empiriques. Celles-ci proviennent de diverses sources : statistiques, expérimentales, économétriques, historiques ou liées à des expériences individuelles.
Adam Smith
(1723 - 1790)
1.3. Une discussion : l'hypothèse de rationalité
Les économistes postulent un comportement rationnel chez les individus; or on observe des comportements irrationnels. Faut-il donc rejeter le postulat fondamental des économistes sur la seule base d'une vérification empirique ?
On peut dénombrer sept attitudes possibles par rapport à cette discussion :
1) rejet de l'hypothèse d'un comportement rationnel pour une autre ne faisant pas appel à la rationalité individuelle,
2) modification de l'hypothèse de rationalité individuelle pour une autre plus conforme à la réalité telle quelle est perçue par le sens commun,
3) contestation de l'argument selon lequel une théorie devrait être testée par le réalisme de ses hypothèses et la tester par ses conclusions,
4) faire l'hypothèse contraire, postuler l'irrationalité, et vérifier si les prédictions que l'on en tire sont fausses,
5 ) contester les faits observés (ceux-ci contredisent-ils vraiment l'hypothèse de rationalité ?),
6) savoir si le comportement rationnel est une hypothèse et non pas une conclusion,
7) enfin, contester le principe de réfutabilité comme critère ultime de vérité d'un argument.
1- Nombre d'économistes rejettent l'hypothèse de rationalité comme principe fondamental d'explication du comportement humain, même dans les affaires économiques, commerciales ou financières. Ils font reposer le comportement individuel sur des normes sociales, rejetant en même temps l'individualisme méthodologique. Par exemple, le choix d'acheter un Jeans ne reposerait pas sur une comparaison entre le prix relatif d'un Jeans et d'un pantalon de velours, compte tenu d'une contrainte de budget, mais sur le fait que presque tout le monde porte des Jeans et qu'il est difficile d'échapper à cette emprise des autres si ne pas porter de Jeans vous exclut du groupe social dans lequel vous évoluez. Bien qu'il soit possible, comme l'a fait le prix Nobel G. Becker, d'expliquer ce phénomène simplement en supposant que l'individu maximise non pas l'utilité qu'il tire des biens ou services qu'il achète mais l'utilité qu'il tire du fait que les autres approuvent son comportement c'est le premier axe décrit plus haut.
2- Une autre attitude consiste à prendre acte de l'écart entre le comportement supposé rationnel des individus et leur comportement réel. On attribue cette différence à des "inerties" à des "gaspillages" ou bien à des défauts consécutifs à un manque de motivations, d'efforts ou de perception de la part de l'individu. Les économistes sont alors priés d'abandonner partiellement le postulat d'un comportement rationnel de la part des agents économiques ou sociaux au profit d'autres types de comportements d'une rationalité limitée sans toutefois abandonner l'individualisme méthodologique. C'est le deuxième axe. Un des tenants de cette approche est le prix Nobel H. Simon (1978). Il soutient que notre capacité à comparer les alternatives et à faire des choix est limitée par les processus cognitifs eux-mêmes. En effet, les décisions sont prises à partir d'un ensemble d'alternatives locales, souvent spécifiques, mais aussi de façon séquentielle. L'impossibilité pour un cerveau de capter l'ensemble des informations nécessaires à une prise de décision " rationnelle" entraîne que l'ensemble des alternatives considérées sont limitées. Par ailleurs, la nature séquentielle des choix introduit un problème d'"agenda": certaines décisions induisent des phénomènes irréversibles et excluent quasiment de l'ensemble des choix un grand nombre d'alternatives. Or, les psychologues montrent que l'instinct ou l'émotion impose très souvent un ordre de priorité dans les décisions. Si nous ne sommes pas limitées par notre cerveau, en revanche, nous sommes peut être limités par la nature même de l'incertitude qui environne toute décision. Ainsi I.Kirzner (1997) souligne le caractère complexe des informations nécessaires à une prise d'une décision " rationnelle" du fait même de la nature radicale de l'incertitude qui environne la décision. Celle-ci limite toute tentative de comportement rationnel, puisque même les informations les plus simples doivent être perçues, découvertes ou créées. Rechercher des informations qui existent au préalable mais qu'il est très coûteux de faire apparaître parce qu'elles sont en grand nombre et complexes n'est pas la même chose que de découvrir ou créer des informations qui n'existent peut être pas.
3- L'idée qu'une hypothèse doit être vraie, réaliste ou en accord avec les observations pour juger de la validité d'une théorie n'est pas une condition nécessaire, ni suffisante. Même si l'hypothèse n'est pas observable, cela ne signifie pas que l'on doive la rejeter, et avec elle l'argumentation et les conclusions que l'on en tire. Le caractère abstrait et non observable de la rationalité individuelle implique nécessairement de juger de la validité de l'argumentation par la fausseté des conclusions. L'analyse de la rationalité individuelle devient alors un postulat fondamental qu'il appartient à la philosophie de discuter mais dont les résultats justifient la valeur! Le prix Nobel M. Friedman (1953) adopte cette attitude, à l'instar de Freud, vis-à-vis de l'existence d'un inconscient. Cette manière de réagir immunise l'hypothèse de rationalité de ses détracteurs. C'est le troisième axe.
4- Une autre attitude consiste à postuler l'irrationalité des individus. Quelles conclusions tire-t-on de cette hypothèse de comportement ? Si celles-ci sont fausses, on peut alors affirmer que la négation de l'hypothèse d'irrationalité est vraie ! C'est un quatrième axe de recherche.
En fait, il n'a pas été exploré de manière systématique. Mais Becker n'hésitait pas, dans un texte écrit en 1962 et qui est passé relativement inaperçu, à s'engager sur cette piste. Il faisait remarquer que les comportements aléatoires ou coutumiers sont parfaitement compatibles avec la loi de la demande, l'une des lois jugées comme des plus fondamentales en économie. Quand le revenu augmente, les individus augmentent leur consommation de tous les biens. Quand le prix relatif d'un bien augmente, ils réduisent les quantités consommées de ce bien
De nombreuses années plus tard, Kagel et al.(1981) ont testé le comportement rationnel des rats et des pigeons. Ils ont constaté que leurs comportements satisfaisaient aux lois de la demande. Cette expérimentation est intéressante. En effet, si les animaux et les êtres humains réagissent de la même manière alors que l'on sait qu'a priori l'homme a une capacité à la rationalité supérieure à celle des animaux, l'argumentation de Becker se trouve être vérifiée expérimentalement. Le principe de rareté permet bien d'engendrer des comportements de demande ayant les propriétés habituelles.
Le paradoxe ici n'est pas que des individus "irrationnels" ou des animaux se comportent comme s'ils étaient rationnels, mais que les économistes auraient depuis longtemps abandonné toute référence à la rationalité s'il était vraiment possible de fonder le raisonnement économique sur le seul principe de rareté en présence de comportements aussi simples que ceux décrits par des choix aléatoires, impulsifs ou coutumiers.
5- Admettons l'observabilité du comportement rationnel. Comment peut-on dire que l'observation d'un comportement impulsif ou coutumier est le résultat d'un comportement irrationnel et non pas d'un comportement rationnel ? Au lieu de prendre acte de l'écart entre un comportement rationnel présumé et un comportement réel irrationnel, puis d'accepter la fausseté de cette hypothèse et de faire appel à une rationalité limitée pour l'expliquer, on adopte une autre approche. La théorie économique ne souffrirait pas d'un trop-plein de rationalité mais bien au contraire d'un manque ! Il faut pousser aussi loin qu'on le peut l'hypothèse de rationalité. Si prendre une décision nécessite les ressources de l'individu (et en particulier ses capacités à être rationnel) et si celles-ci ne peuvent être mobilisées sans coût, il existe un montant optimal de rationalité. Il est naturel d'observer des comportements irrationnels. Cette observation ne contredit pas l'hypothèse de rationalité mais la renforce si le coût d'être rationnel est positif.
On peut citer L. Robbins à l'appui de cette argumentation
"Il peut être irrationnel…d'être parfaitement conséquent [dans ses choix] quand on compare les marchandises, précisément parce qu'il vaut mieux( dans l'opinion du sujet économique concerné) dépenser autrement le temps et l'attention que nécessitent des comparaisons exactes de cette sorte. En d'autres termes, il peut y avoir un coût d'opportunité de l'arbitrage interne qui, passé un certain point, est nettement supérieur au gain qu'on peut escompter"
On comprend aisément pourquoi, par exemple, il n'est pas rationnel de s'informer sur toutes les alternatives possibles ou imaginables (c'est-à-dire susceptible d'apparaître dans un avenir plus ou moins proche). D'une part, cette comparaison épuiserait rapidement toutes les ressources de l'individu, et d'autre part, elle nécessiterait de retarder la décision (peut-être indéfiniment). Or, ce retard a un coût : se priver des gains procurés par un choix effectif. Ainsi, une attente trop longue ou une prolongation de la prospection ou de l'expérimentation des alternatives éliminerait la rentabilité de la décision elle-même. L'ignorance devient rationnelle.
Prenons une expérience simple, à votre portée, pour illustrer ce point : les bals annuels des "Corpos" de sciences économiques ou de médecine ou des grandes écoles. Pour passer une bonne soirée, c'est-à-dire pour danser tout au long de la nuit avec une jolie fille (si vous êtes une fille, mettez-vous à la place du garçon, même si dans cette expérience, vous avez déjà appris que les rôles ne sont pas interchangeables), il vous faudra utiliser une partie de votre temps pour inspecter, expérimenter et évaluer les participantes à ce bal. Si vous arrivez vers 22 heures, au moment de la pleine affluence au bal et si vos parents vous ont laissé quartier libre jusqu'à 3 heures du matin, vous disposez de 5 heures pour danser et faire la conquête de vos rêves.
Prenons maintenant un étudiant de sciences économiques, un de ces étudiants comme on en voit encore parfois, studieux et désireux d'appliquer ce qu'il a appris de la rationalité" économique. Il commencera, avant de faire son choix, par comparer toutes les alternatives. Il dansera donc avec toutes les jeunes filles présentes au bal. Une technique simple consiste à inviter à chaque danse une nouvelle partenaire en démarrant le tour des tables par la gauche ou la droite selon le degré d'encombrement de la salle. A trois minutes par danse, s'il y a une centaine de participantes, il lui faudra 5 heures pour comparer les alternatives. Il ne lui reste alors plus de temps pour, d'une part, décider, parmi les jeunes filles testées, celle qu'il juge la plus jolie, et d'autre part, la retrouver, l'inviter à danser et lui plaire, car il sera temps de rentrer sagement chez ses parents ! Cet étudiant a eu un comportement hyper rationnel. C'est cela qui est irrationnel.
Heureusement, les étudiants moins studieux sont plus malins. Ils ne procèdent pas ainsi. Ils attendent au bord de la piste une ou plusieurs danses avant de se lancer. En effet, ils commencent par écarter de leur choix toutes les jeunes filles qui font tapisserie, pour éviter de perdre du temps avec elles. Si elles n'ont pas été choisies par leurs camarades et rivaux, arrivés plus tôt, c'est qu'il y a vraisemblablement des raisons.
Ensuite, ils examinent avec soin parmi les jolies filles, celles qui dansent le mieux (ou parmi celles qui dansent le mieux, les plus jolies, les deux ensembles ne se recouvrent pas). Une fois repérées celles-ci, ils ne leur restent plus qu'à s'inscrire sur leurs carnets de bals ou à faire le siège de leurs tables. Le tout ne leur prendra pas plus d'une heure. Il est vrai que la décision de danser n'est pas unilatérale et même l'habitué peut se voir opposer un ou plusieurs refus. Pour éviter cette douloureuse épreuve, il est parfois prudent de venir avec une amie quitte à la laisser pour aller danser avec une autre, plus à votre goût, si vous savez en saisir l'opportunité.
En général, le nombre et la nature des alternatives sur lesquelles portent les choix sont limités volontairement, Ce nombre varie d'un individu à l'autre, selon l'aptitude de chacun à saisir les opportunités de profits ou d'utilité dus à l'incertitude et à utiliser les techniques existantes les plus efficaces pour faire un choix.
D'une façon vraisemblablement fréquente, l'individu peut trouver rationnel de ne pas s'informer sur les alternatives. Il choisira au hasard ou sous l'influence d'un stimuli quelconque (comportement impulsif) ou bien il reconduira les choix faits à une période précédente (habitude) ou il imitera le choix d'un autre individu (conformisme).
Le montant optimal de rationalité s'obtient lorsque le gain marginal de la comparabilité des alternatives et de la cohérence des choix est juste égal à son coût marginal. Or égaliser le coût marginal de l'information ou de la cohérence des choix avec son gain marginal n'est-ce pas déjà faire preuve d'un comportement rationnel ? Comment ce minimum de rationalité est-il déterminé ? Tout comportement irrationnel peut-il être déclaré rationnel par le simple postulat de l'existence de coûts qui n'ont pas été pris en compte par l'observateur ?
La première remarque est tout à fait fondée. Les économistes qui adoptent cette attitude font l'hypothèse que tous les individus concernés sont au départ dotés d'une capacité à arrêter leurs actions quand le coût de celle-ci excède le gain attendu ou bien à la poursuivre quand le gain attendu est supérieur à son coût (il existe donc un montant déterminé de rationalité a priori dans un sens très différent de celui que nous avons énoncé : la capacité à saisir une opportunité de profit ou à éviter des coûts en excès de ce qu'ils rapportent), mais ce n'est pas parce qu'ils en sont dotés que l'on observera de leur part un comportement qui consiste à appliquer cette règle. L'autre remarque est tout aussi pertinente. Si l'on peut toujours interpréter n'importe quel comportement comme "rationnel", le concept de rationalité devient purement tautologique. Ce n'est pas le cas. En effet, si les coûts (resp. les gains) pour comparer les alternatives ou être cohérent dans les choix augmentent (resp. diminuent), on devrait observer des comportements de plus en plus irrationnels. C'est cette prédiction sur les processus de décisions eux-mêmes qui ne rend pas tautologique cet argument. Si les coûts pour être rationnel excèdent les gains et que l'individu a un comportement rationnel, alors le concept de rationalité est réfuté. L'individu est irrationnel au sens où il ne saisit pas une opportunité de profit nets des coûts en connaissance de cause.
Poussons l'argumentation plus loin. Imaginez que vous vouliez réfuter cette hypothèse en vous comportant de manière irrationnelle, c'est-à-dire en refusant de saisir une opportunité de profit quand elle se présente. En effet, vous êtes libre de ne pas être rationnel. Mais cette liberté a un coût d'opportunité. Plus ce coût d'opportunité augmente, moins vraisemblablement vous adopterez cette attitude consistant à vouloir réfuter l'hypothèse de rationalité en vous comportant de manière irrationnelle.
6 - Le comportement rationnel ou d'optimisation n'est pas une prémisse de la théorie économique même si on le présente souvent comme tel. Il est le produit d'une structure d'interaction qui sélectionne le comportement rationnel parce que celui-ci procure des gains qu'aucun autre comportement ne permet d'obtenir ! C'est le cinquième axe. Si les rendements attendus d'un comportement rationnel n'excèdent pas les coûts des investissements faits pour l'être, ce comportement ne se développera pas Comme les coûts et les gains diffèrent d'un individu à un autre ou d'une décision à l'autre, l'économiste ne s'attend pas à observer systématiquement un tel comportement chez les acteurs économiques pour toutes les décisions qu'ils sont amenés à prendre. Il peut même être avantageux de demander à d'autres d'exercer cette activité à sa place.
Une demande potentielle de décisions rationnelles par l'individu sera alors une source de profit pour des entrepreneurs capables de produire les services demandés. Un marché de la comparabilité des alternatives et de la cohérence des choix se développera. Il sera d'autant plus important que le coût d'une erreur de décision ou d'un choix passionnel ou non rationnel est élevé. Il en est ainsi du choix d'un conjoint, d'un emploi, d'un appartement, d'une carrière professionnelle ou d'un prêt, etc. Le développement des agences matrimoniales ou des agences immobilières ou des banques, c'est-à-dire des intermédiaires en général qui rapprochent les offres des demandes, permettent entre autre aux individus de comparer les alternatives à un moindre coût. Le développement des contrats, des droits et toutes les institutions qui vendent l'art et la manière de maîtriser son corps et son esprit offrent aux individus l'opportunité de se prémunir contre leurs propres faiblesses et de maintenir une certaine cohérence dans leur choix.
Le développement extraordinaire du commerce, la complexité croissante des produits ou des alternatives existantes, l'allongement de la durée de la vie humaine et l'accroissement phénoménal de la richesse rendent les erreurs de décision extrêmement coûteuses en termes d'alternatives perdues qui avec l'irréversibilité du temps, deviendront rapidement inaccessibles. La demande d'un comportement rationnel s'en trouve considérablement accrue. La rationalité est un comportement demandé et offert dans nos sociétés de marchés concurrentiels.
En réalité comme le souligne Hayek (1973) :
"Le comportement rationnel n'est pas une prémisse de la théorie économique, bien qu'on présente souvent la chose ainsi. La thèse fondamentale de la théorie est au contraire que la concurrence est ce qui oblige les gens à agir rationnellement pour pouvoir subsister. Elle se fonde non pas sur la supposition que la plupart des participants au marché, ou même tous, sont rationnels mais au contraire sur l'idée que ce sera généralement à travers la concurrence qu'un petit nombre d'individus relativement plus rationnels mettront les autres dans la nécessité de devenir leurs émules en vue de prévaloir. Dans une société où un comportement rationnel confère à l'individu un avantage, des méthodes rationnelles seront progressivement élaborées et se répandront par imitation. A quoi bon être plus rationnel que le reste, si l'on ne vous laisse pas tirer un bénéfice de l'être ?"
7- Dans toutes ces attitudes, il y a la reconnaissance implicite que l'on doit juger de la validité d'une argumentation en référence à l'observation de faits. Toute proposition non réfutable ou logiquement irréfutable est jugée comme conventionnelle et arbitraire, donc comme non scientifique. Elle est alors disqualifiée par ce fait même. Un argument ou une théorie devrait être réfutable pour qu'on lui accorde le label de scientifique. Il va de soi que ce critère, pour rejeter un argument comme vrai ou faux, n'a rien de scientifique. Il s'agit d'une proposition normative et non d'une proposition testable ! Cette définition de la science est donc purement arbitraire. Ne nous laissons pas impressionner par un critère de validité que les scientifiques ne s'appliquent pas à eux-mêmes. En effet, les êtres humains disposent d'un libre arbitre. Ils sont rationnels. C'est bien ce qui différencie l'homme de l'animal. La rationalité n'est pas une hypothèse à tester, puisqu'en faisant le test, l'homme applique et utilise un comportement rationnel. La rationalité est constitutive de l'être humain.
Il n'est pas possible en sciences de la nature d'observer directement les éléments de base de l'interprétation théorique, tels les molécules ou les atomes. En revanche, en sciences humaines, les éléments de base de l'interprétation théorique, les individus et leurs désirs, sont de nature directement empirique. Les hommes, par l'introspection, ont une connaissance directe de leurs désirs et projets. Ils peuvent comparer ces projets et être cohérents dans leur choix s'ils le désirent. Mais ils peuvent, aussi, ne pas l'être. La rationalité individuelle n'est donc pas une hypothèse au sens où on l'entend habituellement c'est- à- dire une supposition qu'il faudrait accepter ou rejeter, c'est une certitude, une évidence, un axiome. C'est le dernier et septième axe, défendu notamment par Ludwig Von Mises.
III - Les notions clés du raisonnement économique
IV - Les sophismes
Les sophismes ont souvent une apparence logique, mais sont conçus, intentionnellement ou non, pour induire en erreur. Les scientifiques, les journalistes, les hommes politiques, les artistes, les critiques, qui s’affrontent dans les débats d’idées, usent abondamment de ces figures de rhétorique. Il faut donc les connaître pour ne pas en être victime et pour, à votre tour, piéger vos adversaires.