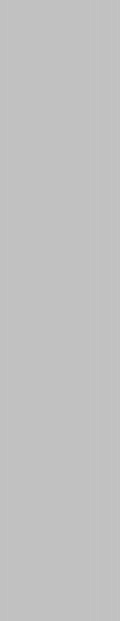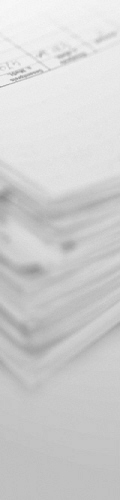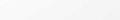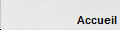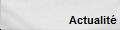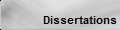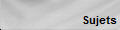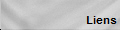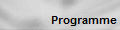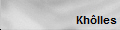Bill Bonner est un auteur de livres et d’articles économiques et financiers ; il est le fondateur et le président de La Chronique Agora, il écrit régulièrement dans MoneyWeek, le blog LewRockwell.com et The Daily Reckoning. Avec Addison Wiggin, ils ont déjà publié ensemble un livre en 2004 L’inéluctable faillite de l’économie américaine.
Dans ce livre dense de 408 pages, Bill Bonner et son acolyte montrent que l’Empire américain, après avoir connu ses heures de gloire, est en phase de déclin avancé, croulant sous les dettes.
Un tel sujet pourrait à priori paraître rébarbatif, mais la lecture est un véritable plaisir en raison d’un langage simple, d’un ton direct et d’un style élégant. Et d’une culture phénoménale : le livre, conçu comme une véritable saga, est bourré de références historiques, théoriques, politiques, statistiques et même religieuses. En plus Bill Bonner possède un humour décapant hors du commun. Lire le livre de Bill, c’est que du bonheur !
Bill Bonner est un mélange de conservateur et d’anarchiste dans des proportions restant à définir. Conservateur car Bonner apprécie les vielles choses, les vielles idées, les vielles règles et les vieux investisseurs, la sagesse qui vient avec l’âge. Il commence son livre par une citation de Chesterton : « La tradition, c’est la démocratie des morts ». Il mobilise intensément l’histoire, ce qui contraste avec la période actuelle dans laquelle l’histoire ancienne, c’est ce qui s’est passé la semaine dernière. Anarchiste car Bonner n’apprécie guère l’intervention de l’Etat dans les affaires de ce monde. Il appuie ses raisonnements sur des économistes de renom tels Gordon Tullock, Murray Rothbard, Jude Wanniski, Hayek, et les auteurs du Mises Institute.
Le livre est divisé en 4 grandes parties. Pour venir à bout de sa démonstration sur le déclin inéluctable de l’empire américain sous le poids de la dette, il démonte au gré des pages certains lieux communs tels que : on peut obtenir quelque chose pour rien, les prix de l’immobilier ne baissent jamais, on peut s’enrichir en dépensant, épargner est sans intérêt, les déficits n’ont pas d’importance, les étrangers financeront toujours nos dettes.
I. Imperia absurda
Qu’est-ce qu’un empire ? Il a une patrie mais aussi des Etats soumis, des protectorats, des colonies, des satellites, des Etats clients. Comment un pays devient-il un empire ? La question n’a jamais été posée aux citoyens, Aucun débat n’a eu lieu sur ce sujet, aucun référendum national n’a été organisé. En revanche, les empires ont besoin d’ennemis, de guerres. On trouve toujours un ennemi : le communisme, le terrorisme. Les médias diffusent et suscitent la peur pour justifier la guerre. Le bâtisseur d’empire moderne croit avoir pour devoir de rendre le monde meilleur et doit pour cela dicter leur conduite aux autres. Pour cela, il ne s’embarrasse pas du respect des règles constitutionnelles. Truman a ainsi engagé en juin 1950 les USA dans une guerre contre la Corée sans l’autorisation du Congrès alors que la Constitution stipule le contraire. Idem pour les guerres en Irak et en Afghanistan. A mesure que l’empire grandit, la pouvoir exécutif devient hypertrophié.
L’histoire des différents empires ayant existé et de leur fin est riche d’enseignements. Dans l’empire romain, Auguste et Néron allégèrent la quantité de métal dans les pièces, et vers 472 à la chute de l’empire romain le denier romain ne contenait plus que 0,02% d’argent. L’empire espagnol démontre que l’argent facile peut ruiner un pays, cela tue le sens du travail et génère de l’inflation, crée un déficit commercial ; quand les mines du Nouveau Monde furent épuisées, le gouvernement espagnol fut dans l’incapacité de rembourser ses emprunts. L’empire austro-hongrois s’est terminé par l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand et la Première Guerre mondiale. L’empire français a laissé à la France une population d’immigrés africains pesant lourd aujourd’hui sur le budget social. L’idée de fin de l’histoire de Fukuyama est une sottise car les empires naissent et doivent mourir un jour.
L’exemple de l’Italie est également riche d’enseignements sur les relations entre système politique, dette et empire : de 1859 à 1925, la centralisation politique de l’Italie coïncida avec l’apparition de déficits publics et l’augmentation de la dette. Malgré les promesses d’assainissement des finances, l’endettement ne cessa de grimper et les dépenses militaires augmentèrent. Les dépenses militaires et la conquête de nouveaux territoires (l’Abyssinie en 1936) permettent de détourner l’attention du peuple et d’accroitre les dépenses publiques. Comme de nombreux néoconservateurs américains, Mussolini était un ancien gauchiste qui avait su réussir, il accéda au pouvoir en 1921, promettant de réduire la dette, et l’augmentant en fait.
Selon Bonner, « Tout empire nait dans le mensonge, tourne à la farce et s’achève par un désastre ». Certains pensent cependant que la globalisation ne peut prospérer que sous la protection d’une armada impériale, comme celle de la Grande Bretagne au 19ème siècle, celle des USA au 20ème siècle. Deepak Lal, président de la Société du Mont Pèlerin de 2008 à 2010, fait lui l’éloge des empires : ils apporteraient la stabilité en créant un grand espace économique et favoriseraient la division du travail. Mais alors pourquoi la Suisse qui n’a jamais véritablement fait partie d’un empire est-elle aussi riche ?
Grace à la pax dollarium impériale, les USA assurent un service de protection, permettant la prospérité des échanges. Mais cette protection coute cher : depuis 1945, les USA ont lancé onze campagnes militaires et les dépenses militaires américaines sont plus élevées que celles additionnées de tous les autres pays. Mais au lieu de se faire payer pour la protection qu’elle leur assure, l’Amérique emprunte de l’argent à ses partenaires. « Qualifier l’Amérique de super-puissance n’est que flatterie. Dans cet étrange empire, ce sont les Etats soumis qui contrôlent l’Amérique : ils peuvent cesser de payer leur tribut quand bon leur semble ». Les rôles sont inversés, ce sont les Etats périphériques qui contrôlent l’Amérique. Dans la guerre en Irak, les USA n’ont obtenu aucun butin, en revanche ils envoient des ingénieurs, des médecins, de la nourriture, des administrateurs pour un coût hebdomadaire de 1 milliard de dollars.
Floyd Norris explique ainsi le fonctionnement actuel de l’économie mondiale : la Chine exporte massivement, avec l’argent gagné elle achète des bons du Trésor, ce qui contribue au maintien de faibles taux aux USA, stimule la consommation et permet aux Américains d’acheter plus aux Chinois. La boucle est bouclée. Mais dans cette boucle, la Chine est en position de force car elle augmente sa capacité de production alors que les ménages américains s’appauvrissent et dépendent de plus en plus des capitaux étrangers.
II. Woodrow franchit le Rubicon
Lincoln, Wilson et Roosevelt sont considérés par la plupart des historiens comme de grands présidents alors que leur interventionniste a été particulièrement néfaste. Bonner préfère au contraire les présidents qui ne font rien comme Harding au début des années 1920.
Wilson est le plus néfaste de tous. C’est depuis sa présidence que l’empire américain existe. Il se disait investi d’une mission divine. En 1914, il voulut renverser le gouvernement de Huerta au Mexique, au motif qu’il ne lui plaisait pas et fit bombarder Veracruz sans le vote du Congrès, croyant savoir mieux que les Mexicains eux-mêmes qui devait diriger le pays. Ce qui suscita une hostilité générale à l’égard des USA en Amérique latine.
Mais sa pire décision fut l’entrée des USA dans la Première Guerre mondiale. En 1917, il fit entrer les USA en guerre contre l’Allemagne. Wilson justifia l’entrée en guerre des USA en 1917 par la défense des grands principes. « C’est un privilège pour l’Amérique que de donner son sang et d’utiliser sa force pour défendre les principes qui lui donnèrent la vie et lui offrirent la paix et le bonheur », c'est-à-dire de faire la guerre au nom de la paix. Pourtant les Allemands ne s’appétaient pas à franchir l’Atlantique pour attaquer l’Oncle Sam. Plus tard, Johnson puis Nixon entonneront les mêmes refrains pour justifier la guerre. Et puis à l’époque il y avait cette idée que la guerre était bonne pour l’esprit et pour l’économie, la guerre était presque exaltante. La guerre plait aussi aux hommes politiques car elle leur permet d’étendre leur pouvoir et d’entonner des discours grandiloquents.
La première guerre mondiale transforma l’Amérique en un empire. Une fois en guerre, un pays adopte rapidement de nombreuses caractéristiques du système socialiste telles que le rationnement, la censure, la planification, le contrôle des prix, la hausse de la fiscalité. Pourquoi intervenir avec les Anglais et contre les Allemands ? Peut-être parce les USA avaient prêté 100 fois plus aux premiers qu’aux seconds. D’ailleurs on peut affirmer que les USA, en finançant la guerre de 1914-1918, ont empêché une résolution précoce du conflit. Une hystérie antiallemande se leva comme par hasard dans tout les USA. « Les gens trouvent plus simple de mourir que de réfléchir, c’est sans doute mieux ainsi ».
La démocratie est-elle un rempart contre l’impérialisme et la guerre ? Elle n’est pas plus pacifique que les autres formes de gouvernement. D’ailleurs si la démocratie était aussi bonne que cela, pourquoi les gens ont-ils toléré d’autres formes de gouvernement depuis tant de siècles ? La démocratie se révèle souvent incompatible avec la sécurité des personnes ou le droit de propriété, la majorité y opprime l’individu, et elle force le contribuable pacificiste à payer le coût d’une guerre. La force de la démocratie est qu’elle surpasse les monarchies ou les dictatures dans le domaine de l’appropriation des ressources des citoyens, elle leur prend beaucoup mais rarement trop (comme en URSS) : il s’agit de maximiser le volume total de richesses dans lesquelles l’Etat peut puiser. De toute façon, les déclarations de guerre sont rarement soumises au vote populaire : « La démocratie, c’est très joli, tant qu’elle vous mène où vous souhaitez aller » écrit Bonner.
Les pères fondateurs des USA l’avaient compris. Ils avaient établi une Constitution pour remédier aux turbulences et aux excès de la démocratie. James Madison écrivit : « Les démocraties ont toujours été des spectacles de turbulence et de rivalités ; elles se sont toujours révélées incompatibles avec la sécurité des personnes ou le droit à la propriété ; et elles ont eu en général une vie aussi courte que leur mort a été violente ». Le problème avec la démocratie c’est que le moindre imbécile a le droit de donner son avis alors que les morts sont tenus à l’écart.
Aujourd’hui, l’Amérique est dans la situation de la Grande-Bretagne en 1914, essayant de maintenir sa supériorité face à des rivaux de plus en plus puissants (la Chine notamment). Avant 1914 les Américains étaient sveltes et travailleurs, ils sont aujourd’hui les individus les plus gros de la planète et vivent du travail des autres. Les bâtisseurs d’empire n’aiment pas beaucoup l’or, il ne laisse pas facilement manipuler, on le peut pas en fabriquer plus à partir de rien. C’est pour cette raison que la première guerre eut raison de l’étalon or, système trop honnête.
L’empire avait besoin d’argent. L’impôt sur le revenu fut mis en place en 1913 aux USA, c’est le 16ème amendement. Fixé à un taux allant de 1%, augmentant graduellement à 7% pour les revenus les plus élevés. En 1918, ces taux étaient montés respectivement à 23% et 77%. L’impôt sur le revenu fournit un chèque en blanc au gouvernement pour qu’il puisse dépenser de l’argent, même de l’argent qu’il n’a pas encore. Il lui permet aussi, en manipulant les taux, de punir ou récompenser tel ou tel groupe politique ou social.
L’empire avait aussi besoin d’un pouvoir central fort. En 1913, une centralisation accrue du pouvoir fut instituée par le biais du 17ème amendement, l’élection des sénateurs se faisant désormais au suffrage direct. Dès lors, le gouvernement collecte les impôts et en restitue une partie aux Etats moyennant de nombreux diktats et injonctions. En 1913, création de la FED, suite notamment à la dépression de 1907 et la fermeture de dizaines de banques.
Un peu plus tard, pour rentrer en guerre au Vietnam, les USA ont eu recours à l’argument des dominos : si le Vietnam tombait, tout le Sud- est asiatique suivrait. Or avec la chute de Saigon en 1975, il ne se passa aucun effet de contagion. Le pays était essentiellement agricole, qu’aurait gagné le camp qui se serait assuré son allégeance ? « Des soldats Américains avaient été envoyés par des gens aussi ignorants qu’eux dans un pays qu’ils n’avaient jamais visité afin de tuer des gens qu’ils ne connaissaient pas pour des raisons qu’aucun d’entre eux ne comprenait » écrit Bonner. Défendre la civilisation occidentale -basée sur le fait que les individus sont disposés à s’entendre sans recourir à la violence - en bombardant le Nord-Vietnam qui ne représentait aucune menace directe n’était-il pas contradictoire ? Tout ceci pour en arriver à une piteuse défaite militaire, avec des coûts humains et financiers énormes.
En effet, la guerre au Vietnam couta au bas mot 500 milliards de dollars aux USA. Au même moment, la politique de Grande Société de Johnson était fort couteuse. Nixon en vînt à abandonner l’étalon or en 1971, portant ainsi une grande responsabilité dans la bulle mondiale du crédit et l’affaiblissement du dollar. Le déclin du dollar est concomitant à la mise en place de l’empire : si une once d’or aujourd’hui achète la même quantité de biens qu’en 1913, le dollar d’aujourd’hui ne vaut que 5 cents comparé à celui de 1913. En moins de 100 ans, le dollar a donc perdu 95% de sa valeur. Bonner nous rappelle une cruelle vérité : la valeur moyenne de la monnaie papier sur le long terme est zéro. Et le dollar n’est rien que du papier, il n’a aucune valeur en soi. Avec le temps sa valeur deviendra nulle.
III- Le soir tombe sur l’Amérique
Bonner apprécie les vieux conservateurs qui souhaitent un budget équilibré, un gouvernement limité et des règlementations minimales. Des gens ennuyeux et prévisibles qui ont tendance à regarder toute nouveauté d’un œil suspicieux. Malheureusement ils ont quasiment disparu de la scène. Il apprécie beaucoup moins les néoconservateurs, qui avec leur désir d’empire et leurs projets grandioses d’amélioration du monde, ne font qu’accroitre les dépenses du gouvernement. Les « néocons » sont sans cesse à la recherche d’un nouvel ennemi : le communisme, le terrorisme, l’islamisme. Avec des slogans comme rendre le monde plus sur, exporter la démocratie, soutenir les combattants de la liberté (dont un certain Ben Laden dans les années 1980 !).
L’intérêt de la guerre contre le terrorisme, pour le gouvernement américain, c’est qu’on ne peut trouver l’ennemi sur aucune carte. La guerre, les dépenses et la dette peuvent ainsi se poursuivre indéfiniment. De 2001 à 2003, sous l’administration Bush, les USA contractèrent plus de dettes qu’au fil des 200 années précédentes.
L’héritage de Reagan
Reagan est considéré généralement comme un bon président dans le camp conservateur. Pourtant Bonner est assez critique vis-à-vis de sa politique. En matière de politique étrangère, il fût corseté par les néoconservateurs. De nombreuses interventions en Afghanistan et en Amérique latine furent entreprises pour lutter contre le camp communiste. On met au crédit de Reagan la chute du communisme – l’URSS s’est épuisée à suivre les dépenses militaires américaines - mais il se serait sans doute effondré tout seul.
En matière de politique économique, Reagan n'a atteint que 2 des 4 objectifs qu'il s'était fixés :
-
Réduire l’inflation : succès
-
Réduire les impôts : succès
-
Equilibrer le budget : échec
-
Déréglementer : échec
Mais les deux premiers objectifs ne faisaient qu’éliminer une partie des ravages antérieurs effectués par ses prédécesseurs. L’abondance monétaire et la fiscalité restaient encore trop fortes. La réduction d’impôt fut financée à crédit car le gouvernement empruntait de l’argent pour financer le déficit. Comme ses prédécesseurs et ses successeurs, Reagan finançait l’empire par l’emprunt.
Bonner s’en prend à l’économie de l’offre qu’il qualifie de « vaste escroquerie ». Les économistes conservateurs ne sont pas populaires, ce sont de vilains rabat-joie. Ils affirment que si le gouvernement dépense plus et s’endette, il faudra un jour en payer le prix. Il n’y a pas de repas gratuit comme le dit Milton Friedman. Avec les propositions de l’économie de m’offre, il semble que tout le monde reçoive quelque chose sans que personne n’ait à en payer le prix. La baisse des impôts va provoquer un boom de la production, ce qui va éliminer l’inflation, accroitre recettes fiscales et rétablir automatiquement l’équilibre budgétaire. Les ménages, les entreprises et l’Etat pourront dépenser plus.
La courbe de Laffer illustre la stratégie d’un gouvernement qui veut maximiser les recettes publiques. Trop d’impôt serait contre productif car on risque de tuer la bête (cas de l’URSS), pas assez d’impôt signifierait ne pas exploiter complètement la situation. Pour Bonner, « L’économie de l’offre n’était pas une formule visant à optimiser la liberté individuelle. Il s’agissait au contraire d’une formule permettant de financer un empire par l’augmentation des revenus du gouvernement ». Cette façon de procéder est dangereuse car pour quelqu’un qui respecte la liberté et les droits de propriété, ce qui importe n’est pas le taux d’imposition nominal mais le % de ressources soustraites pas le gouvernement. Bonner n’est pas pour autant un partisan de l’économie de la demande : personne de sérieux ne peut prétendre que l’on peut s’enrichir en consommant de la valeur.
Réduire les impôts est une bonne idée, mais réduire les impôts tout en augmentant simultanément les dépenses publiques est une imposture. Au lieu de réduire les dépenses publiques comme il l’avait promis, Reagan les augmenta, le budget de la défense s’accrut de 25%, celui de l’éducation de 50%. Déficit et dettes public explosèrent. C’est ainsi que Reagan entreprit une des plus grandes relances keynésiennes de tous les temps. D’autant que la baisse du coût du crédit liée à la désinflation Volcker incitait les Américains à emprunter. Chaque Américain se sentait plus riche, individuellement c’était le cas, mais collectivement non, les USA n’étaient pas plus riches.
Ainsi, le Parti Républicain a trahi ses principes en adhérent au keynésianisme, et même au mauvais keynésianisme. L’idée de Keynes n’est pas nouvelle, elle se trouve déjà dans la Bible avec l’histoire des 7 années d’opulence et des 7 années de famine. Pharaon savait que les gens ne seraient pas assez sages pour économiser du grain eux-mêmes, ils mangeraient sans réserve. Alors il fit des réserves de grain pendant les années fastes, puis le distribua au peuple quand vinrent les années de vaches maigres. Keynes expliqua que les gouvernements devaient agir de même : dégager des excédents en période faste, et relancer l’économie en période de récession grâce aux excédents accumulés pendant la période précédente. Mais les politiciens n’ont jamais vraiment compris ou voulu appliquer la 1ème partie du plan. Dépenser de l’argent rend tout le monde heureux. Mais quand il s’agit d’épargner, ce n’est jamais le moment propice. « Au lieu de donner le grain placé en réserve, (les gouvernements) donnent du grain qui n’a pas été encore planté ».
Les statistiques indiquent une hausse des salaires sous Reagan. Certes mais elle provient surtout de la hausse de la durée du travail. Les vraies augmentations de salaires sont liées à 3 causes : 1) La hausse de l’épargne, or sous Reagan l’épargne s’est effondrée. 2) Que cette épargne soit investie dans des affaires profitables, or le taux d’investissement par rapport au PIB perdit un point sous Reagan. 3) Que ces investissements accroissent la productivité, or le taux de croissance de la productivité chuta de moitié par rapport aux décennies précédentes.
Concernant les statistiques, Bonner nous explique que les statistiques du PIB, des prix et de la productivité sont triturées à mort. L’IPC est sous estimé par tout un tas de procédés rassemblés sous le nom d’indexation hédonique des prix : si le prix du beefsteak augmente, les statisticiens supposent que les gens mangent du mouton, si le prix des maisons explose, les statisticiens s’obstinent à ne prendre en compte que le prix des locations. Toutes ces manipulations contribuent à sous-évaluer l’IPC et surévaluer le PIB.
Par rapport au communisme, Bonner soutient une thèse iconoclaste. Pourquoi diable cette impatience à supprimer ce système alors qu’il n’était pas imposé aux Américains ? Du point de vue économique le communisme était un allié des USA, il rendait des millions de gens incapables de rentrer dans le marché mondial pour vendre des produits compétitifs et pour acheter les ressources. Cela permettait aux USA de se goinfrer de pétrole à bas prix.
Reagan aurait du remettre à l’honneur l’épargne et il ne l’a pas fait. Ses successeurs encore moins. Or l’épargne est essentielle : elle est empruntée par des entrepreneurs et sert à construire de nouvelles usines, à créer de nouveaux produits. Cela crée à la fois des profits et des emplois, ce qui fournit donc un plus grand pouvoir d’achat et plus d’épargne (cf. la Chine avec un taux d’épargne de 40%). Hayek dénonçait les effets négatifs du manque d’épargne : « L’économie dans son entier poursuivra forcément son déclin tant que l’on consommera plus qu’on ne produira, car une part de cette consommation se fait au détriment des réserves existante de capital ».
Le glorieux empire de dettes de l’Amérique.
L’endettement américain vient de la politique monétaire. En 2005, Greenspan déclarait avoir confiance en la main invisible de Smith. Or curieusement, il n’applique pas cette idée au marché du crédit dans lequel la banque centrale intervient. Cela pose deux problèmes. 1) Comment un banquier central peut-il savoir mieux que le marché quel taux d’emprunt requiert une économie vaste et complexe ? 2) En favorisant des conditions de crédit plus faciles que celle qu’acheteurs et vendeurs détermineraient seuls, il se plie aux vœux des politiciens. Cette politique d’argent bon marché est une illusion, comme l’a montré Hayek. L’illusion selon laquelle il y a plus d’argent disponible que réellement. Presque tout le monde est content : les consommateurs peuvent dépenser plus, les producteurs bénéficient d’une demande supplémentaire, des politiciens sont réélus. Tôt ou tard survient la crise, la correction. Plus la tromperie é été massive et prolongée, plus la correction est forte.
Bonner explique ce processus pernicieux de l’endettement au service de la consommation : « Dans un premier temps, on se sent bien quand on consomme plus. C’est comme de brûler les meubles pour se réchauffer ; ça fait du bien sur le moment. Mais ce bien-être est extrêmement éphémère. Quand les gens empruntent pour acheter, ils ont l’impression de devenir plus riches – surtout quand le prix de leur maison augmente. L’augmentation de la consommation apparaît même dans les chiffres de PIB, indirectement comme une croissance. Mais on ne devient pas vraiment plus riche en consommant. On devient plus riche en fabriquant des choses qu’on peut vendre à d’autres – avec un profit. ». Cette immense dette, fruit des manipulations monétaires des banques centrales, est une immense fraude dans l’empire : consuetudo fraudium, que l’on pourrait traduire par habitude frauduleuse. Il s’agit d’inciter les gens à acheter des choses dont ils n’ont pas besoin avec de l’argent qu’ils n’ont pas.
Jefferson doit se retourner dans sa tombe, lui qui avait écrit en 1789 : « Nulle génération ne peut contracter de dette plus élevée que celle qu’elle peut rembourser pendant le cours de sa propre existence ». Un fils peut refuser d’honorer la dette de son père, par contre une génération ne peut pas refuser de payer les dettes de la génération qui l’a précédée ; elle est obligée par un contrat qu’elle n’a jamais signé. « Les serfs de la féodalité n’avaient que sept années de travail à fournir pour acheter leur liberté. Cette nouvelle génération, en revanche, devra travailler toute sa vie ».
Jadis être économe et frugal était une vertu. Aujourd’hui il est presque devenu un signe de démence. Mais elle pourrait faire un retour en force. Bush fils voulait créer une société de propriété, il a créé un programme de santé public coutant 720 milliards de $ en dix ans, les maisons appartiennent à des sociétés hypothécaires, les voitures à GMAC et autres sociétés de crédit automobile.
Les USA sont en situation délicate : en Asie, les usines sont plus modernes, la main d’œuvre moins chère, et même dans le secteur des services et de la conception tout ce qui peut être digitalisé est susceptible d’être délocalisé. Le stade de l’élaboration et de la recherche est maintenant délocalisé, et les USA se transforment peu à peu en un pays du tiers monde. Il ne reste plus aux firmes américaines que des marques à commercialiser, mais même cela ne durera pas toujours. General Motors licencie et Wal-Mart embauche : certes mais les emplois dans les services sont moins payés que dans l’industrie. Les puissances hégémoniques n’ont-elles pas abandonné les voies du progrès aux pays qu’elles dominaient en se déchargeant sur eux de certaines de leurs contraintes (sujet ESSEC, 1995) ?
Et pourtant le système continue à fonctionne. Pourquoi ? La forte création monétaire au Japon pour éviter l’appréciation du yen a permis de maintenir les taux d’intérêt bas aux USA. Les gens perdent leur bon sens pendant les bulles et pensent que les USA peuvent s’en sortir grâce à leur flexibilité (comme ils pensaient à la fin des années que les Japonais avaient tous les atouts). Et malgré le déficit commercial américain, les étrangers se pressent encore pour prêter au gouvernement américain. Jusqu’à quand ?
La finance impériale moderne.
Les Américains épargnent trop peu. Le taux d’épargne net est quasiment nul aux USA. Quand Volcker était à la tête de la FED, il avait su à la fin des années 1970 « retirer la coupe de punch » avant de voir la fête déraper. En 2005, quand la fête battait son plein, Greenspan et Bernanke versèrent un peu plus d’alcool dans les coupes. Or les USA n’avaient pas besoin de saoulerie du consommateur mais de d’essor de l’investissement, lequel était passé de 18,8% sous Reagan à 1,6% en 2004.
Pourtant, tout paraissait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Greenspan affirma que la pénurie d’emplois était le signe d’un essor de la productivité. Bernanke prétendit que le monde souffrait d’un excès d’épargne, et que les USA rendaient service au monde en empruntant ses excédents d’épargne. Mais comment les Américains allaient-ils rembourser ? Personne apparemment ne voulait se poser la question.
Quand les gardiens des finances publiques poussent les gens à agir avec imprudence, à acheter de gros 44, à emprunter à taux variable (au moment où la FED s’apprêtait à augmenter les taux !), à ne pas s’inquiéter de la dette, il y a une inversion des valeurs. « C’est comme si le Conseil national des évêques brandissait une déclaration publique exhortant à l’échangisme ». Il y a quelque chose de pourri au royaume de la FED. Les sommets des cycles du crédit semblent correspondre aux bas-fonds de la pensée économique. Tout le monde perd le bon sens, y compris et surtout les autorités.
Pour Bonner, « Si quelqu’un peut être tenu directement pour responsable du niveau record de la dette étrangère et intérieure américaine, c’est Alan Greenspan ». C’est « Le Grand Trompeur », à la tête du plus grand cartel bancaire de la planète. Jadis partisan de la rigueur monétaire et budgétaire, il a pratiqué et prôné l’inverse. « Le président de la FED a une étrange aptitude à lancer des idées au moment où elles présentent le plus d’avantages pour sa carrière et le plus de danger pour tous les autres ». Comme Ponce Pilate, il donna au peuple ce qu’il voulait, pas du sang mais des bulles. Sous la présidence de Greenspan il se créa plus d’argent que sous tous les autres gouverneurs réunis et la dette par foyer américain est passée de 25 000 $ en 1987 à 100 000 $ en 2005 (dont 80 000 $ de dette hypothécaire). La FED a réussi a retardé une correction naturelle en créant des bulles.
Après 2001, l’économie aurait du connaître une correction mais le planificateur central de la monnaie Greenspan l’empêcha en réduisant les taux d’intérêt. La relance poussa les agents à commettre davantage d’erreurs, à emprunter davantage dans des affaires peu rentables ou pour consommer encore plus.
IV - Fin de bulle
Chaque période a ses folies. Dans les années 1990 il s’agissait des nouvelles technologies et des télécoms ; dans les années 2000 vint l’immobilier. On achetait de l’immobilier comme on achetait des actions dot.com 10 ans auparavant. En Californie, le prix des mobil- homes doublait chaque année ; au Nevada le prix des maisons augmentait de 50% en 2005.
Dans l’immobilier, on pouvait emprunter sans apport, sans preuve de revenu, et avec un prêt à taux zéro car la FED maintenait ses taux en dessous du taux d’inflation. De savants systèmes permettaient d’emprunter toujours plus, comme celui permettant de ne rembourser que les intérêts ou encore celui permettant d’extraire de la valeur résiduelle des maisons (grâce à la hausse des prix) et donc d’emprunter. Ainsi, une maison est achetée 200 000 $, une année suivante elle vaut 250 000 $, son propriétaire pense avoir fait un bénéfice de 50 000$ et les dépense. A force, les gens pensaient que les taux d’intérêt seraient toujours bas et les prix de l’immobilier toujours en hausse. Les maisons étaient devenues des objets de spéculation, des contrats à terme : on achetait une maison pour la revendre un peu plus tard plus cher. En 2005, un acquéreur sur cinq consacrait plus de 50% de son revenu à l’immobilier. Or la hausse de l’immobilier ne rend pas les USA plus riches, elle ne permet pas de construire plus d’usines. Les Américains en sont venus à croire que l’immobilier rapportait alors qu’il coûte (frais d’entretien, de réparation, charges).
Pour justifier la hausse du prix des actions, on avait avancé l’argument du financement des retraites. Pourtant les actions baissèrent. Pour justifier la hausse du prix de l’immobilier, on invoqua l’argument démographique. Pourtant le prix des maisons baissa. Avec le recul, ces arguments paraissent des rationalisations a posteriori. A l’époque de cette bulle immobilière, même les playmates se lançaient dans l’immobilier et le locataire était le type même du looser.
Bonner donne une statistique peu connue : entre 1890 et 2004, les prix de l’immobilier aux USA ont augmenté en termes réels de 66%. Mais cette hausse n’a eu lieu que sur deux brèves périodes : l’après 1945 et après 1998. A la différence qu’après 1945 l’Amérique était puissante, industrieuse, la balance commerciale excédentaire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. La hausse des prix des maisons entretenait une euphorie. En 2005, Greenspan déclarait devant le Sénat : « L’évidence soutient amplement l’opinion que les bases de l’économie sont stables ». Et Greenspan en 2006 : « La plupart des baisses de l’immobilier sont probablement derrière nous ».
Pourtant depuis 1990, le revenu des ménages américains s’est élevé de 11% tandis que leur dépense a grimpé de 30%. La hausse des prix immobiliers n’était donc pas soutenable. Mais les bulles rendent les gens crétins, crédules voire aveugles. C’est le jeu de qui-sera-le- plus-bête : parier que la personne suivante sera encore plus bête que soi pour acheter. La « démocratisation » de l’accès à l’immobilier a été une belle arnaque, elle a permis aux organismes de crédit de tendre une corde à des millions de gens, surtout aux plus pauvres. C’est en effet bien gentil d’arranger le mariage des prêteurs et des emprunteurs, mais si vous marriez une princesse avec un crapaud (un ménage insolvable), quand la pauvre fille se penche pour donner un baiser, il risque d’y avoir des reproches et de regrets.
Japonisation en cours
Pour Bonner, les deux dernières décennies du Japon préfigurent ce qui a de fortes chances de se passer aux USA. Avec l’éclatement de la bulle immobilière et financière, l’économie nippone s’est enlisée dans la récession. Au japon la relance monétaire ne fonctionna pas, les taux de la Banque centrale chutèrent à zéro mais les gens ne voulaient plus emprunter. La relance budgétaire - ce qu’on appela le keynésianisme du béton - non plus. L’économie ne se redressa pas. Fisher avant expliqué en 1933 que lorsque les gens endettés rencontrent des problèmes, ils vendent des actifs pour éviter la banqueroute, ce qui fait baisser le prix des actions et de l’immobilier. Les actions nippones n’ont rien gagné en 30 ans. Les individus dépensent moins, le chômage augmente.
Cependant, il existe des différences entre les deux pays : le Japon de 1989 était en meilleur santé que les USA aujourd’hui (balance courante excédentaire, réserves de devises), le gouvernement japonais pouvait emprunter à son peuple qui épargnait beaucoup, le gouvernement américain doit emprunter à des non résidents, et comme il n’est pas le seul, pour obtenir des fonds les taux d’intérêt risquent de grimper. Si les USA sont un empire de dettes, le Japon était une république d’épargne. Les USA possèdent la devise internationale.
Pour essayer de rectifier le tir, les erreurs devaient être réparées, les bilans assainis, ce que le Japon commença à faire. Au lieu d’en faire autant, les Américains firent le contraire, ils accentuèrent la bulle. Comme les Américains n’accepteront sans doute pas de voir la consommation réduite et les prix des actifs baisser aussi fortement qu’au Japon, la solution sera l’inflation qui réduira en cendres la dette américaine. N’est-ce pas ce qu’ont fait les Allemands après la Première Guerre mondiale pour réduire leur dette vis-à-vis de l’Entente ? Le ministre des finances de la République de Weimar Helferrich déclara que ne plus imprimer de billets reviendrait à empêcher le paiement des transactions, des salaires et en quelques semaines à arrêter toute vie économique. Mutatis mutandis, Greenspan et Bernanke ont tenus les mêmes discours. Comment dans ce contexte analyser la crise des subbrimes ?
Les héros qui sont tombés
Bonner épingle les financiers, qui depuis les années 1980 se croient les maitres de l’Univers, des sortes de Dieux. Citigroup vendait de la dette de subprimes à ses clients et elle en achetait pour s’en servir comme collatéral.
Il critique ce capitalisme en carton dans lequel les actionnaires ne contrôlent plus rien : en 2007 pendant que Fannie et Freddie perdaient 5 milliards de $ et que le cours des actions plongeait, leurs deux dirigeants se sont partagés 32 millions de $. Dans un système capitaliste, les capitalistes sont censés exploiter les travailleurs, là c’est l’inverse ! Les grandes banques se lancèrent dans des opérations hasardeuses sans les fonds propres nécessaires pour pouvoir résister en cas de pertes (ce sont des « capitalistes » sans capital) et se tournèrent vers l’Etat quand les affaires tournèrent au vinaigre. Il dénonce les nationalisations de Fannie et Freddie, ces sociétés auraient du faire faillite car elles avaient fait des erreurs. Désormais les citoyens paient au gouvernement non seulement leurs impôts mais aussi leurs remboursements d’emprunt.
Il fustige les régulateurs : les 3 371 employés de la SEC ne vinrent rien venir ; ils enquêtèrent plusieurs fois dans les placards de Madoff sans rien voir sa chaine de Ponzi de 50 milliards de $. Madoff est un héros : il va ouvrir les yeux – mieux que la SEC - aux gens en leur faisant comprendre que l’on ne peut pas obtenir une rentabilité aussi forte. Dans l’histoire des duperies de haut vol, Madoff est sans conteste le plus brillant. « Il ponzifia Ponzi ». Madoff était sans nul doute un escroc mais quelle est la différence entre promettre une rentabilité de 10% (chaîne Madoff) et promettre des prix de l’immobilier en hausse perpétuelle (chaîne instaurée par Wall Street, la FED, les agences de taux, les compagnies de crédit hypothécaire, les régulateurs)?
A propos de la SEC, pourquoi un bureaucrate reconnaitrait-il une escroquerie plus facilement qu’un investisseur dont l’argent personnel est en jeu ? Quelle information a-t-il qui ne soit accessible au public ? Quelle théorie suit-il que les investisseurs ignorent ? C’est ce qu’Hayek appelle la présomption fatale selon laquelle les autorités prendront de meilleures décisions que ce que les gens peuvent faire pour eux-mêmes.
Bonner dénonce la réaction des dirigeants politiques. Ils ont fait preuve de cécité, prétendant que tout allait bien quelques jours avant la crise. Bernanke, 2007 : « Nous pensons que les conséquences des perturbations dans le secteur des subprimes seront assez limitées ». Bush, 2008 : « Je ne pense pas que nous nous dirigions vers une récession ». Paulson en 2008 : « Je n’envisage pas de scénario où le contribuable américain sera mis à contribution ». Il dénonce aussi le renflouage des banques avec l’argent des contribuables grâce à un plan de 700 milliards de $, chiffre basé sur aucune donnée particulière mais suffisamment élevé pour frapper l’opinion. Henry Paulson, ministre des finances et ancien PDG de Goldman Sachs, eut le culot de le dire que c’était pour protéger les contribuables, alors qu’en fait il s’agissait plus simplement de corruption politique. C’était le capitalisme sans la destruction créatrice ou encore Le capitalisme avec les airbags. « C’était comme si on avait le christianisme sans la crucifixion ».
Obama va-t-il sauver l’Amérique ? De nombreux commentateurs hexagonaux ont vu dans son élection une quête de vérité alors qu’il s’agit exactement du contraire, les Américains ont voté pour une diversion face au réel. Les Américains ont élu un Roosevelt noir leur racontant les bobards qu’ils voulaient entendre. C’est la logique des élections : les gens vont voter pour obtenir des politiques ce qu’ils ne peuvent recevoir dignement de leur propre labeur.
Que nous enseigne l’histoire sur les sorties de crise ? Hoover a acquis la réputation de celui qui ne faisait rien, or il est au contraire beaucoup intervenu dans l’économie. Il demanda à la FED de relancer le crédit par de faibles taux d’intérêt, il lança des travaux publics, il limita la vente à découvert, il arrêta l’immigration, il tenta d’empêcher la baisse des salaires. Pendant la campagne électorale de 1932, Roosevelt critiqua Hoover au motif qu’il dépensait trop d’argent, en une fois au pouvoir en dépensa plus encore.
Comme l’explique Rothbard, le boom est le moment où les erreurs sont commises, la dépression celui où elles sont réparées. Loin d’être un fléau, c’est le retour nécessaire de l’économie à la normale. C’est ce qui se passa en 1921 sous Harding. Mais la reprise attendue en 1931 s’évanouit en raison de l’intervention du gouvernement. Pour Rothbard, les coupable de la Grande Dépression sont les politiciens, les bureaucrates et le masse des économistes éclairés (ou progressistes, c'est-à-dire interventionnistes). Cela se confirma au Japon 60 ans plus tard.
La FED renfloue les banquiers, les assureurs, les préteurs hypothécaires, les constructeurs automobiles, mais qui renflouera la FED ? Emprunter pour renflouer est en soi contestable, cela revient à retirer des ressources à des projets qui auraient pu être rentables et les détourner vers les projets déficitaires. Cette politique monétaire laxiste correspond comme disait Rueff à un plan d’irrigation pendant le déluge. C’est un peu comme si on appelait un pyromane pour éteindre un feu. Elle risque fort de créer de l’inflation. D’ailleurs le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe constatait en 2008 que les banques centrales des USA et du RU en viennent, avec l’assouplissement quantitatif, à appliquer la politique menée par la Banque centrale du Zimbabwe. Si ce Monsieur a raison, il est temps de s’inquiéter !
Que va-t-il se passer maintenant ? Une fois qu’une bulle a explosé, vous ne pouvez la regonfler. Tout ce que vous pouvez faire, c’est gonfler d’autres bulles. Quand la bulle technologique explosa, la Nasdaq ne remonta jamais. Vint ensuite la bulle immobilière. Elle a aussi explosé. C’est maintenant le tour de la bulle de la dette publique. On nous dit que plus le gouvernement américain émet de bons du trésor, plus les gens font la queue pour lui prêter de l’argent. Cela contredit le sens commun certes, mais cela ne signifie rien sur la capacité des Américains à rembourser. Les plus vieux amis de Madoff le suppliaient quasiment d’accepter leurs fonds.
Pour rembourser les emprunts passés, les gouvernements doivent emprunter plus. C’est le schéma de Ponzi, accablant de dettes les générations futures. L’idée de dette publique est immorale : imaginez un père dinant dans un bon restaurant et disant «gardez l’addition pour mon petit fils ». Les gouvernements se disent même heureux de coller à leurs descendants des charges financières auxquelles ils ne consentiraient jamais. Or toute pyramide de Ponzi a une fin, le plus souvent dramatique. En 1786, la dette de la France s’élevait à 80% du PIB, le crédit français devient si mauvais que personne ne voulait prêter à l’Etat français. En 1793, Louis XVI montait sur l’échafaud.
Bonner prévoit l’effondrement de l’empire américain, la dépréciation de ses dettes et de sa monnaie. Sa dernière phrase est sous forme de conseil : « Achetez de l’or ».
© Joël Hermet – 13 juin 2010