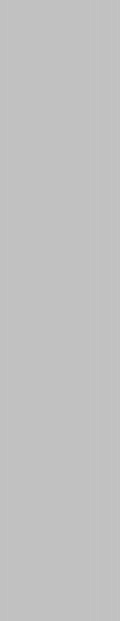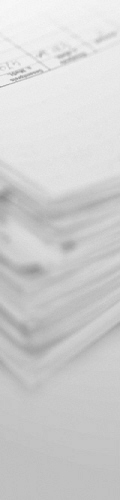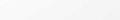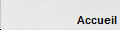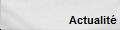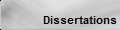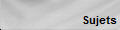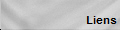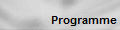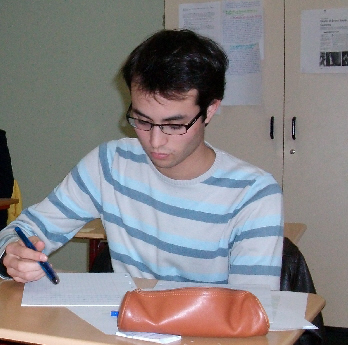METHODOLOGIE DE LA DISSERTATION
Les sujets d’AEHSC comportent le plus souvent une question à laquelle le candidat est invité à répondre ou une affirmation qu’il faudra analyser et discuter. On ne saurait trop insister sur la nécessité de bien comprendre la question posée. En effet, l’épreuve d’AEHSC est rarement une question de cours. Un sujet portant sur « L’influence des problèmes du SMI sur la crise économique » n’est un sujet ni sur le SMI, ni sur la crise, mais bien sur l’influence des problèmes du premier sur la seconde.
Le candidat sera donc jugé autant sur ses connaissances factuelles que sur ses capacités d’analyse et son habileté à construire un raisonnement ordonné. La dissertation est avant tout une démonstration, pas une récitation de connaissances générales. Ne cherchez pas à mettre absolument le plus de connaissances possibles dans votre devoir : la qualité doit primer sur la quantité ; c’est pour cela que les Ecoles fixent un nombre de pages maximal à ne pas dépasser (huit en général). On ne vous demande pas d’accumuler des faits mais de construire un raisonnement. La réflexion personnelle est plus apprécié que l’académisme, pour peu qu’elle soit argumentée et cohérente.
Il ne s’agit pas, bien évidemment, de fournir une réponse tranchée et définitive mais plutôt de savoir présenter de manière nuancée un problème sur lequel les avis peuvent diverger.
Le rapport du concours ECRICOME en 2000 explicitait les qualités appréciées dans les copies :
« Sont récompensés :
- le discernement, qui se manifeste dans la compréhension du sujet
- la rigueur, exigée pour conduire une démonstration à son terme
- l’esprit de synthèse, qui permet d’aborder une question dans sa globalité
- l’aptitude à l’abstraction, qui se traduit par un vocabulaire riche en concepts
- le sens du concret, qui dicte le choix des faits cités en exemple
Règle d’or : on n’a jamais une seconde occasion de faire une bonne première impression. »
Le plan, vous le savez, est l’ossature de votre devoir et son établissement demande un soin particulier. Aboutir à la construction du plan nécessite plusieurs étapes préalables.
La première concerne la signification du sujet : il s’agit d’une approche méthodique qui permet à partir des mots clefs de l’intitulé de cerner le champ de l’étude demandée, d’en dégager les limites et de discerner les implications de la formulation.
La seconde comporte l’établissement, sur une feuille de brouillon, de tous les éléments qui se rattachent au sujet et ensuite le classement de ces éléments.
La troisième consiste à déterminer la problématique ; c'est-à-dire un axe de réflexion, un fil directeur qui ordonne le raisonnement.
Ensuite il s’agit d’établir le plan.
Il reste enfin à rédiger les trois éléments essentiels que comporte toute dissertation : l’introduction, le développement et la conclusion.
Passons en revue ces différentes étapes.
1 – L’ANALYSE DU SUJET
Lisez l'énoncé attentivement. Ne lisez pas ce que vous avez envie de lire. L'expérience montre que même les étudiants de classes prépa. ne savent pas lire.
1) Analyser les termes du sujet.
Il faut lire et étudier avec soin l’énoncé. Vous devez soumettre à un examen rigoureux tous les termes présents dans le libellé du sujet, chaque mot compte. Toute erreur à cette étape cruciale se paie cher par la suite.
Les termes les plus simples doivent vous arrêter et vous forcer à vous interroger avec beaucoup d’humilité : faites comme si vous ne saviez rien. Si vous faites ce travail, vous ne confondrez pas « l’automobile en France » avec « l’industrie automobile en France » ; « la population active aux Etats-Unis » avec « l’emploi aux Etats-Unis ».
2) Percevoir le champ du sujet.
Il faut traiter rien que le sujet, mais tout le sujet.
Le hors-sujet est le pire des défauts. La fréquence de ce type d’erreur montre que l’on ne passe jamais assez de temps à analyser et à délimiter le sujet dès le départ.
Exemple 1 : « La résolution des crises majeures du capitalisme au 20ème siècle » : pour ce sujet, les causes des crises et leur déroulement est hors sujet.
Avec quel autre sujet ne faut-il pas le confondre ? Une méthode consiste, au brouillon, à modifier légèrement l’énoncé et voir les effets sur le champ du sujet. Comparez les sujets entre eux est d’ailleurs une excellente façon de vérifier la validité de votre réflexion. Demandez-vous quels sont les sujets proches du votre dont le libellé est légèrement différent. Les connaissances à utiliser seront certes voisines mais pas totalement interchangeables et surtout l’approche sera profondément modifiée.
Exemple 2 : Le rôle de l’inflation dans le processus de croissance.
Le thème sur le lequel porte le sujet est l’inflation. Mais l’instruction précise est d’étudier l’impact de l’inflation sur la croissance économique. Il faut donc, du début à la fin du devoir, étudier l’inflation dans son rapport avec la croissance. On voit ici que la causalité est définie par le sujet (rôle de l’inflation sur la croissance et non l’inverse) ce qui ne serait pas le cas si le sujet était « Inflation et croissance » (possibilité d’examiner l’impact d’une forte croissance sur le processus inflationniste).
Exemple 3 : La France est-elle encore une puissance industrielle ?
Ce sujet incite à une double comparaison :
- la France d’aujourd’hui par rapport à la France d’hier
- la France par rapport au reste du Monde
Sauf indication contraire, le champ géographique est le monde entier, ce qui inclut les PED et les pays socialistes.
Sauf indication contraire, le champ historique remonte à la révolution industrielle. Si le verbe du sujet est au présent, et si le thème s’y prête, il faudra privilégier la situation actuelle.
3) Comprendre la consigne du sujet.
Le sujet est rarement une question de cours. Faire un copier-coller à partir du cours
ne vous permettra pas d’obtenir une bonne note. Il faut comprendre la consigne de travail.
Généralement, on se trouve devant 5 grands types de sujets :
- Ceux qui demandent d’analyser. Ils commencent souvent par un verbe tel que « analyser »,
« expliquer » « montrer », « vous réfléchirez à » ; parfois par un adverbe « pourquoi »,
« en quoi », « comment » ou « quelle est le rôle de ». L’accent est mis sur l’étude des
mécanismes explicatifs. Attention à ne pas glisser du positif (ce qui est vrai ou faux)
au normatif (ce qui est bon ou mauvais).
Exemple : Pourquoi l’économie de marché ne peut-elle se passer de l’intervention de l’Etat.
- Ceux qui demandent de discuter : ils commencent par « faut-il », « dans quelle mesure »,
« jusqu’à quel point » ou contiennent une interrogation « est-il », « doit-on »,
« peut-on affirmer», etc. Il faut examiner une thèse de façon contradictoire.
Cela induit souvent un plan en termes d’opposition « oui… mais… » mais
le manichéisme est à éviter. Exemple : L’économie de marché peut-elle se passer
de l’intervention de l’Etat ?
- Ceux qui ne comportent aucune question. Il faut alors trouver un fil directeur.
Il s’agit souvent des sujets les plus difficiles à traiter.
Exemple : L’évolution des consommations individuelles et collectives depuis 1945.
- Ceux qui demandent de comparer : il faut comparez tout au long du développement.
Exemple : Comparez la crise des années 1930 et celle des années 1970.
- Ceux qui demandent d’étudier le lien entre deux phénomènes :
il faut étudier les liens réciproques. Exemple : Inflation et croissance.
Ensuite votre travail consiste à rassembler vos idées.
2 - LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES
Vous devez retrouver vos idées, vos connaissances qui sont en rapport avec le sujet. Recensez au brouillon tous les éléments qui se rapportent au sujet. Ne vous inquiétez pas, vous savez nécessairement des choses. Il est impossible de se trouver totalement « sec » sur un thème.
Il existe une méthode qui permet de faciliter ce travail de recherche d’idées : il s’agit de commenter le sujet sous plusieurs angles d’approche. Prenons à titre illustratif le thème des retraites.
- les différents aspects de la question : économique (poids des cotisations retraites sur le coût salarial, impact économique de la consommation des seniors, transferts intergénérationnels), social (niveau de vie relatif des retraités par rapport aux jeunes et aux actifs), politique (poids électoral des retraités), financier (déficit de l’assurance vieillesse).
- les points de vue des différents partenaires concernés par la question (syndicats, patronat, Etat, consommateurs…)
- l’espace : la question se présente-t-elle différemment en France et à l’étranger (fonds de pension anglo-saxons), dans les PDEM et les PED (les enfants y jouent souvent le rôle d’assurance vieillesse), les pays capitalistes et les pays socialistes (pas de fonds de capitalisation).
- la chronologie : la question s’est-elle toujours posée de la même façon ? (cf. l’augmentation de l’espérance de vie et le vieillissement de la population)
- l’enchaînement explicatif : causes, manifestations, conséquences
- les oppositions : aspects positifs et négatifs
- les théories et auteurs que l’on peut citer (Sauvy, Easterlin, Modigliani, Pineira, etc.)
3 - LA PROBLEMATIQUE
Il s’agit d’une question assez vaste dont la réponse permet d’organiser les différentes parties du devoir.
La problématique a pour but de vous aider à établir un plan logique et structuré, vous évitant ainsi de réciter le cours sans l’adapter au sujet qui vous est proposé. Elle montre l’enjeu du sujet, elle représente un fil conducteur du raisonnement et justifie le plan. Elle débouche sur une clé d’analyse qui permet de traiter le sujet
Formulez une problématique simple, quitte à la modifier par la suite. Il n’y a pas une seule problématique possible par sujet mais celle que vous allez choisir va orienter votre développement.
Il est possible de poser plusieurs questions si cela permet de mieux montrer les divers enjeux du sujet.
Comme il s’agit d’un point crucial de votre devoir, appliquez-vous pour susciter l’enthousiasme du lecteur. Une bonne problématique réclame un peu de culture et de finesse.
Généralement, on se trouve devant 2 types de sujets :
Ceux où la problématique est déjà amorcée, voire manifeste : il s’agit de reformuler la question.
Ceux où la problématique est absente : il faut en créer une de toutes pièces. Exemple : sur le sujet : « Compétitivité et intervention des Etats » vous pouvez orienter votre réflexion avec la problématique suivante : Comment les politiques économiques peuvent augmenter la compétitivité d’une nation ?
Les grands défauts à éviter :
- la problématique qui exclut le sujet
- la problématique trop restrictive qui élimine une partie du sujet
- la problématique trop large qui entraîne du hors-sujet
- la problématique trop restrictive et trop large qui en même temps déborde le cadre du sujet tout en ne le traitant pas dans son entier
4 – LE PLAN
Le plan est l’organisation du devoir en parties, sous parties et paragraphes.
Il doit répondre de manière logique et cohérente au sujet et à la problématique posée.
Il vaut mieux un plan simple qui permet de mener à bien votre raisonnement qu’un plan compliqué dont vous n’arrivez pas au terme. Bien évidemment, le type de plan dépend de la problématique entraînée par le sujet. Pensez à établir des titres de parties et de sous-parties qui deviennent dans la rédaction le début des phrases des différents paragraphes de votre développement.
Le plan ne se choisit pas au hasard, il doit être le résultat de la réflexion menée au cours des étapes précédentes. Il doit permettre d’aller logiquement vers la conclusion qui est l’aboutissement de votre raisonnement.
Quel est le plus adapté ? Cela dépend du thème, de la façon dont le sujet est posé, de vos connaissances au moment de l’épreuve (bannissez le plan à tiroirs vides).
Il n’y a pas de plan passe partout, chaque sujet est particulier. Cependant, l’expérience montre que certains plans reviennent fréquemment. Voici les principaux :
- le plan dialectique
Il comporte trois parties : la thèse, l’antithèse et la synthèse.
La thèse sert à formuler une ou des hypothèses, l’antithèse réfute cette ou ces hypothèses, la synthèse permet le dépassement de la contradiction en apportant un compromis constructif ou une solution autre grâce à de nouveaux éléments d’analyse, de nouvelles perspectives. Ce plan est très utilisé en philosophie car il permet la confrontation d’idées, de théories opposées ; il est plus difficile à manier dans le domaine des faits.
Exemple : L’équilibre budgétaire doit-il être un objectif des politiques économiques ?
Plan possible : 1- Les vertus présumées du déficit ; 2- La nécessité de l’équilibre ; 3- Quel niveau optimal de prélèvements obligatoires ?
- le plan de type dialectique
Il ne comporte que deux parties qui ne s’opposent pas fondamentalement comme le font les deux premières parties du plan dialectique proprement dit. Ce sont des plans : 1ère partie « il est vrai que… » ; 2ème partie « …mais ».
Ce sont des plans très usités qui permettent de nuancer votre raisonnement. Rappelez-vous qu’il faut garder pour la deuxième partie ce qui vous paraît dominant et donc commencer par ce qui vous paraît devoir être partiellement réfuté, élargi, dépassé.
- le plan historique
Il est utilisable lorsque le sujet fait intervenir le temps comme variable essentielle et lorsqu’il est possible de distinguer deux ou trois périodes qui s’opposent du point de vue du sujet traité. La difficulté est de repérer ces périodes et de trouver des dates qui traduisent le passage d’une période à une autre. Ces dates doivent représenter un tournant.
Exemple : Le franc de Raymond Poincaré à Raymond Barre.
Un plan chronologique type serait :
I – Le franc rattaché à l’or : (1928-1936)
- La stabilisation Poincaré
- L’attachement à l’or
II – Le franc dans la tourmente : (1936-1958)
- L’impossibilité de relancer les exportations par des dévaluations
- Les remous de la IVème Réépublique (débat Mendès-Pleven, refus de la rigueur)
III – Le franc restauré : (1958-1981)
- Le retour à la convertibilité externe et la bonne tenue du franc (malgré la dévaluation de 1969)
- La mise en place du serpent puis du système monétaire européen
Bien construits, ils peuvent donner d’excellentes copies mais ils entraînent plus facilement la description que le raisonnement et la confrontation d’idées.
- le plan analytique
Il décompose le sujet en divers éléments recensés selon leur nature (facteurs économiques, sociaux, politiques), selon un ordre progressif (court, moyen, long terme), selon leur combinaison (rôle du capital, du travail, du progrès technique).
Le plan par gradation en est une variante : il consiste à présenter et analyser successivement les divers aspects d’un problème, avec un enchaînement logique des parties, en allant par exemple du plus simple au plus complexe.
D’apparence simple, ils peuvent s’avérer complexes à utiliser en particulier au niveau du classement des idées et de l’équilibre des parties. Bien réalisés, ils peuvent donner de très bonnes copies.
- le plan logique
Les plans « causes, déroulement, conséquences » ou « pourquoi, comment, jusqu’où » ou encore « théories, pratiques, résultats » peuvent être des plans de secours. Ils peuvent vous aider pour commencer à traiter des dissertations. Mais méfiez-vous à ne pas les utiliser de façon trop mécanique, cela donnerait un caractère stéréotypé à votre travail et de plus vous risquez de n’être guère original. Dès que vous aurez progressé, il faudra réfléchir par vous-même.
- le plan comparatif
Il s’applique aux sujets qui demandent de comparer tels faits, telles théories. Comparer c’est opposer en faisant ressortir les différences aussi bien que les ressemblances. Tout plan comparatif devra donc s’efforcer de mettre en lumière le différent et l’analogue.
Un plan passe-partout : différences-ressemblances-interprétations est possible mais signifie parfois céder à la facilité. En tous cas, malgré ses défauts éventuels, ce plan est préférable à un plan qui n’induirait aucune comparaison.
Exemple : « Comparez la crise des années 1930 et la crise des années 1970 ».
Le plan « 1) La crise des années 1930 ; 2) La crise des années 1970 » revient à nier le sujet. Soyez vigilants : quand de tels sujets de comparaison sont posés, environ 50 % des candidats choisissent ce type de plan !
Un plan plus pertinent consisterait à comparer 1) les causes, 2) le déroulement et 3) les sorties de ces 2 crises.
Remarque pour les sujets qui demandent d’étudier le lien entre deux phénomènes :
Il faut étudier, s’ils existent, les liens réciproques, mais il n’existe pas de plan type, chaque sujet étant particulier.
Exemple 1 : « Inflation et croissance ».
On peut consacrer une partie au lien Inflation è croissance (taux d’interet réels plus faibles) et une autre partie au lien croissance è inflation (augmentation du coût des facteurs de producteurs qui deviennent plus rares. Les deux parties compteront de nombreux arguments.
Mais parfois il serait absurde de consacrer autant de place aux deux sens de la corrélation.
Exemple 2 : « Compétitivité et intervention des Etats »
Le sujet incite le candidat à savoir si l’Etat peut durablement agir sur la compétitivité des nations, de quelle manière et avec quelle efficacité. Certes le niveau de compétitivité influence la création de richesse, et partant le niveau de prélèvements obligatoires et donc les interventions de l’Etat, mais le lien est trop ténu pour en faire une partie à l’égale de la précédente.
Vous le voyez, les possibilités ne manquent pas. Dites-vous que, pour un sujet donné, il n’y a pas un bon plan. Il y en a des dizaines. Il est vrai qu’il existe aussi des centaines de mauvais plans. Parmi les bons plans, choisissez simplement celui qui vous semble le plus clair.
Dans votre plan, pensez à :
- aller du simple au complexe
- du général au particulier
- de la thèse que vous contestez à la thèse que vous défendez
Une fois la logique du plan choisie, certaines règles doivent être suivies pour que sa construction soit réussie :
- Chaque partie doit avoir une unité, une tendance générale : une partie qui expose des idées opposées laisse le lecteur dans un sentiment de confusion voire d’incompréhension.
- Il doit y avoir une progression dans le raisonnement, le plan catalogue est à bannir. Indicateur : si vous pouvez permuter l’ordre des parties sans dommage, votre plan peut encore être amélioré.
- Si vous ne savez pas par quelle partie commencer, introduisez dans la 1ère partie l’idée la plus évidente ou celle qui a eu le premier rôle historiquement, les autres parties serviront à affiner le raisonnement ou le nuancer.
- Si vous devez commenter ou discuter une citation d’auteur, il est conseillé de montrer en quoi elle est vraie en début de devoir
- Mêlez histoire et théorie. Un plan « 1- la théorie ; 2- les faits » est un mauvais plan, sauf cas très particulier où le sujet porte sur un point précis de théorie économique. Il faut bannir 2 défauts opposés : l’analyse économique désincarnée et le récit événementiel.
- Ne pas mélanger les types de plans : si le I et le II sont chronologiques, le III doit l’être aussi.
Le développement comporte deux ou trois parties : il n’y a pas de règle absolue, c’est la nature du sujet à traiter qui amène à choisir le nombre adéquat. Disons simplement que le plan en 3 parties permet plus facilement de nuancer.
Les parties doivent être de taille comparable et comporter un nombre égal de sous parties (2 ou 3). Donc, au total, vous avez 4 possibilités de plan (les chiffres représentent le nombre de sous parties) : 2.2 ; 2.2.2 ; 3.3 ; 3.3.3.
Les principaux défauts à éviter :
- oublier de diviser : on obtient alors un bloc compact d’idées qui ne sont pas ordonnées
- diviser ce qui n’a pas besoin de l’être : on aboutit à des répétitions inutiles
- déséquilibrer les diverses parties de l’analyse : les parties du développement doivent être à peu près de longueurs égales et comporter un nombre à peu près égal de paragraphes
Maintenant vous êtes armés pour rédiger les trois éléments de votre dissertation ; commençons bien entendu par l’introduction.
5 – L’INTRODUCTION
Une introduction correcte doit conduire le lecteur à l’intérieur d’un groupement de pensées. Donc il faut faire connaître avec clarté et précision de quoi on veut parler et pourquoi on veut en parler.
L’introduction a donc un double rôle : amener le lecteur au sujet et poser le sujet. Elle n’a de valeur que si un plan précis et détaillé du développement est établi ; donc il faut penser à l’introduction et la rédiger que lorsque le plan détaillé est terminé.
Une introduction comporte en général les 4 éléments suivants :
A – L’entrée en matière :
Elle situe le sujet dans son contexte historique ou théorique. Comme elle a pour but d’accrocher le lecteur, il faut bannir les formules banales du style « Le travail occupe une place très importante dans notre société » ou « Depuis toujours les femmes font des enfants » ou encore « L’intervention de l’Etat fut plus ou moins importante au cours des dernières années ».
Pour les sujets ayant un champ historique défini, il est indispensable de donner le contexte historique d’origine. Exemple : pour un sujet sur le SMI de 1945 à nos jours, il est nécessaire de rappeler l’instabilité monétaire de l’entre-deux-guerres.
Si le sujet ne se prête pas à ce rappel historique, vous pouvez utiliser d’autres moyens :
- Utiliser une citation ou thèse d’auteur, un fait historique
- Rapprocher le thème de l’actualité
- Accrocher l’attention par une anecdote frappante, un exemple significatif
- Cerner le sens des mots-clés en les explicitant
Il faut éviter :
- Le début abrupt : annoncer d’entrée son plan révèle comme un désir d’en finir au plus vite et l’absence d’une problématique.
- La brosse à reluire : « Ce sujet clairement posé aborde le problème le plus important pour notre époque… », « Le sujet tombe à pic… »
- La règle du « moi, je » : la dissertation est l’affaire de réflexion, pas d’opinion.
- Le mythe des cavernes : « De tous temps les hommes… », « Depuis les débuts de l’humanité… »
- Les formules vides : « On dit que… », « Même l’homme de la rue… », « Les économistes pensent que… »
B – La présentation du sujet :
Il s’agit de définir les termes essentiels du sujet (si cela n’a pas encore été fait), de présenter l’enjeu du sujet, et de resituer le sujet dans un cadre plus général afin d’en montrer son intérêt historique ou théorique ou actuel. Une exception toutefois : si le sujet porte sur une notion très complexe, sa définition peut être réservée à la 1ère partie afin de cerner ses diverses significations, ses contours, ses implications. Cette étape est indispensable pour éviter un traitement trop plat du sujet. Lorsque l’intitulé se prête à une certaine marge d’interprétation, justifiez ici l’interprétation retenue. Après avoir posé brièvement le problème, insister sur son importance relative en évitant d’en faire le problème d’une civilisation.
C – La problématique :
C’est une interrogation centrale, un fil directeur autour duquel s’organise la discussion, comme cela a été dit plus haut.
Il faut éviter :
- De reprendre tel quel l’énoncé : ce n’est pas problématiser mais recopier.
- De poser des questions en rafale qui fusent dans tous les sens : une abondance de questions, une floraison de points d’interrogation ne peut faire office d’hypothèse de travail et d’ancrage de la réflexion.
- De tuer le suspens : ne pas répondre au sujet dès l’introduction, la conclusion est faîte pour cela.
- D’être un censeur impitoyable : « Nous nous proposons de démontrer l’absurdité de cette question… ».
- De jouer au flagorneur : « Nous allons démontrer combien ce problème est capital et combien l’auteur a raison… »
- De démotiver le correcteur : La formule « Nous pouvons nous interroger sur l’évolution de la consommation depuis 1945 dans les pays industrialisés… » ne renseigne pas sur la façon dont le sujet va être abordé et n’incite pas à lire la copie.
D – L’annonce du plan :
Il faut annoncer en quelques lignes brèves les 2 ou 3 parties de son plan, sous forme affirmative de préférence.
Chaque phrase ou bout de phrase annonçant une partie doit indiquer l’idée principale développée dans la partie.
On évitera :
- Le plan détaillé : annoncer les sous-parties est maladroit et totalement déconseillé.
- La publicité mensongère : discordance entre l’annonce du plan et les parties du développement (nombre de parties ou contenu différent)
- L’annonce bâclée : celle qui ne renseigne pas le lecteur sur l’idée qui va être développée dans chaque partie :
Voici deux exemples de ce dernier défaut :
1 : « Nous verrons d’abord le point de vue des classiques, puis celui des keynésiens. »
2 : « Dans un 1er temps nous parlerons des PED, dans un 2nd temps des PDEM. »
Dans les deux cas, le lecteur ne sait pas ce qui va être démontré dans chaque partie.
On préférera les annonces suivantes :
« Si pour les classiques l’épargne est indispensable à la croissance, pour les keynésiens l’épargne est plutôt un frein ».
« Dans les PED l’épargne est un facteur de démarrage, dans les PDEM l’épargne est un facteur de poursuite du développement et l’effet du développement »
6 – LE DEVELOPPEMENT
La charpente du développement est constituée par le plan qui a été établi auparavant. Il ne vous reste normalement plus qu’à rédiger. Le plan est constitué de parties se subdivisant en sous-parties qui les organisent logiquement. Il ne faut pas oublier les mots et les phrases de liaison entre les idées exposées ni les conclusions partielles qui synthétisent le contenu d’une partie, annoncent la suivante et rythment le devoir. Des transitions doivent exister entre chaque partie et entre chaque sous partie et plus généralement entre chaque idée. Trop de copies ressemblent à des catalogues où de multiples arguments sont alignés pêle-mêle sans fil directeur. Au début de chaque partie, les sous parties sont brièvement annoncées (2-4 lignes).
Le correcteur doit voir rapidement où il en est grâce à l’espacement :
- Séparez nettement l’introduction, le développement et la conclusion
- Séparez nettement les parties.
- Allez à la ligne au début de chaque sous-partie et décalez le début de chaque sous partie par rapport à la marge.
- Ecrivez jusqu’au bout de chaque ligne, chaque sous partie doit être compacte.
Pour donner de la consistance à votre devoir, densifiez votre copie, c’est à dire introduisez de nombreuses idées en peu de lignes, au lieu de rester longtemps sur la même idée. Introduisez des chiffres, tout en sachant qu’ils n’ont d’intérêt que datés, expliqués et comparés. Commentez des citations. Evoquez des auteurs et leur apport sur le sujet afin de montrer que vous avez une certaine culture en économie. La convention veut que les titres des ouvrages soient soulignés. Ces chiffres, ces citations et ces auteurs rendront votre copie plus vivante.
C’est le moment de rédiger. Voici quelques règles pour écrire :
1- “Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément”. La clarté est essentielle.
1- “Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément”. La clarté est essentielle.
2- Ecrivez lisiblement. Une copie illisible, par définition, ne peut être corrigée. Le soin apporté à l’écriture est aussi un critère d’appréciation.
3- Faites des phrases complètes, respecter l'orthographe et la grammaire.
4- Facilitez la tâche du correcteur en lui présentant vos idées de manière à lui économiser son temps.
5- Evitez de répéter ce qui est largement connu.
6- Contrôlez le ton (ironique ou autre).
7- Faîtes des paragraphes courts, des phrases courtes et longues pour varier le rythme. Privilégiez cependant les phrases courtes, écrites au présent de l’indicatif et construites selon un schéma simple : un sujet, un verbe, un complément.
8- Citez de manière appropriée l'auteur qui est à l'origine de l'argument, si ce dernier n'est pas de vous.
9- Rendez les phrases cohérentes, ne pas hésiter à les lier de manière répétitive. Les phrases doivent être transitives : AB / BC / CD.
10- Un mot a un sens et un seul. Il faut être précis et retourner à la racine latine. Sachez ce que ce mot veut dire. Soyez prêt à défendre l'utilisation de ce mot plutôt qu'un autre lors d'une discussion sur votre argument.
11- Utilisez la forme active.
12- Prohibez les formules journalistiques du type « les vagues de dégraissage ».
6- Contrôlez le ton (ironique ou autre).
7- Faîtes des paragraphes courts, des phrases courtes et longues pour varier le rythme. Privilégiez cependant les phrases courtes, écrites au présent de l’indicatif et construites selon un schéma simple : un sujet, un verbe, un complément.
8- Citez de manière appropriée l'auteur qui est à l'origine de l'argument, si ce dernier n'est pas de vous.
9- Rendez les phrases cohérentes, ne pas hésiter à les lier de manière répétitive. Les phrases doivent être transitives : AB / BC / CD.
10- Un mot a un sens et un seul. Il faut être précis et retourner à la racine latine. Sachez ce que ce mot veut dire. Soyez prêt à défendre l'utilisation de ce mot plutôt qu'un autre lors d'une discussion sur votre argument.
11- Utilisez la forme active.
12- Prohibez les formules journalistiques du type « les vagues de dégraissage ».
13- Evitez de ressortir à tout propos des expressions prétentieuses comme par exemple « l’économie monde », « le rapport salarial », de vous en gargariser sans jamais expliquer leur contenu.
14- Soyez naturel et concret, évitez d'être abstrait quand c’est inutile.
14- Soyez naturel et concret, évitez d'être abstrait quand c’est inutile.
15- Evitez les parenthèses : si c’est important, rédigez une phrase.
16- Supprimez les points de suspension : ce n’est pas au correcteur d’imaginer la suite.
17- Prohibez l’emploi du « je », les abréviations.
18- Préférez les phrases positives (ce qui est vrai ou faux) aux phrases normatives (ce qui est bien ou mal).
19- N’écrivez pas que vous avez « bien » montré quelque chose, formule qui a pour fonction la plupart du temps de tenter de masquer une argumentation insuffisante ou absente.
20- Précisez en toutes lettres la signification des sigles utilisés.
21- Ne cherchez pas à flatter ou séduire le correcteur, ne le prenez pas non plus pour plus imbécile que vous
22- Enfin, vous êtes jugé sur la qualité de votre raisonnement, sur la force de votre argumentation et non sur les opinions ou jugements de valeur censés plaire au correcteur. Evitez de faire interférer vos opinions politiques, religieuses ou artistiques avec votre argumentation.
7- LA CONCLUSION :
Une conclusion n’a de valeur que s’il existe entre elle et l’ensemble du devoir un rapport nécessaire. C’est dire que la conclusion n’est pas seulement une fin, mais un résultat. Evitez la conclusion bâclée et la conclusion qui répète l’introduction. Il faut garder à l’esprit que le correcteur termine par la conclusion, c’est donc elle qui laisse l’impression finale dégagée par votre copie : la conclusion emporte la note. La conclusion comporte habituellement deux parties : le bilan et l’ouverture.
Le bilan répond directement à la problématique posée en introduction et permet de donner une vue synthétique du devoir. Si l’énoncé est tel que l’étudiant doit prendre position, c’est dans la conclusion que sera donné le point de vue personnel, d’autant plus fermement qu’il aura été motivé et justifié à l’avance par un développement précis et rigoureux.
Le sens des nuances n’est pas incompatible avec cette capacité à choisir, ne soyez pas prisonnier de ce que vous êtes ni de ce que vous pensez. Bannissez les formules à l’emporte-pièce, les condamnations systématiques. Vous n’êtes pas un juge d’ailleurs mais un observateur.
Ce qu’il faut éviter :
- la réponse de Normand consistant à écrire que la réponse à la question est mitigée, que telle solution comporte du pour et du contre.
« Le débat protectionnisme / libre échange n’est donc toujours pas clos, chaque tendance comportant ses avantages et ses inconvénients » ou encore « Pour conclure, l’intervention de l’Etat fut plus ou moins importante au cours des dernières années ».
- la conclusion inutile consistant à dire qu’il est difficile de répondre à la question, que le sujet est très complexe, etc. Ce genre d’assertions conclut un traitement défaillant du sujet, faute de connaissances généralement.
- la conclusion qui apporte un nouvel argument qui aurait du figurer dans le développement
- la conclusion qui n’est qu’un résumé du développement ; la conclusion est certes un résultat, mais un résultat qu’il faut éclairer et interpréter
L’ouverture est souvent un casse-tête pour les étudiants ; il s’agit de trouver un thème connexe ayant des liens directs et précis avec le sujet traité (sinon on court le risque de sauter du coq à l’âne) mais différent (pour éviter de tourner en rond). Elle peut aussi permettre d’élargir le sujet en suggérant son extension dans le temps ou dans l’espace. Faites appel à votre imagination. Quelques écueils à éviter :
- la phrase passe-partout qui pourrait servir pour n’importe quel sujet : exemple : « Dans un contexte de marasme économique en France, quelle stratégie de développement vont adopter les chefs politiques présents et à venir ? ».
- la phrase qui n’apporte pas d’information ou qui laisse entendre des choses qui ne seront jamais explicitées : exemple : « Le capitalisme peut être défini autrement » sur le sujet « Le capitalisme peut-il être défini comme un système d’économie de marchés ? ».
- la phrase très proche de la question posée qui donne l’impression que vous n’avez pas réussi à faire progresser le débat.
Si vous appliquez tous ces conseils, votre dissertation sera au moins correcte. Et ne croyez pas qu’il s’agisse là de simples recettes ou de pure rhétorique. Il s’agit de vous pénétrer d’un esprit de rigueur indispensable pour tout travail intellectuel comme pour les futures professions auxquelles vous aspirez.
Dernier principe à retenir : Une règle peut être violée, si violer la règle permet d’être plus convaincant et plus clair.
SUJETS DE DISSERTATIONS
N.B. : Les corrigés sont accessibles avec un mot de passe. Contactez-moi pour en obtenir un.