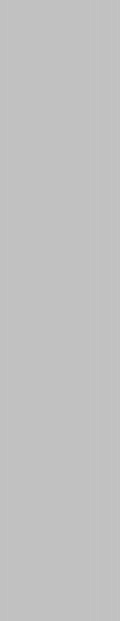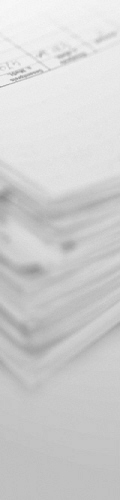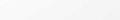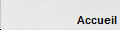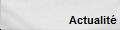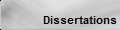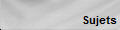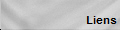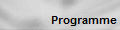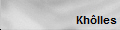Chapitre 4 :
LA BALANCE DES PAIEMENTS ET LE MARCHE DES CHANGES
Dans les trois premiers chapitres, nous avons traité du commerce international. Pour cela, Il a été nécessaire de définir la nation. David Ricardo a proposé au début du 19ème siècle de définir la nation comme un bloc de facteurs de production, c’est à dire que les facteurs de production sont supposés parfaitement mobiles à l’intérieur de l’espace national alors qu’ils sont totalement immobiles entre nations. Si cette définition est très utile pour analyser les flux commerciaux internationaux, en revanche, elle n’est pas suffisante pour analyser les flux monétaires et financiers internationaux.
Dans les trois chapitres suivants, nous allons parler d’économie monétaire internationale, c’est à dire des relations monétaires entre plusieurs nations. Une nation se définit au sens monétaire comme l’espace sur lequel une monnaie circule principalement. Les mouvements monétaires et financiers entre les pays sont visualisés à travers la balance des paiements, document comptable qui retrace les opérations entre les résidents et les non résidents pendant une période donnée. L’état de la balance des paiements influence à son tour le taux de change, qui lui-même influence la balance des paiements.
La mondialisation a accru l’ouverture des économies, les flux commerciaux et financiers internationaux se sont fortement développés, et le taux de change est une variable de plus en plus cruciale, d’autant plus que depuis les années 1970 de nombreuses monnaies sont devenues flottantes.
Dans ce chapitre, nous montrerons comment est construite la balance des paiements et à quoi elle sert ; nous analyserons les déterminants des taux de change et comparerons les changes fixes et flottants.
A) Les règles de construction de la balance des paiements :
- Définition de la Balance des paiements :
La balance des paiements est un document comptable qui recense l’ensemble des opérations économiques intervenues entre les résidents d’un pays et les non-résidents au cours d’une période donnée.
Cette définition appelle 3 séries de précisions :
- les agents concernés :
La résidence est déterminée par le centre d’intérêt économique et non par la nationalité.
Un résident est une personne physique qui a une activité dans un pays depuis plus d’un an, ou une personne morale ayant un ou plusieurs établissements dans le pays (filiale, succursale, agence, bureau, etc.).
Ainsi, du point de vue de la balance des paiements de la France, l’usine Toyota de Valenciennes est un résident et l’usine Peugeot au Brésil un non-résident.
- les opérations :
La balance des paiements permet de distinguer trois types d’opérations : commerciales, financières et monétaires.
La balance des paiements retrace les flux d’échange de biens (exportations et importations) et de services (tourisme, brevets, grands travaux, intérêts des dettes et créances, dividendes…), les flux financiers relatifs aux transferts d’actifs (créances et dettes, investissements directs), les flux monétaires (modification du stock de devises détenu par les banques commerciales et la banque centrale).
- la signification des chiffres enregistrés :
Elle n’est pas un inventaire de biens, services, capitaux ; elle décrit les mouvements de biens, services et capitaux entre les résidents et les non-résidents.
Elle enregistre des flux et non des stocks. Ainsi, la balance des paiements permet de connaître
la valeur des investissements étrangers réalisés au cours d’une année mais non le montant de capital détenu par les non-résidents ; la variation des réserves de change mais non son montant.
La balance des paiements est établie en monnaie nationale. Les transactions en devises sont dans un premier temps comptabilisées dans la monnaie considérée et pas la suite converties en monnaie nationale sur la base du cours du jour du règlement avec l’étranger.
- Histoire et intérêt de la Balance des paiements
L’intérêt de la balance des paiements est d’avoir une vision précise des relations économiques internationales de ce pays. Au Royaume-Uni, les premiers relevés de transactions commerciales remontent au 13ème siècle et les séries régulières à 1696. Des balances des paiements sont établies depuis 1816. En effet, les mercantilistes pensaient que l’information sur les flux avec l’extérieur étaient primordiales. Dans la pensée mercantiliste, la richesse d’un pays est basée sur la quantité d’or détenue. Or la balance des paiements va permettre de voir si le pays dégage ou non un excédent commercial susceptible de générer une entrée d’or dans le pays.
De nos jours, cette conception mercantiliste de la richesse est devenue semble-t-il dépassée, du moins en apparence. Pourtant les comptables nationaux souhaitent connaître les flux de devises qui entrent et sortent, et le solde. La situation est préoccupante si les sorties sont supérieures aux entrées car il faudra puiser dans les réserves de la Banque centrale. D’où la mise en valeur des sources d’entrées et de sorties de devises. De plus, la balance des paiements présente un intérêt pour la politique économique, c’est un indicateur dont disposent les responsables économiques et monétaires d’un pays. La tenue de balances des paiements est donc liée à l’augmentation du rôle de l’Etat. (...)
Lectures conseillées :
- BOURGUINAT Henri, Finance internationale, PUF.
- FRIEDMAN Milton, Inflation et systèmes monétaires, Calmann-Lévy.
- PLIHON Dominique, Les taux de change, La découverte.
- RAFFINOT Marc et VENET Baptiste, La balance des paiements, La découverte.
- SALIN Pascal, L'ordre monétaire mondial, PUF.
Quelques citations :
« Pourquoi ne pas laisser le chien remuer la queue, au lieu de laisser la queue remuer le chien ? »
Friedman, 1969.
« Un modèle capable d’expliquer plus de 50% des variations trimestrielles des cours de change devrait soit être rejeté car cela est trop beau pour être vrai, soit être envoyé au Vatican, un tel miracle justifiant la canonisation d’un nouveau Saint ».
Michael Mussa, 1979.
« A mon avis, un système de taux de change de monnaies nationales liées de manière rigide [comme le SME] est pire que chacun des deux extrêmes, à savoir une véritable monnaie unique ou des monnaies liées entre elles par des taux flottants librement. »
Friedman, 1993.
« Il faut protéger la société des faiseurs de profit sans scrupules. Les transactions sur devises devraient être illégales. Acheter de l’argent n’est nécessaire que lorsqu’on veut financer du commerce réel »,
Mohamad Mahathir, premier ministre de Malaisie, 1998.
« Les changes flottants sont le pire des systèmes, à l’exception de tous les autres »
Robert Rubin, 1999.
Chronologie :
1916 : théorie de la parité des pouvoirs d’achat du suédois G. CASSEL
1923 : théorie de la parité des taux d’intérêt de J.M. KEYNES
1953 : plaidoyer en faveur de la flexibilité des taux de change de M. FRIEDMAN
1972 : création du 1er marché de « futures » sur devises à New-York
1973 : le DM et la plupart des monnaies européennes flottent par rapport au dollar
1976 : modèle de sur réaction de R. DORNBUSCH
1976 : accords de la Jamaïque officialisant le flottement des monnaies
1976 : paradoxe de GROSSMAN
1978 : modèle de substitution des monnaies de MILES
1979-1982 : lien fixe peso chilien/US$
1982 : création du 1er marché d’options sur devises à Philadelphie
1983 : lien fixe dollar de Hong- Kong/US$
1983 : théorie des zones-cibles de J. WILLIAMSON
1991-2001 : lien fixe peso argentin/US$